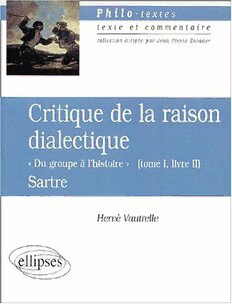Table Of ContentPhilo-textes
Texte et commentaire
Collection dirigée par Jean-Pierre Zarader
Critique de la raison
dialectique
« Du groupe à l'histoire »
(tome I, livre II)
Jean-Paul Sartre
Hervé Vautrelle
Agrégé de philosophie
Aristote, Éthique à Nicomaque, Livre V (1-10) - La justice, par J. Cachia.
A ri s tote, Métaphysique, A 7, par R. Lefebvre.
Aristote, Métaphysique, Livre IV, par J. Cachia.
Bergson, La Pensée et le Mouvant, par P Rodrigo.
Bergson, Le Rire, par A. Pérès.
Descartes, Les Passions de l'âme (première partie), par D. Kolesnik-Antoine et Ph. Drieux.
Diderot, Lettre sur les aveugles, par É. Martin-Haag.
Feuerbach, L’Essence du christianisme, Introduction, chap. 2 , par Ph. Sabot.
Kant, Anthropologie d'un point de vue pragmatique, « De la faculté d’imaginer »,
par A. Makowiak.
Kant, Critique de la raison pratique, Les principes, par P. Billouet.
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, Section I, par 1. Pariente-Butterlin.
Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain, Livre IV, chap. XIX,
par P. Taranto.
Machiavel Le Prince, Chapitres XII à XIV [De la liberté des peuples], par H. Guineret.
Marx, L'Introduction à la Critique de la philosophie du droit de Hegel, par E. Kouvélakis.
Marx, Critique du droit hégélien de l'État, par F. Guery.
Merleau-Ponty, La Structure du comportement, chap. III, 3, « L'ordre humain »,
par É. Bimbenet.
Nietzsche, Ainsi parla Zarathoustra, Volonté, vérité, puissance, 9 chapitres du livre II,
par F. Guery.
Platon, Euthyphron, par A. Complido.
Platon, Ménon, par G. Kévorkian.
Platon, Philèbe, [31b-44a], par A. de La Taille.
Plotin, Ennéade, III, 7 [45], « De l'éternité et du temps », par A. Pigler.
Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes,
par G. Lepan.
Rousseau, Emile, par R. Dany.
Sartre, Critique de la raison dialectique « Du groupe à l’histoire » (tome I, livre II),
par H. Vautrelle.
Sartre, L'existentialisme est un humanisme, par A. Tomes.
Schelling, Idées pour une philosophie de la Nature, par M. Élie.
Spinoza, Éthique, Appendice à la Première Partie, par P. Sévérac.
Whitehead, Procès et Réalité, par M. Élie.
ISBN 2-7298-0512-5
© Ellipses Édition Marketing S.A., 2001
32, rue Bargue 75740 Paris cedex 15
Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L.122-5.2° et 3°a), d’une
part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective », et d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but
d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (Art. L.122-4).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
www.editions-ellipses.com
Sommaire
Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique
(extrait)...............................................................................................4
Présentation globale du projet sartrien........................................7
Commentaire....................................................................................19
lre partie. La réciprocité comme structure fondamentale..............20
2e partie. L’empire de la rareté.........................................................25
3e partie. La mort et la morale.........................................................35
4e partie. La dialectique de la violence et de la liberté...................43
Vocabulaire......................................................................................53
Circularité ■ Dialectique ■ Extéro-conditionnement ■
Fraternité-Terreur ■ Groupe ■ Institution ■ Intériorité ■
Matérialisme ■ Pratico-inerte ■ Praxis ■ Rareté ■ Réciprocité
■ Série ■ Serment ■ Totalisation ■ Violence
Bibliographie 63
Critique de la raison dialectique (extrait)
La « découverte » que nous avons pu faire au cours de l'expérience
dialectique — mais, pour tout dire, est-ce même une découverte ? n'est-
ce pas l’immédiate compréhension de toute praxis (individuelle et
commune) par tout agent (intérieur à la praxis ou transcendant) ? —
c’est celle qui nous a livré à des niveaux différents cette double
caractéristique des relations humaines en dehors des déterminations
de socialité, comme simple rapport entre des individus réels mais
abstraits, elles sont immédiatement réciproques. Et cette réciprocité
— médiée par le tiers puis par le groupe — sera la structure originelle
des communautés. Mais d'autre part la réciprocité n’est ni
contemplative ni affective. Ou plutôt affection et contemplation sont
les caractères pratiques de certaines conduites en certaines
circonstances définies. La réciprocité est praxis à double (ou à
multiple) épicentre. Elle peut être positive ou négative. Il est clair que
son signe algébrique se définit à partir des circonstances antérieures et
des conditions matérielles qui déterminent le champ pratique. Et nous
savons que l’ensemble des conditionnements de la réciprocité
antagonistique se fonde dans l'abstrait sur le rapport de la multiplicité
des hommes au champ d’action, c'est-à-dire sur la rareté. Nous avons
vu aussi que la rareté comme menace de mort produisait chaque
individu d'une multiplicité comme un risque de mort pour l’autre. La
contingence de la rareté (c’est-à-dire le fait que des relations
d'abondance immédiates entre d’autres organismes pratiques et d'autres
milieux ne sont pas a priori inconcevables) est réintériorisée dans la
contingence de notre réalité d’homme. Un homme est un organisme
pratique vivant avec une multiplicité de semblables dans un champ de
rareté. Mais cette rareté comme force négative définit, dans la
commutativité, chaque homme et chaque multiplicité partielle comme
réalités humaines et inhumaines à la fois chaque individu, par
exemple, en tant qu’il risque de consommer un produit de première
nécessité pour moi (et pour tous les Autres), devient surnuméraire : il
menace ma vie dans la mesure même où il est mon semblable il
devient donc inhumain en tant qu'homme, mon espèce m'apparaît
comme espèce étrangère. Mais, dans la réciprocité et la commutativité,
je découvre dans le champ de mes possibles la possibilité d'être moi-
même objectivement produit par les Autres comme objet excédentaire
ou comme inhumanité de l'humain. Nous avons marqué que la
détermination première de la morale, c’était le manichéisme la praxis
compréhensible et menaçante de l’Autre est ce qu’il faut détruire en lui.
Mais cette praxis, comme organisation dialectique de moyens en vue
d'assouvir le besoin, se manifeste comme libre développement de
l’action en l’Autre. Et nous savons que c’est cette liberté, en tant que ma
liberté en l'Autre, que nous devons détruire pour échapper au risque de
mort qui est le rapport originel des hommes par la médiation de la
matière. Autrement dit, l’intériorisation de la rareté, comme relation
mortelle de l’homme à l'homme, est elle-même opérée par un libre
dépassement dialectique des conditions matérielles et, dans ce
dépassement même, la liberté se manifeste comme organisation
pratique du champ et comme se saisissant en l'Autre comme liberté-
autre ou antipraxis et antivaleur à détruire. Au stade le plus élémentaire
du struggle for life, ce ne sont pas d’aveugles instincts qui s'opposent à
travers les hommes, ce sont des structures complexes, dépassements de
conditions matérielles par une praxis fondant une morale et
poursuivant la destruction de l’Autre non pas comme simple objet
menaçant mais comme liberté reconnue et condamnée jusque dans sa
racine. Voilà précisément ce que nous nommons violence, car la seule
violence concevable est celle de la liberté sur la liberté par la médiation
de la matière inorganique. Nous avons vu, en effet, qu’elle peut revêtir
deux aspects la libre praxis peut directement détruire la liberté de
l’Autre ou la mettre entre parenthèses (mystification, stratagème) par
l'instrument matériel ou bien elle peut agir contre la nécessité (de
l’aliénation), c’est-à-dire s’exercer contre la liberté comme possibilité de
devenir Autre (de retomber dans la sérialité), et c’est la Fraternité-
Terreur. La violence est donc en tout cas reconnaissance réciproque de
la liberté et négation (réciproque ou univoque) de celle-ci par
l’intermédiaire de l’inertie d'extériorité. L'homme est violent — dans
toute l’Histoire et jusqu'à ce jour (jusqu’à la suppression de la rareté, si
elle a lieu et si cette suppression se produit dans certaines
circonstances) — contre le contre-homme (c’est-à-dire contre n’importe
quel autre homme) et contre son Frère en tant que celui-ci a la
possibilité permanente de devenir lui-même un contre-homme. Et cette
violence, contrairement à ce qu’on prétend toujours, enveloppe une
connaissance pratique d'elle-même puisqu’elle se détermine par son
objet, c'est-à-dire comme liberté d'anéantir la liberté. Elle se nomme
Terreur quand elle définit le lien même de fraternité ; elle porte le nom
d'oppression quand elle s’exerce sur un ou plusieurs individus et qu’elle
leur impose un statut indépassable en fonction de la rareté : partout, le
statut est abstraitement constitué par les mêmes déterminations
pratiques ; en présence de la rareté des nourritures et de la rareté de la
main-d'œuvre, certains groupes décident de constituer avec d'autres
individus ou d'autres groupes une communauté qui sera définie à la fois
par l'obligation d'exécuter un sur-travail et par la nécessité de se réduire
à une sous-consommation réglée. Or, cette oppression se constitue
comme praxis consciente de soi et de son objet qu’elle passe ou non le
fait sous silence, elle définit la multiplicité des travailleurs
excédentaires non pas en dépit de leur réalité de libres organismes
pratiques mais à cause d’elle. L’esclave, l’artisan, l’ouvrier qualifié,
l'O.S., sont produits, certes, par le mode de production. Mais ils sont
produits, justement, comme cette part plus ou moins considérable de
libre contrôle, de libre direction ou de libre surveillance qui doit
combler l’écart entre l'être-instrumental et l'homme. Il est arrivé, certes,
que l’homme remplace la bête, pour un travail qu'une bête suffisait à
exécuter (les porteurs d'or sur les sentiers qui traversaient au XVIe
siècle l'isthme de Panama). Mais cette nouvelle répartition des tâches
est contrainte consciente de soi et choix délibéré sur fond de rareté le
même qui travaillait hier comme un homme est désigné par les
dirigeants ou les responsables pour se faire librement inférieur à
l’homme. Car la contrainte ne supprime pas la liberté (sauf en liquidant
les opprimés) ; elle en fait sa complice en ne lui laissant d’autre issue
que l'obéissance.
Critique de la raison dialectique, précédé de Questions de méthode,
tome I : « Théorie des ensembles pratiques », 1960, Nrf Gallimard,
collection « Bibliothèque de philosophie », édition de 1985,
livre II : « Du groupe à l’histoire », B, 3, pp. 814 à 816, © Éditions Gallimard.
Présentation
globale
du projet
sartrien
Cette présentation générale de l’entreprise sartrienne pourra ne pas
paraître nécessaire à ceux qui connaissent l'ouvrage, et qui pourront se
reporter directement au commentaire, tandis que les non-initiés y
trouveront, nous l’espérons, quelques clefs pour entrer dans ce texte
ardu.
En effet, le gigantisme et la difficulté de la Critique de la raison
dialectique ont de quoi dérouter bien des lecteurs. Aron lui-même la
comparait à un « monument baroque, écrasant et presque
monstrueux1 ». Toutefois, cette ampleur et cette sophistication
semblent proportionnelles à la démesure du projet. Qu'on en juge : la
Critique constitue une vertigineuse tentative de restituer toute la
complexité du jeu social avant de déboucher sur une intellection du
cours de Vhistoire. Dans cette optique, plusieurs problématiques
majeures traversent ce texte de 1960, que Ton peut énoncer ainsi
comment la multiplicité des consciences individuelles peut-elle se
totaliser pour constituer l’Histoire ? Du coup, quelle commune mesure
peut exister entre la praxis individuelle, c’est-à-dire la libre activité du
sujet dans le champ pratique, et la praxis commune, celle des groupes
et des peuples, nécessairement complexe et synthétique ? Et, à
l'horizon, jusqu'à quel point peut-on connaître les mécanismes de
l'histoire ? D'ailleurs, celle-ci a-t-elle un sens, dans les deux acceptions
du terme a-t-elle une signification et a-t-elle une direction ?
Bien qu'il soit impossible de résumer brièvement la Critique2, il
importe d'en retracer les étapes majeures tout part de la praxis
individuelle comme première totalisation active, mais celle-ci est
pétrifiée dans la vie sociale par des conduites inertes imposées de
sérialité (file d'autobus, auditeurs passifs de la radio, etc.). Sous la
pression de la nécessité, ces séries, rassemblements constitués
d’individus qui sont des « demi-solitudes », constituent des « groupes
en fusion », lors d’une phase que Sartre nomme Y Apocalypse par une
soudaine ébullition, la passivité sérielle se change en activité collective,
comme dans le groupe révolutionnaire, et la foule atomisée devient un
ensemble cohérent et cohésif (Sartre prend les exemples de la
1. Histoire et dialectique de la violence, Préface, p. 9.
2. Laing et Cooper l'ont fait sur une soixantaine de pages dans Raison et violence.
Révolution française et de la Libération). La série s'est dissoute
brutalement à la chaleur d’une prise de conscience commune de
l'aliénation, et l'éclatement d’une révolte a liquidé les anciennes
structures du pratico-inerte (qui désigne l’engluement de la liberté
pratique dans l’inertie de la matière). Or, l’inertie impuissante du
collectif continue de hanter la structure du groupe fusionnel défini par
une unité d’action et de résistance mais aussi une harmonie interne
vulnérable les combattants se lassent de la cause à défendre, les liens
se distendent et « cette explosion informelle ne dure que le temps de
l’action1 », si bien que chacun prête un serment de fidélité afin de
prolonger artificiellement l’unité du groupe en resserrant les rangs.
L’effervescence bouillonnante du groupe s’apaise et celui-ci se mue
alors en un groupe organisé, c’est-à-dire hiérarchisé et bureaucratisé.
En se rigidifiant, il subit une nouvelle mutation et devient une
institution, autrement dit un organisme officiel sans vie, qui fonctionne
souverainement, sans remise en cause, et qui planifie avec autorité la
vie de la nation. La série perce à nouveau sous l’institution, les hommes
sont massifiés et uniformisés, et le pratico-inerte fait son retour en
absorbant la conscience des hommes. Toutefois, cet État (ou ce Parti)
totalitaire ne peut longtemps empêcher la dissidence des praxis
individuelles qui se font de nouveau entendre, et le lecteur revient
ainsi, quoique dissemblablement, à la première figure la boucle est
bouclée et la circularité est parfaite (du moins autant qu’elle peut
l’apparaître puisqu’il s'agit ici d’une spirale, non d’un cercle). Toutefois,
même lorsque l’institutionnalisation du groupe n’est pas contestée,
l’initiative singulière l’anime et lui redonne sens.
Au-delà de ce détail, Sartre s'efforce d'intégrer l'existentialisme au
marxisme, duquel il s’est rapproché sensiblement à partir de 1947. Ce
projet de conciliation de ces deux philosophies en partie contradictoires
est déjà la préoccupation des Questions de méthode, texte de
circonstance devenu l’introduction de la Critique. Sartre, qui y déclare
que « le marxisme est la philosophie indépassable de notre temps » (ce
que Aron qualifiera d’« acte d'allégeance inconditionnelle » ou de
1. Colombel : Jean-Paul Sartre, p. 596.
« déclaration de fidélité1 »), n'y renie pas pour autant la plupart de ses
thèses sur la conscience et sur la liberté définies principalement dans
L'être et le néant. Même s'il s’en est éloigné depuis ce dernier ouvrage,
Sartre reste globalement fidèle au cogito cartésien puisqu’il réintroduit
la subjectivité dans la dialectique de l'histoire. On le voit, cette
« sympathie » de Sartre pour le marxisme n'a pas manqué de susciter
en lui des interrogations quant au primat accordé à la conscience
individuelle et à la liberté du sujet : en effet, comment soutenir encore
que l'homme est fondamentalement libre quand la théorie marxiste
affirme au contraire qu'il est aliéné par l'exploitation et déterminé par
les rapports de production, et qu’il n'est que le produit de l’histoire ?
Comment affirmer simultanément la « passion inutile » du « pour-
soi2 » et sa nécessaire implication dans la trame des événements ? Et
d'ailleurs, ne faut-il pas choisir entre la relativité des valeurs et la
soumission aux idéaux du groupe ? Au fond, la Critique a été en partie
écrite pour sauver la liberté de L'être et le néant et pour penser
l'histoire « oubliée » par cet ouvrage. A ce titre, une opposition
classique mais un peu réductrice entre un « Sartre I » et un « Sartre II »
est souvent avancée, et en partie légitimée par des déclarations de
Sartre lui-même, telles que « La guerre a vraiment divisé ma vie en
deux3». L'être et le néant s'achevait sur des «perspectives
métaphysiques » et sur l’annonce d'un ouvrage de morale consécutif.
De fait, ces projets ont été abandonnés pour mille raisons au profit
d’une réflexion politique qui n'a jamais cessé et qui culmine dans la
Critique.
Considérant que le marxisme reste une explication valide des faits
historiques, Sartre entame donc ici une discussion avec les marxistes
dogmatiques contemporains, qui pour lui ont sombré dans une
orthodoxie stérile et un catéchisme sclérosé, et tente de réfuter ce qu'il
1. Les marxismes imaginaires, p. 166.
2. Cette notion, centrale dans L'être et le néant, désigne l'homme en tant que, ne coïncidant
jamais avec lui-même, il existe pour lui. Le pour-soi « ex-iste », c'est-à-dire qu’il se
projette hors de lui pour tenter de se donner une consistance, tandis que l'en-soi (les
choses) est ce qu'il est, ni plus ni moins, il colle à son être en tant que plénitude opaque.
Par exemple, une pierre ne change pas d'essence, autrement dit de nature, d'être en soi,
tandis que l’homme est voué à se reconstruire sans cesse.
3. Situations, X, p. 180.