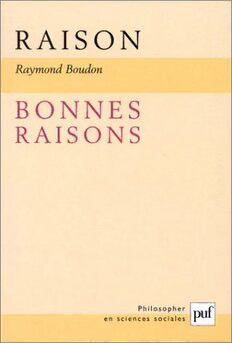Table Of ContentRaison, bonnes raisons
Collection
PHILOSOPHER EN SCIENCES SOCIALES
dirigée par
Jean-Michel Berthelot:~ Alban Bouvier:~
Bernard Conein:~ Pierre Livet:~ Ruwen Ogien
Raymond Houdon
Raison,
bonnes raisons
Presses Universitaires de France
DU MÊME AUTEUR
A quoi sert la notion de structure ? La notion de structure dans les sciences
humaines~ Paris, Gallimard, 1968.
Les méthodes en sociologie~ Paris, PUF, 1969; 12e éd. refondue (avec
R. Fillieule), 2002.
L'inégalité des chances~ Paris, Armand Colin, 1973. En poche : Hachette,
<< Pluriel >>, rééd. 2001.
La logique du social~ Paris, Hachette, 1979. En poche : Hachette, << Plu
riel >>, ré éd. 200 1.
Effets pervers et ordre social, Paris, PUF, 1977. En poche : PUF, << Qua
drige>>, 1989.
Dictionnaire crz'tique de la sociologie (avec F. Bourricaud), Paris, PUF,
1982. En poche: PUF, <<Quadrige>>, 2000.
La place du désordre. Critique des théories du changement social~ Paris, PUF,
1984. En poche : PUF, << Quadrige >>, 1998.
L'idéologie~ ou l'origine des idées reçues~ Paris, Fayard, 1986. En poche :
Le Seuil, << Points >>, 1992.
L'art de se persuader~ Paris, Fayard, 1990. En poche :Le Seuil,<< Points>>,
1992.
Le juste et le vrai: études sur l'objectivité des valeurs et de la connaissance~
Paris, Fayard, 1995.
Le sens des valeurs~ Paris, PUF, << Quadrige>>, 1999.
Études sur les sociologues classiques~ I et II~ Paris, PUF, << Quadrige >>, 1998-
2000.
Déclin de la morale? Déclin des valeurs?~ Paris, PUF, 2002.
Y a-t-il encore une sociologie ?~ Paris, Odile Jacob, 2003.
DIRECTION D'OUVRAGES COLLECTIFS
Cognition et sciences sociales~ coéd. avec A. Bouvier et F. Chazel, Paris,
PUF, 1997.
École et société~ coéd. avec N. Bulle et M. Cherkaoui, Paris, PUF, 2001.
L'explication des normes sociales~ coéd. avec P. Demeulenaere et R. Viale,
Paris, PUF, 2001.
ISBN 2 13 052664 0
Dépôt légal - 1re édition : 2003, février
© Presses Universitaires de France, 2003
6, avenue Reille, 75014 Paris
Sommaire
Avant-propos par J.-M. Berthelot 5
Introduction - La théorie rationnelle de l'action
sociale 7
Chapitre 1 - Théorie du choix rationnel (TeR) ou
Modèle rationnel général (MRG) ? 19
Le système d'axiomes définissant la TCR 19
Importance de la TCR 28
La TCR : une théorie puissante ou une théorie
générale? 38
Le modèle rationnel général (MRG) 49
Séduction de l'utilitarisme 54
Chapitre 2 - La rationalité cognitive 57
La notion de rationalité cognitive 57
Croyances collectives 63
Contextualité des .c royances 89
Chapitre 3 - La rationalité axiologique 99
La notion de rationalité axiologique 99
Les sentiments moraux sont-ils rationnels ? 101
Contextualité des croyances normatives 111
3
Chapitre 4 - Dix questions sur le MRG 123
Les critères du vrai, du légitime, etc. 123
Perspective instrumentale et perspective axiologique 130
Paramètres non cognitifs de la formation des
croyances 134
Rationalisation et évolution 136
Bonnes raisons et raisons fortes 138
La question de l'indétermination 142
Modèle monologique ou dialogique ? 146
Raisons et émotions 150
La TCR, le MRG et la formalisation 151
La complexité variable des systèmes de raisons 152
Conclusion - Le principe de réalisme comme base de
toute science 15 5
Références 16 7
Acronymes 177
Index 179
Avant-propos
par Jean-Michel Berthelot
Parmi les textes inaugurant la collection Philosopher
<<
en sciences sociales >>, il nous a paru important de faire figu
rer un ouvrage de Raymond Boudon. Celui-ci occupe, dans
la sociologie et dans la philosophie des sciences sociales
contemporaine, une place majeure. Ses travaux ont tou
jours visé à clarifier et à fonder scientifiquement des posi
tions centrales du débat des sciences sociales. Il s'est ainsi
tour à tour affronté aux problèmes de la causalité (L'analyse
mathématique des faits sociaux, 1967), à la notion de struc
cA
ture quoi sert la notion de structure ?, 1968), aux théories
de la reproduction (L'inégalité des chances, 1973) ou à celles
du changement social (La place du désordre, 1984). Un
modèle d'analyse s'est ainsi progressivement dégagé et
approfondi, dans un style analytique très exigeant, rare
dans les sciences sociales françaises. Se réclamant de
l'individualisme méthodologique, il place, au cœur des phé
nomènes sociaux, l'activité d'agents rationnels (Effets per
vers et ordre social, 1977 ; La logique du social, 1983).
Depuis une quinzaine d'années, Raymond Boudon
applique ce modèle aux croyances des agents et notamment
à leurs raisons d'adhérer à des idées fausses et apparem
ment irrationnelles (L'idéologie ou l'origine des idées reçues,
1986; L'art de se persuader, 1990; Le juste et le vrai, 1995).
5
Il en est ainsi venu à approfondir, dans la lignée de Max
Weber, la conception de la rationalité et à se démarquer de
l'orthodoxie de la <<Théorie du choix rationnel>>.
Cette théorie tire aujourd'hui sa puissance de sa capa
cité à unifier, sous un même modèle, divers domaines des
sciences sociales. Elle suscite, souvent, adhésion ou rejet
sans réserves. La sociologie française, notamment, lui a été
longtemps rétive, minimisant son importance et la rejetant
parfois par des arguments faciles : les comportements des
acteurs sociaux ne sont-ils pas toujours beaucoup plus
complexes et opaques que le calcul rationnel auquel la
théorie voudrait les réduire ?
Le grand intérêt de cet ouvrage est de reprendre la dis
cussion de façon particulièrement claire et méthodique. Il
propose de considérer l'utilitarisme de la Théorie du choix
rationnel comme dépendant d'un système d'axiomes plus
vaste, définissant des modèles plus ou moins fermés selon
les propositions introduites ; en ne retenant que les
trois premiers axiomes de ce système, il est possible de
définir un << Modèle rationnel général >>, où les << bonnes rai
sons >> des agents se substituent au simple calcul d'utilité.
Cela implique de reconnaître le caractère fondamental
des notions de << rationalité cognitive >> et de << rationalité
axiologique >>.
Déjà développées dans les ouvrages précédents, ces thè
ses sont ici présentées dans une sorte d'épure, permettant
d'en dégager avec force les enjeux fondamentaux. Elles
sont également suivies, dans le chapitre 4, de réponses aux
objections qui leur sont le plus couramment adressées, per
mettant à l'auteur de clarifier sa position sur diverses ques
tions sensibles.
Quelles que soient les convictions du lecteur, qu'il par
tage ou non les thèses avancées, les voies d'une discussion
argumentée et raisonnable, sur les principes et leurs consé
quences, lui sont ainsi ouvertes. C'est l'ambition de la col
lection << Philosopher en sciences sociales >>.
INTRODUCTION
La théorie rationnelle
de l'action sociale
La sociologie poursuit d'autres objectifs que l'explica
tion des phénomènes sociaux et la notion même d' explica
tion a souvent en sociologie un sens plus incertain que dans
les sciences établies.
Cet état de choses explique en grande partie le succès
considérable que rencontre depuis une vingtaine d'années,
dans de prestigieux organismes de recherche, en Amérique
du Nord et en Europe, la Théorie du choix rationnel (TCR).
Celle-ci s'est développée sur un fond de scepticisme à
l'endroit de la sociologie contemporaine. Elle est une véri
table théorie ; elle se présente comme une tentative pour
doter la sociologie et, plus généralement, les sciences socia
les dans leur ensemble de bases solides. Elle est perçue
comme un espoir par tous ceux qui, par contraste avec le
sociologue allemand Lepenies (1985), ne se résignent pas à
voir dans les sciences sociales une troisième culture dotée
d'une identité purement négative : ni science ni littérature
(Chazel, 2000).
Dans les premières décennies du xxe siècle, les sciences
de la nature traversèrent une crise sérieuse. Les théoriciens
du Cercle de Vienne cherchèrent à en diagnostiquer les rai
sons et à dessiner une ligne de démarcation entre science et
non-science. Il n'est pas question de rapporter ici leurs dis-
7