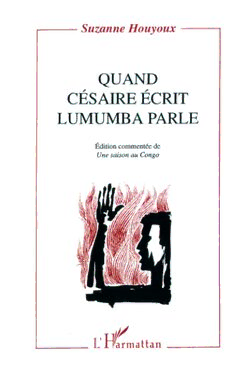Table Of ContentSUZANNE BRICHAUX-HOUYOUX
QUAND CESAIRE ECRIT,
LUMUMBA PARLE
Edition commentée de
Une saison au Congo
Editions L'Harmattan
5 - 7, rue de lEcole-Polytechnique
75005 Paris
Dans la collection « Critiques Littéraires »
Dernières parutions :
GONTARD M., Violence du texte. La littérature marocaine de langue
française.
DABLA S., Nouvelles écritures africaines. Romanciers de la seconde
génération.
LAÂBI A., La brûlure des interrogations. Entretiens réalisés par
J.Alessandra.
BAFFET R., Tradition théâtrale et modernité en Algérie.
BONN Ch., Le roman algérien de langue française. Vers un espace de
communication littéraire décolonisé ?
GODARD R., Trois poètes congolais : M. N'Débéka, J.-B. Tati
Loutard, T. U. Tam'si.
HOURANTIER M.-J., Du rituel au théâtre rituel. Contribution à une
esthétique théâtrale néo-africaine.
KOTCHY B., La critique sociale dans l'oeuvre théâtrale de Bernard
Dadié.
LALLEMAND S., L'apprentissage de la sexualité dans les contes
d'Afrique de l'Ouest.
CALMES A., Le roman colonial en Algérie avant 1914.
CHEMAIN R., L'imaginaire dans le roman africain d'expression
française.
MOSTEGHANEMI A., Algérie, femme et écritures.
N'DA P., Le conte africain et l'éducation.
DA SILVA G., Le texte et le lecteur comme interaction objective.
Anthologie de la poésie tunisienne de langue française. Introduction et
notes par H. Khadhar.
OSSITO MIDIOHOUAN G., L'idéologie dans la littérature négro-
africaine d'expression française.
GONTARD M., Nedjma de Kateb Yacine. Essai sur la structure
formelle du roman.
DESJEUX J., Le sentiment religieux dans la littérature maghrébine de
langue française.
BEKRI T. , HADDAD M., L'oeuvre romanesque. Pour une poétique de
la littérature maghrébine de langue française.
NDACHI TAGNE D., Roman et réalités camerounaises, 1960-1985.
BOUELET R. S. , Espaces et dialectique du héros césairien.
COLLECTIF, Le récit et le monde. H. Quiroga, J. Rue, R. Bareiro
Saguier.
© Editions du Seuil, 1974 pour le texte de
Une saison au Congo.
Tous droits de reproduction réservés.
© L'Harmattan, 1993
ISBN : 2-7384-1767-1
A ma Mère, qui m'a donné le goût de la
lecture, et à la mémoire de mon Père,
qui m'a donné celui de l'Histoire;
pour mon mari, Richard, et mes fils,
Vincent, Renaud, Denis.
A Monsieur Aimé Césaire et à mita,
avec toute ma gratitude.
Remerciements.
Mes informateurs ont été trop nombreux pour que je
puisse mentionner ici leurs noms, mais je tiens à souligner
ce que je dois, en particulier, à trois personnes qui ont été
pour moi des informateurs sûrs, ne ménageant ni leur temps
ni leurs efforts.
Jean Van Lierde, journaliste, militant de la non-
violence et ami de la première heure de Patrice Lumumba,
m'a encouragée dans mon projet dès 1987. Il m'a accordé
un accès sans réserve à ses archives personnelles et, au
cours de nombreux entretiens et échanges épistolaires,
complété ou éclairci les informations que je glanais par
ailleurs. Il m'a confié des documents inédits et d'autres
personnels. Je lui dois d'avoir été introduite auprès de
nombreuses personnes et personnalités dont l'expérience
vécue des événements dits de 1960 a beaucoup ajouté au
résultat de mes recherches personnelles.
Jean Kestergat, écrivain et journaliste, m'a lui aussi
confortée dans mon entreprise dès 1987. Acceptant
d'expliquer et de commenter, pour mon bénéfice, ses divers
ouvrages relatifs au Congo et au Zaïre, il a, à de multiples
reprises, partagé avec moi ses souvenirs et l'abondante
information dont il disposait. Il m'a lui aussi ménagé une
introduction auprès de ceux qui pouvaient m'aider à mieux
comprendre l'histoire et l'actualité politique des années
1960, donc la représentation qu'en a faite l'auteur.
Enfin, le Colonel Frédéric Vandewalle a lu et
commenté la première version de ce travail; il a rectifié des
erreurs et m'a apporté des informations dont j'ai fait
largement usage.
Introduction
L'étude d'Une saison au Congo révèle, qu'il
n'existe, par rapport au reste de l'oeuvre dramatique
d'Aimé Césaire, que relativement peu de travaux consacrés
à cette pièce.1 L'intérêt d'une édition commentée s'impose,
notamment en raison de l'absence de tout travail du genre
pour l'oeuvre dramatique de l'auteur. 2
Au-delà de la valeur de témoignage de l'engagement
anti-colonialiste de l'auteur et de la facture
historiographique, selon certains hagiographique, du texte,
il semble que les thèmes qui y sont évoqués peuvent,
moyennant apport de développements documentaires,
trouver une application pédagogique qui dépasse les seuls
aspects et intérêts strictement littéraires pour déboucher sur
les sciences humaines au sens large du terme, puisqu'il y
1Les répertoires les plus récents et les plus complets des écrits
sur Aimé Césaire ont été établis sous forme d'études
bibliographiques : en 1973 par Frederick Ivor Case, en 1978 par
Thomas Hale et en 1984 par A. James Arnold.
2Une saison au Congo a été analysée dans des optiques
différentes et à des degrés divers, soit dans le cadre de l'ensemble de
l'oeuvre dramatique de l'auteur (Ngal et Steins, 7-33) soit isolément
(Ngal et Steins, 21-25), mais elle n'a jamais fait l'objet d'une édition
critique ou annotée complète.
7
est question non seulement d'histoire et de politique mais
encore d'anthropologie, d'ethnologie et d'économie.
L'ensemble des perspectives couvertes par le texte
d'Aimé Césaire mérite le qualificatif d'humaniste en ce sens
que l'auteur aborde une série d'intérêts de l'homme et que,
retrouvant la tradition de la Renaissance qui faisait souvent
de l'écrivain un chroniqueur historique, il est en prise
directe sur une appréhension littéraire et esthétique de
l'actualité.
L'analyse du travail auquel s'est livré l'auteur pour
écrire cette pièce est une démonstration de ce qu'un écrivain
est à la fois témoin et porte-parole de son temps ainsi que
"voyant" au sens rimbaldien du terme par la prescience des
temps à venir, dont il se fait le héraut.
Enfin, quand on sait qu'Aimé Césaire n'était jamais
allé en Afrique avant d'écrire cette pièce, on ne peut
qu'apprécier l'effort de documentation, la pertinence des
choix et la franche tonalité africaine du texte.
La première version d'Une saison au Congo a été
publiée par les Editions du Seuil en 1966. Une deuxième
version remaniée en fonction des représentations théâtrales
à Bruxelles et à Paris, a été publiée en 1969. Enfin, une
troisième version a été mise dans le commerce en 1974 par
le même éditeur. C'est ce dernier texte qui sert de base au
commentaire bien qu'une quatrième version ait été publiée
en 1976 par les Editions Désormeaux à Paris et à Fort-de-
France.3
La recherche a montré que l'auteur s'était parfois
basé sur des informations qui ont depuis été complétées,
modifiées voire dénoncées comme ne correspondant pas à
la réalité historique. Je n'ai, de façon générale, pas fait
mention des rectifications politiques et historiques sauf dans
quelques rares cas où l'information actuelle changeait
sensiblement l'interprétation des faits (par exemple les
conditions de l'assassinat de Patrice Lumumba, note 388).
Chaque commentaire est annoncé par un chiffre
arabe qui ou bien suit immédiatement le mot, soit s'inscrit à
la fin de la phrase qui donne lieu à un commentaire; la
3J'ai choisi de commenter le texte qui doit être considéré comme
définitif pour le théâtre, compte tenu de la note de l'auteur en page 119
de l'édition 1973 du Seuil.
8
numérotation est séquentielle. Les notes qui accompagnent
le texte d'Aimé Césaire sont insérées à la fin de chaque
scène. Les notes qui accompagnent les documents
reproduits en annexe à la pièce ont reçu une numérotation
qui poursuit celle du commentaire du texte de la pièce. Les
renvois au texte indiquent l'acte en chiffres romains et la
scène en chiffres arabes. Les documents reproduits dans les
annexes le sont dans l'ordre de la chronologie dramatique.
Par ordre d'importance et de proximité du texte
théâtral apparaissent :
--à la fin de chaque scène de la pièce des "Notes." Y
figurent des éléments d'information linguistique,
géographique, historique ou encore ethnographique ainsi
que la traduction des termes et expressions africains dont
Aimé Césaire a émaillé son texte ou encore des citations
extraites des ouvrages dont il s'est manifestement inspiré;
--en 2.1. Chronologie comparée des événements
historiques et dramatiques, une chronologie détaillée de la
succession des événements historiques et de ceux de la
dramatisation qui en a été dérivée par Aimé Césaire;
--en 2.2. Notices biographiques des personnages
identifiés, de brèves notices pour les personnalités dont
l'auteur cite le nom ainsi que pour celles qui ont pu être
identifiées à travers les personnages qu'il met en scène.
Pour les quelques personnages que je n'ai pu identifier
formellement, j'ai indiqué les possibilités à envisager;
--en 2.3. Textes officiels belges et congolais et en
2.4. Documents d'archives, une collection de textes et
d'extraits de textes dont la teneur éclaire les choix de
l'auteur, montre l'usage qu'il a fait de l'information qui lui
était accessible ou encore corrobore son intuition de
l'évolution future des événements évoqués;
--en 2.5. Cartes, une carte géo-politique et une carte
ethno-linguistique du Congo belge ainsi qu'une
concordance des principales appellations géographiques
anciennes et nouvelles.
Deux techniques de recherche ont été combinées,
documentation écrite et interview :
--la documentation écrite est en majeure partie
d'origine belge et zaïroise; parmi les documents figurent
ceux qui ont un caractère officiel ou public ainsi que ceux
9
qui ont un caractère privé et qui soit m'ont été confiés par
leurs possesseurs soit sont tombés dans le domaine public;
--deux types d'interview ont été utilisées :
l'interview libre et l'interview guidée. L'interview libre a
souvent été préférée : parfois en raison de l'âge et de l'état
de santé de certains de mes informateurs; parfois en raison
des séquelles passionnelles toujours vivaces chez certains
des acteurs et témoins des événements; ou encore à cause de
la multiplicité des expériences qu'avaient eues d'autres
informateurs. Parmi les personnes interviewées se
trouvent : des politiciens, des personnalités
administratives, militaires et des hommes d'affaires; des
journalistes; des prêtres, religieuses et missionnaires;
d'anciens colons ainsi que des mercenaires et des
légionnaires.4
Le fait que les événements dont je vise à éclaircir
une connaissance plus intime sont à la fois récents et, dans
une certaine mesure, toujours en voie de développement,
ajoute à la complexité du contenu du commentaire. Pour
tenter de surmonter les divers handicaps relevés, je me suis
attachée à concilier une approche inductive aussi minutieuse
que possible de l'information et plutôt que de chercher des
relations causales j'ai choisi de décrire des événements ou
de reproduire les textes qui rendent avec le plus de fidélité
les comportements et opinions des protagonistes.
Aimé Césaire semble s'être particulièrement
intéressé à l'Afrique, à son histoire comme à son devenir, à
partir de son arrivée à Paris dans les années 1930. Son
amitié avec Léopold Sedar Senghor, sa découverte du
"Harlem Renaissance" et l'élaboration du concept de
"Négritude" ont développé cet intérêt au fil du temps.
Passionné par la condition de l'homme noir et devenu
homme politique, Aimé Césaire s'est attaché à analyser le
phénomène de la colonisation, contre laquelle il a écrit le
célèbre réquisitoire Discours contre le colonialisme.
C'est essentiellement par le genre dramatique
qu'Aimé Césaire a choisi d'exprimer sa position. Le poème
lyrique Et les chiens se taisaient qui clôturait le recueil Les
4Une liste détaillée de mes informateurs figure en annexe 2.7.
de la thèse doctorale dont provient cette édition commentée; voir
Bibliographie.
10
armes miraculeuses en 1946 a été transformé en tragédie en
1956; en 1963, l'auteur a publié La tragédie du roi
Christophe et, en 1966, la première version d'Une saison
au Congo.
Ce choix ne semble pas être imputable à la seule
préférence de l'auteur, il est également un reflet des modes
d'expression africains. Le théâtre est connu sous de
multiples formes en Afrique : rites cycliques fondés sur le
rythme des saisons et des travaux ruraux; culte des ancêtres;
initiations et actes de la vie quotidienne : tout est motif à
théâtralisation. Selon les cas, l'action revêt un caractère
religieux ou profane mais elle est toujours essentiellement
populaire.
Une saison au Congo s'inscrit dans cette double
perspective : l'utilisation de masques (III-6), la
participation d'un récitant chantant et dansant--le Joueur de
sanza--qui exploite les thèmes de contes animaliers, par
exemple en (III-2), relèvent bien du divertissement. Les
allusions au Kimbanguisme (I-2), au Kitawala (III-6) ou
encore au Christ (III-2/4) sont, elles, d'ordre religieux. Les
buts de ce théâtre sont explicites : en donnant à chacun le
sentiment de son appartenance au groupe, ou en le
renforçant, il permet de consolider l'ordre de la
communauté et de faire passer à ses membres les messages
indispensables tant à son maintien qu'à son évolution; c'est
manifestement dans cette tradition que s'inscrit la pièce.
A partir de 1954--et notamment de la création en
Afrique noire française de centres culturels--le théâtre
africain s'est engagé dans la voie de la contestation et de la
remise en cause de l'ordre colonial par l'exploitation des
thèmes de la révolte et de la lutte pour la liberté. Il s'est
principalement développé dans deux directions :
dénonciation du colonialisme et de ses séquelles, critique
des moeurs politiques des nouveaux dirigeants. C'est à ces
courants que se rattache Une saison au Congo qui
stigmatise : la corruption, l'incivisme, l'appétit de pouvoir
de la classe politique en général et le hiatus croissant entre la
masse rurale et l'élite urbaine.
La tendance, de plus en plus engagée de ce théâtre--
qui au Zaïre par exemple a conduit au développement de
spectacles dits d'animation politique--a pour objet de révéler
au peuple africain son identité propre et de l'exhorter à se
11
ressaisir en vue d'en faire l'artisan de la nouvelle société à
édifier (I-6 et II-1).
Déjà dans le Discours sur le colonialisme Aimé
Césaire montrait qu'il y existe une certaine incompatibilité
entre civilisation et colonisation; comme l'ont relevé divers
critiques, il s'agit par le truchement de la représentation
dramatique, de faire le bilan :
... de cultures piétinées, d'institutions ruinées, de religions
assassinées, de magnificences anéanties, d'extraordinaires
possibilités supprimées. (19)
La critique n'épargne pas l'époque contemporaine et
ce théâtre engagé prend pour cible les avatars du néo-
colonialisme tels que : le culte abusif du leader, plus ou
moins charismatique, ou de l'institution du parti unique
(I-2, III-2/7/8). Par delà la satire du moment il s'attaque au
fond même du problème avant et après l'indépendance. Il
montre qu'à la poésie de l'épopée, lutte de libération
nationale, succède inéluctablement la prose du drame
quotidien fait de luttes incessantes contre l'aliénation
résiduelle, la lâcheté et le cynisme des uns (III-6), le
découragement des autres (I-8) ou encore la confiscation
proche de l'indépendance au profit des nouvelles
bourgeoisies (III-8). Aimé Césaire ne craint pas d'aborder
la politique dans son théâtre, car, dit-il :
Depuis l'indépendance, l'Afrique a eu à résoudre bien des
problèmes et elle s'interroge. Elle a besoin de se comprendre
elle-même. Dans l'état actuel des choses, le théâtre est un des
genres littéraires qui répond le mieux à ses besoins. Or, nous
avons des acteurs mais pas de répertoire, le théâtre en Afrique
n'étant fait que de manifestations folkloriques. Ce que je
voudrais, c'est créer un théâtre noir. Sous quelle forme? Celle
du théâtre local. Pour moi, théâtre, poésie et chant sont liés.
J'ai été très influencé par les Grecs, Shakespeare et Brecht.
Mais mon théâtre est surtout un théâtre politique parce que
les problèmes majeurs en Afrique sont les problèmes
politiques. J'aimerais réactualiser la culture noire pour en
assurer la permanence, pour qu'elle devienne une culture qui
contribuerait à l'édification d'un ordre nouveau, d'un ordre
révolutionnaire où la personnalité africaine pourrait
s'épanouir. (Romi, interview du 16 mars 1966, 39-40).
12