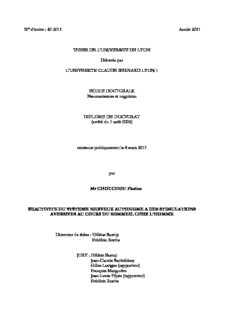Table Of ContentN° d’ordre : 40-2011 Année 2011
THESE DE L’UNIVERSITE DE LYON
Délivrée par
L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
ECOLE DOCTORALE
Neurosciences et cognition
DIPLOME DE DOCTORAT
(arrêté du 7 août 2006)
soutenue publiquement le 4 mars 2011
par
Mr CHOUCHOU Florian
REACTIVITE DU SYSTEME NERVEUX AUTONOME A DES STIMULATIONS
AVERSIVES AU COURS DU SOMMEIL CHEZ L’HOMME
Directeur de thèse : Hélène Bastuji
Frédéric Roche
JURY : Hélène Bastuji
Jean-Claude Barthélémy
Gilles Lavigne (rapporteur)
François Mauguière
Jean-Louis Pépin (rapporteur)
Frédéric Roche
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1
Président de l’Université M. le Professeur L. Collet
M. le Professeur J-F. Mornex
Vice-président du Conseil Scientifique
M. le Professeur G. Annat
Vice-président du Conseil d’Administration
M. le Professeur D. Simon
Vice-président du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire
M. G. Gay
Secrétaire Général
COMPOSANTES SANTE
Faculté de Médecine Lyon Est – Claude Bernard Directeur : M. le Professeur J. Etienne
Faculté de Médecine Lyon Sud – Charles Mérieux Directeur : M. le Professeur F-N. Gilly
UFR d’Odontologie Directeur : M. le Professeur D. Bourgeois
Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Directeur : M. le Professeur F. Locher
Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation Directeur : M. le Professeur Y. Matillon
Département de Biologie Humaine Directeur : M. le Professeur P. Farge
COMPOSANTES ET DEPARTEMENTS DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Faculté des Sciences et Technologies Directeur : M. le Professeur F. Gieres
Département Biologie Directeur : M. le Professeur C. Gautier
Département Chimie Biochimie Directeur : Mme le Professeur H. Parrot
Département GEP Directeur : M. N. Siauve
Département Informatique Directeur : M. le Professeur S. Akkouche
Département Mathématiques Directeur : M. le Professeur A. Goldman
Département Mécanique Directeur : M. le Professeur H. Ben Hadid
Département Physique Directeur : Mme S. Fleck
Département Sciences de la Terre Directeur : M. le Professeur P. Hantzpergue
UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Directeur : M. C. Collignon
Observatoire de Lyon Directeur : M. B. Guiderdoni
Ecole Polytechnique Universitaire de Lyon 1 Directeur : M. le Professeur J. Lieto
Institut Universitaire de Technologie de Lyon 1 Directeur : M. le Professeur C. Coulet
Institut de Science Financière et d'Assurance Directeur : M. le Professeur J-C. Augros
Institut Universitaire de Formation des Maîtres Directeur : M R. Bernard
2
En écrivant les derniers mots de ce travail, mes pensées vont à Maud et Robin,
Avec tout mon amour,
A ma mère, Jocelyne,
Avec toute ma gratitude,
A ma grand-mère, Louiza,
Avec toute ma fierté.
3
Je remercie l’ensemble des gens qui m’ont aider à réaliser ce travail, par de petites ou
de grandes contributions.
D’abord, mes remerciements vont à mes deux directeurs de thèse, les docteurs Hélène
Bastuji et Frédéric Roche, pour avoir éclairer ce parcours jonché de solutions simples, dont
la découverte nécessite un regard expérimenté. Je les remercie d’avoir fait se rencontrer deux
domaines de recherche passionnants que sont le sommeil et le système nerveux autonome. Je
les remercie également de leur soutien, la quête de solution et de compréhension n’étant pas
toujours facile.
Ensuite, je remercie les membres deux équipes au sein desquelles j’ai réalisé ces
travaux au cours des trois dernières années, l’unité INSERM U879 de Lyon et l’unité
universitaire SNA-EPIS, et en particulier leurs directeurs de recherche qui m’ont confié ces
travaux de thèse, les docteurs Luis Garcia Larrea et Jean-Claude Barthélémy. Je pense aussi
à Caroline Perchet, Stéphanie Mazza, Maud Frot, Michel Magnin, Ghislaine Lachal,
Bérengère Houzé qui ont tous contribué à ces travaux dans un climat stimulant et agréable.
Et longue vive à la menthe à l’eau!
Je remercie également les stéphanois, Sébastien Celle, Delphine Maudoux, Emilia
Sforza, Jean Claude Barthélémy, Vincent Pichot et Arnauld Garcin.
Merci à Vincent pour ces longues et complexes réponses à mes petites questions
simples et embêtantes, merci à ces heures de programmation et d’explication. Il me reste
encore plein d’idées!
Je remercie Novacor, pour son soutien financier, et particulièrement Laurent
Poupard, qui m’a grandement faciliter la conduite de ces projets pendant tout ce temps de
thèse, et avec qui j’ai plaisir à travailler.
Enfin, je remercie également mes deux rapporteurs, Jean-Louis Pépin et Gilles
Lavigne, d’avoir accepter de relire mon manuscrit. Merci à Gilles Lavigne, de m’avoir
accepté en post-doctorat au sein de sa prestigieuse équipe de recherche. Une nouvelle
aventure démarre à Montréal!
4
Une pensée pour ma famille,
A mon frangin, j’espère qu’en lisant ce travail les idées pousseront. Merci de ta
camaraderie grandissant avec la vie.
A ma sœur et à mon père, en vous remerciant de votre soutien, et en vous promettant
d’être plus présent. Une pensée pour Matéo, ses « non » et ses idées coquines du haut de ces
deux ans.
A Salima, Nacer, Hind, Soumya, Rayanne et Raydouane, j’espère que ce travail vous
montrera que beaucoup de choses sont possibles.
A Maud, quelle patience ! Merci de ton soutien inconditionnel, à nous maintenant de
profiter des fruits de ce travail, à trois, bien calme ! Que cette aventure à trois nous même
loin.
A Robin, quelle impatience ! A nous de t’étonner encore et encore…
Je remercie également, Mme Isabelle Garcia, Bernard Porterie, papy Jo, Jean-Pou et
Isabelle, Pauline, et les amis de toujours qui sont dans toutes les aventures, bonnes ou
mauvaises : Séb, Ju, Eric, Annie et Pompi, Mathieu, Jan (etc…)…vivement votre visite à
Montréal!
5
Table des matières
Introduction générale ............................................................................................................9
Chapitre 1 : états de vigilance.............................................................................................11
Phénoménologie des états de vigilance.................................................................................................................12
Veille.................................................................................................................................................12
Sommeil lent.......................................................................................................................................13
Sommeil paradoxal.............................................................................................................................15
Organisation des différents stades de sommeil au cours du sommeil.....................................................................16
Contrôle des états de vigilance...........................................................................................................................17
Veille.................................................................................................................................................17
Sommeil lent.......................................................................................................................................18
Sommeil paradoxal.............................................................................................................................19
Modèle de régulation réciproque.........................................................................................................................20
Processus de régulation de sommeil....................................................................................................................21
Conclusion.......................................................................................................................................................23
Chapitre 2 : contrôle autonome cardiaque..........................................................................26
Organisation anatomique du système nerveux autonome cardiaque.....................................................................28
Xème paire de nerf crânien : le nerf vague............................................................................................30
Nerfs sympathiques.............................................................................................................................30
Terminaisons nerveuses autonomes.......................................................................................................31
Propriétés fonctionnelles du système nerveux autonome cardiaque.......................................................................32
Propriétés « pacemaker » du cœur........................................................................................................32
Influence sympathique sur le rythme cardiaque.....................................................................................33
Influence parasympathique sur le rythme cardiaque..............................................................................34
Interaction entre systèmes cholinergique et noradrénergique....................................................................35
Contrôle central du système nerveux autonome...................................................................................................36
Contrôle spinal...................................................................................................................................36
Contrôle du tronc cérébral....................................................................................................................37
Influence baroréflexe..............................................................................................................38
Influence respiration...............................................................................................................41
6
Contrôle hypothalamique.....................................................................................................................43
Contrôle cérébral.................................................................................................................................44
Conclusion.......................................................................................................................................................45
Chapitre 3 : exploration de l’activité autonome cardiaque : méthodes d’analyse de la
variabilité RR. Du domaine temporel à l’analyse temps-fréquence...................................46
Méthode d’analyse temporelle............................................................................................................................49
Méthode d’analyse géométrique..........................................................................................................................50
Méthode d’analyse fréquentielle.........................................................................................................................51
Standardisation des différentes fréquences et interprétations physiologiques..........................................................52
La puissance spectrale totale................................................................................................................53
Les ultras basses fréquences et les très basses fréquences........................................................................53
Les basses fréquences...........................................................................................................................54
Les hautes fréquences..........................................................................................................................56
Les valeurs normalisées.......................................................................................................................56
Le rapport BF/HF...........................................................................................................................57
Intérêts et limites de l’analyse par transformée de Fourier...................................................................................58
Transformée en ondelettes..................................................................................................................................59
Construction des ondelettes..................................................................................................................59
Application à l’analyse de la variabilité RR.......................................................................................62
Autres méthodes d’exploration du système nerveux autonome............................................................................63
Conclusion.......................................................................................................................................................65
Chapitre 4 : contrôle autonome cardiaque et états de vigilance.........................................66
Veille...............................................................................................................................................................67
Transition veille-sommeil..................................................................................................................................67
Sommeil lent ...................................................................................................................................................68
Sommeil paradoxal..........................................................................................................................................71
Effet circadien..................................................................................................................................................72
Conclusion.......................................................................................................................................................73
Chapitre 5 : Etude 1 : réactivité autonomique cardiaque aux stimulations nociceptives
pendant le sommeil chez le sujet sain..................................................................................74
Introduction......................................................................................................................................................75
7
Méthode...........................................................................................................................................................76
Résultats..........................................................................................................................................................84
Discussion 1.....................................................................................................................................................93
Conclusion.......................................................................................................................................................97
Chapitre 6 : Etude 2 : réactivité autonomique cardiaque aux évènements respiratoires
pendant le sommeil chez le sujet apnéique..........................................................................98
Introduction......................................................................................................................................................99
Méthode.........................................................................................................................................................101
Résultats........................................................................................................................................................107
Discussion 2..................................................................................................................................................119
Conclusion.....................................................................................................................................................123
Chapitre 7 : Etude 3 : impact de l’équilibre autonomique basale sur la réactivité corticale
aux évènements respiratoires et aux stimulations nociceptives au cours du sommeil.......124
Introduction...................................................................................................................................................125
Méthode.........................................................................................................................................................126
Résultats........................................................................................................................................................128
Discussion 3..................................................................................................................................................133
Conclusion.....................................................................................................................................................136
Chapitre 8 : discussion générale.....................................................................................…137
Conclusion..........................................................................................................................145
Références bibliographiques..............................................................................................146
Annexes..............................................................................................................................163
8
Introduction générale
Le mot « stress » est utilisé pour décrire l’état réactionnel de l’organisme soumis à une expérience
émotionnelle et physiologique. La (les) contrainte(s) environnementale(s) à l’origine de cette
réaction de l’organisme conduit alors le système nerveux central (SNC), qui prend la mesure de la
(les) contrainte(s), à modifier l’activité d’un grand nombre d’organes. L’ensemble de ces
modifications ont pour finalité de répondre à cette (ces) contrainte(s) afin de protéger l’intégrité
de l’organisme, par un comportement adapté, qualifié de « combat ou fuite » (« fight-or-flight »).
L’activité de ces organes converge alors vers une réponse mobilisatrice des capacités de
l’organisme : métaboliques par la mobilisation des ressources énergétiques, oculaires par la
mydriase pupillaire, respiratoire par la dilatation des bronches, thermogénique par la sécrétion de
sueur ou encore cardio-vasculaire par l’augmentation de la fréquence cardiaque, des résistances
périphériques et de la pression artérielle. Ces réponses, partagées par l’ensemble des espèces du
monde animal, sont nécessaires à la survie de l’individu et s’appuient sur des mécanismes
hormonaux où le cortisol joue un rôle important, mais aussi nerveux par la mise en jeu du
système nerveux autonome (SNA). Bien que nécessaire, une activité excessive ou inadéquate de
ces systèmes peut être délétère pour l’organisme. En effet, l’Homme peut se trouver dans
certaines situations qui entraînent des périodes prolongées d’activation de ces systèmes comme
l’anxiété, le stress chronique, ou encore en réponse à l’exposition répétée à des stimuli aversifs.
Le SNA innerve la quasi-totalité des organes via deux systèmes, les systèmes nerveux
sympathique et parasympathique, qui contribuent activement à de nombreuses fonctions
physiologiques. Le SNA reçoit de nombreuses informations de nature et de provenance
différente. L’hypothalamus est sans doute le plus haut niveau d’intégration et de modulation de la
fonction autonome, sous le contrôle du cortex, en particulier du système limbique, impliquant un
haut degré d’intégration informationnelle, en particulier émotionnelle. Le SNA assure donc une
fonction homéostatique, maintenant les constantes du milieu intérieur ; par sa rapidité d’action, il
produit aussi les premières réponses de l’organisme à des contraintes environnementales ou
« stress ».
Ces réponses aux contraintes environnementales restent dépendantes de la perception de
l’individu. Or, si l’Homme éveillé entretient des rapports sensoriels étroits avec son
9
environnement, ces rapports sont altérés pendant le sommeil. En effet, si les réactions
psychomotrices en réponse à des stimulations de l’environnement sont déprimées au cours du
sommeil, les études du traitement de l’information sensorielle extérieure par les potentiels
évoqués montrent que ce traitement est toujours présent. Ces modifications sont
vraisemblablement en relation avec les changements de fonctionnement du cerveau au cours du
sommeil. Les stimulations, bien qu’étant la plupart du temps traité par le SNC, entraînent
inconstamment des réactions d’éveil mais toujours une réactivité autonomique.
Dans ce travail, nous avons choisi d’étudier les réponses autonomiques à deux types de
stimulation aversive, à savoir les évènements respiratoires obstructifs et les stimuli somatiques
nociceptifs. Bien que la réactivité cardiaque à ce type de stimulations au cours du sommeil soit
établie, nous avons cherché à déterminer quels étaient les phénomènes qui pouvaient la moduler.
Pour cela, nous avons utilisé une méthode d’analyse des réponses autonomiques cardiaques basée
sur la méthode de variabilité RR, qui consiste à décomposer le signal RR (ou fréquence cardiaque)
et à en extraire les oscillations dépendantes de l’activité sympathique et celles dépendantes de
l’activité parasympathique. Ces stimulations aversives produisant des réponses autonomiques
marquées mais transitoires, il était nécessaire d’utiliser une méthode permettant des analyses sur
de courtes durées, de l’ordre de plusieurs secondes. L’analyse temps-fréquence du signal RR,
basée sur des transformées en ondelettes paraissait donc adaptée pour évaluer au mieux les
variations du signal RR en réponse à ces stimulations aversives.
10
Description:D'abord, mes remerciements vont à mes deux directeurs de thèse, les de leur soutien, la quête de solution et de compréhension n'étant pas.