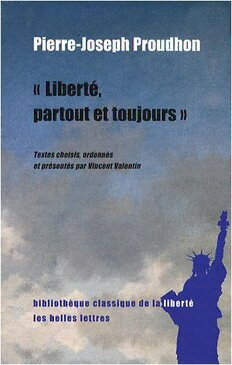Table Of ContentBIBLIOTHÈQUE CLASSIQUE
DE LA LIBERTÉ
Collection dirigée
par
Alain Laurent
DANS LA MÊME COLLECTION
Benjamin Constant,
Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri
Wilhelm von Humboldt,
Essai sur les limites de l'action de l'État
Ludwig von Mises,
Abrégé de L'Action humaine, traité d'économie
Frédéric Bastiat,
Sophismes économiques
Yves Guyot,
La Tyrannie collectiviste
Jacques Necker,
Réflexions philosophiques sur l'égalité
Bruno Leoni,
La Liberté et le Droit
Thomas Jefferson,
Écrits politiques
Michael Oakeshott,
Morale et politique dans l'Europe moderne
Friedrich A. Hayek,
Essais de philosophie, de science politique et d'économie
Édouard Laboulaye,
Le Parti libéral, son programme et son avenir
suivi de La Liberté d'enseignement et les projets de lois
de M. Jules Ferry
Ayn Rand,
La Vertu d'égoïsme
Friedrich A. Hayek,
Nouveaux essais de philosophie, de science politique,
d'économie et d'histoire des idées
«LIBERTÉ,
PARTOUT
ET
TOUJOURS»
La Bibliothèque classique de la Liberté se propose
de publier des textes qui, jusqu'à l'orée de la
seconde moitié du xxe siècle, ont fait date dans
l'histoire de la philosophie politique en appor
tant une contribution essentielle à la promotion
et l'approfondissement de la liberté individuelle
-mais ne sont plus disponibles en librairie ou
sont demeurés ignorés du public français.
Collection de référence et de combat intellectuels
visant entre autres choses à rappeler la réalité et
la richesse d'une tradition libérale française, elle
accueille aussi des rééditions ou des traductions
inédites d'ouvrages d'inspiration conservatrice
« éclairée », anarchisante, libertarienne ou issus
d'une gauche ouverte aux droits de l'individu.
Chaque volume de la collection est précédé
d'une préface présentant le texte et son auteur,
et s'achève sur une chronologie bio-bibliogra
phique de l'auteur et un index sélectif.
PIERRE-JOSEPH PROUDHON
«LIBERTÉ,
PARTOUT
ET
TOUJOURS»
Textes choisis, ordonnés
et présentés par Vincent Valentin
bibliothèque classique de la
les belles lettres
Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation
réservés pour tous les pays.
© 2009, Société d'édition Les Belles Lettres,
95, boulevard Raspail, 75006 Paris.
ISBN: 978-2-251-39048-2
INTRODUCTION
par Vincent Valentin
Proudhon est connu pour être le père de l'anarchisme.
Avant lui, le mot existe mais son usage n'est pas fixé. Il est
le premier, en 1840, à donner à« anarchie» le sens non plus
de désordre mais d'ordre social sans gouvernement. De cette
date jusqu'à sa mort en 1865, de la monarchie de Juillet au
Second Empire, en passant par la révolution de 1848 qui
l'a tant mobilisé, Proudhon va développer le programme
contenu dans ce terme, dans sa dimension critique, atta
quant l'autorité sous toutes ses formes, autant que construc
tive, en jetant les bases d'une société sans État. Par la suite, le
mouvement anarchiste, toutes tendances confondues, s'ins
crira dans son sillage en s'inspirant de ses analyses. Si Max
Stirner proposait dès 1845, dans L'Unique et sa propriété, un
exposé assez complet de l'anarchisme, son influence était
très faible; c'est bien Proudhon que Bakounine et Kropot
kine reconnaissaient comme le premier d'entre eux 1
•
La marginalisat i on politique et intellectuelle de l'anar
chisme pourrait cependant laisser penser que l'œuvre de
Proudhon est la trace d'un moment de l'histoire politique
terminé, qu'elle exprime sans doute une juste révolte et un
bel espoir, mais qu'elle n'a plus rien à nous dire. Ce n'est
1. Cf. notamment J. Maitron, Histoire du mouvement anarchiste en France
(1880-1914), Paris, Société universitaire d'édition et de librairie, 1955.
8 << LIBERTÉ, PARTOUT ET TOUJOURS ,,
pas le cas : sa pensée demeure indispensable et indémoda
ble au moins sur deux points, que sont la critique du pou
voir et la recherche de nouveaux moyens d'émancipation
qui soient ceux ni du libéralisme, ni du socialisme étatiste.
Il ne semble pas que les progrès de la démocratie et de l'État
de droit rendent caduques les réflexions sur la nature du
pouvoir et les fondements de l'obéissance. Les pages que
Proudhon consacre au « principe gouvernemental » n'ont
rien perdu de leur force. Il est toujours utile de rappeler que
le roi est nu, qu'il nous gouverne parce que nous y consen
tons en vertu de représentations de la société discutables
et dont il faudrait au moins avoir conscience. Tout cela
mérite encore d'être médité et débattu, et suffirait à justi
fier de refaire vivre une œuvre largement conçue pour faire
tomber les illusions du peuple quant aux vertus de l'action
politique. Le message de Proudhon, sur ce terrain, est clair :
il ne faut pas attendre l'émancipation et le progrès du suf
frage universel et de la démocratie représentative, du gou
vernement et de l'action politique en général.
Proudhon ne se contente pas de démonter les mécanis
mes de la servitude volontaire, il montre aussi la possibi
lité d'une autre voie, par laquelle l'individu serait libre et la
société juste sans recours à l'État. Il résume cela lui-même
par le mot d'ordre Destruam et Aedificabo - détruire et édifier.
S'il assume sa réputation de« démolisseur», il met en avant,
à la fin de sa vie, le compte des « démonstrations de choses
très positives » 2, par lesquelles il pense avoir montré la pos
sibilité de l'anarchie. Contre l'État et les abus du capital, il
explore une voie révolutionnaire qui épouse le fédéralisme
et le mutuellisme. Il présente sans doute ainsi l'expression
la plus radicale de la volonté de penser l'ordre social à par
tir de la liberté. Son extrême sensibilité à toutes les formes
de pouvoir l'empêche d'accepter les parcelles de coercition
que d'autres, libéraux ou socialistes, admettent comme néces
saires. Sa conviction que la liberté n'est pas seulement une
exigence morale mais aussi un principe actif, une solution
2. Théorie de la propriété, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 214.
INTRODUCTION 9
à la question sociale, lui fait prendre au sérieux l'hypothèse
d'une société dans laquelle chacun n'obéirait réellement qu'à
soi-même, ce qui ne peut être qu'une société sans État.
Simple si on la ramène à la radicalité de son projet, l'œu
vre de Proudhon est cependant d'un accès difficile. La variété
des thèmes, des intentions (philosophiques, militantes, jour
nalistiques), des contextes politiques, l'évolution aussi d'une
pensée qui mûrit, tout cela laisse parfois une impression de
confusion, d'incohérence. L'unité n'est pas facile à saisir.
Aussi, c'est un lieu commun de la critique proudhonienne,
même favorable, de noter ses contradictions, l'exemple le plus
flagrant devant être l'analyse de la propriété privée, tour à
tour rejetée et défendue. On évoque aussi les hésitations à
propos du suffrage universel, écarté comme réactionnaire
mais parfois admis, notamment lorsque Proudhon se fait
élire député en juin 1848. On s'interroge sur sa position quant
au droit au travail, accepté comme juste revendication des
ouvriers, mais rejeté du fait de ce qu'il sous-tend d'atteinte à
la propriété. Étonnant aussi, le recours à la notion d'« État»
pour désigner la structure fédérale devant soutenir la société
idéale, à la fin d'une vie consacrée à la défense de l'anarchie.
Déstabilisante peut-être, la façon dont il mêle apologie de la
concurrence et haine du capitalisme. Les exemples abondent.
Néanmoins, l'affirmation selon laquelle son œuvre est enta
chée d'incohérences, vraie dans les détails, est globalement
superficielle. Sa pensée est complexe, évolutive, parfois le
vocabulaire change, mais elle ne se trahit pas, elle s'affine.
Dans l'ensemble, on préférera parler de richesse plutôt que
de contradiction, et se ranger à l'avis d'É. Dolléans, jugeant
que, « trop nerveuse pour être jamais incertaine ou flottante,
la pensée de Proudhon est en perpétuel mouvement ; mais
à travers ses apparentes contradictions, elle suit une direc
tion générale, semblable à ces fleuves puissants qui en dépit
de leurs méandres s'élancent vers la mer3 ».
Cette richesse, qui a produit des interprétations et des
disciples très différents, à gauche comme à droite, chez les
3. É. Dolléans, Proudhon, Paris, NRF, Gallimard, 1948, p. 322.