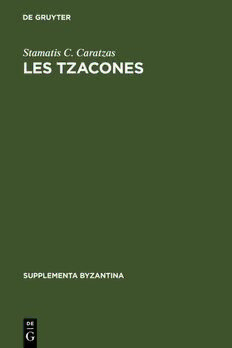Table Of ContentSTAM. G CARATZAS · LES TZACONES
W
DE
G
SUPPLEMENTA ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
TEXTE UND UNTERSUCHUNGEN
HERAUSGEGEBEN VON
H.-G. BECK · A. KAMBYLIS · R. KEYDELL
BAND 4
WALTER DE GRUYTER & CO.
BERLIN · NEW YORK 1976
STAM. C. CARATZAS
LES TZACONES
WALTER DE GRUYTER & CO.
BERLIN · NEW YORK 1976
CIP-Kurxtitäaufnahmt dtr Deutschen Bibliothtk
Caratz as , Stamatis C.
Les Tzacones. — Berlin, New York : de Gruyter,
1976.
(Supplementa Byzantina ; Bd. 4)
ISBN 3-11-004799-3
©
1976 by Walter de Gruyter & Co., vormals G.J. Göschen'sche Verlagahandlung — J.Guttentag,
Verlagsbuchhandlung — Georg Reimer — Karl J. Trüber — Veit & Comp., Berlin 30
Printed in Germany
Alle Hechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne ausdrückliche
Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf photomecha-
nischem Wege (Photokopie, Mikrokopie, Xerekopie) zu vervielfältigen.
Satz und Druck : Walter de Gruyter & Co., Berlin 30
Buchbinder: LUderitz & Bauer, Berlin
BRUNO SNELL
χάλκεα χρυσείων
S. C. c.
Préface
Il y a plus d'une vingtaine d'années, nous avons voulu entrepren-
dre une recherche concernant l'étymologie du mot Τσάκουες, parce
qu'aucun des nombreux travaux consacrés à ce sujet ne nous parais-
sait satisfaisant : leur défaut commun était qu'ils partaient d'un eth-
nique et d'un nom de lieu actuels pour faire l'étymologie d'un mot
qui, à l'époque byzantine, n'était au début qu'un nom de métier.
Nous avons cru nécessaire d'étudier d'abord et d'interpréter cor-
rectement les textes les plus anciens qui mentionnaient les tzacones et
les tzaconies. La lecture de ces textes, la découverte de sources incon-
nues jusqu'à présent et l'approfondissement de l'étude des textes
méconnus nous amenaient à examiner le problème sous plusieurs angles :
histoire, histoire linguistique, histoire d'institutions, histoire religieuse
etc. Comme plusieurs de nos textes n'ont pas été l'object de recherche
de nos prédécesseurs ou ils ont été mal interprétés, nous avons été
obligé de procéder à un examen philologique et historique pour en tirer
les conclusions qui s'imposent.
D'un autre côté, s'agissant de toponymie, nous avons cru indis-
pensable de nous renseigner sur place. Ainsi nous avons parcouru un
territoire s'étendant de la Cappadoce à la Sicile et de la Macédoine au
Péloponnèse, la Crète et Chypre. Les renseignements ainsi recueillis
nous avons dû les contrôler et les consigner dans notre livre pour l'usage
des futurs chercheurs.
Mais le matériel amassé nous obligeait de donner à notre travail
une étendue beaucoup plus grande de celle que nous nous proposions au
moment où nous voulions écrire un article simplement linguistique. Ce
n'était d'ailleurs que très naturel, s'agissant d'une recherche de topo-
nymie et d'anthroponymie, pour laquelle, souvent, la linguistique
seule est insuffisante.
On nous reprochera, peut-être, l'étendue donnée à ce travail.
Malgré tout, nous n'hésitons pas à le présenter sous cette forme; car
nous avons voulu donner une sorte de vademecum pour les recherches
futures concernant le problème de l'origine des Tzacones et des Tza-
conies1. Nous sommes conscients du fait que, dans les détails, il y a lieu
1 L'examen critique de la source No 4, p. 85—97, celui des sources Nos 12 et 33, p.
97—129, paraîtra très long, mais ce que nous disons pourra donner lieu à des recher-
ches ultérieures qui, certainement, apporteront de nouveaux éléments pour la
meilleure compréhension de la question.
Vili Préface
d'approfondir plusieurs points de la question, mais nous avons voulu
dresser l'échafaudage d'un problème qui, probablement, n'intéressera
pas les seuls byzantinistes et néohellénistes.
Durant l'élaboration de ce travail, des questions de détail devaient
nécessairement être résolues, afin que le lecteur et nous-même
puissions nous rendre un compte plus exact de ce que certaines men-
tions de textes, traditions ou simplement allusions d'auteurs signifi-
aient. C'est par exemple le sens qu'on doit attribuer au mot Μακεδόνες
dans un texte inédit de Georges Métochite que S. Sathas explique de
façon fantaisiste ; c'est la foi qu'on doit accorder au voyageur Turc qui
mentionne un nom de lieu Tchaconya entre Molaï et Vatica, c'est à
dire loin de l'actuelle Τσακονιά ; c'est la tradition qui parle de ce même
nom de lieu prétendument donné à un quartier d'un bourg helléno-
phone de Lycaonie, Siili, qui parlerait un dialecte semblable à l'actuel
tzaconien du Péloponnèse; ce sont encore d'autres petits problèmes.
La recherche pour l'éclaircissement de ces problèmes prenait des
proportions ; si elle était placée dans le corps de l'ouvrage, elle risquait
de gâcher son architecture et d'amener le lecteur à perdre le fil de
notre exposé. C'est pourquoi, dans le désir de communiquer aux spécia-
listes le résultat de nos recherches et dans un ouvrage qui pourrait
servir de base pour les futurs chercheurs, nous avons résolu de publier
cette partie de l'ouvrage séparément dans une sorte d'appendice
(= deuxieme partie).
Au cours des années de notre recherche nous avons souvent révélé
à d'autres collègues ce que nous pensions de plusieurs points des
problèmes posés par notre sujet. Il s'ensuivit que des personnes qui
ont pris connaissance de nos points de vue les aient utilisé dans des
travaux publiés entre-temps sans mentionner leur source. Comme il
arrive dans les cas où l'on n'a pas une vue d'ensemble du sujet, ces tra-
vaux, au lieu de contribuer à éclairer les problèmes posés, ils les
embrouillent inutilement. Dommage et ουδείς φθόνος! Parmi les
autres, un ouvrage dont nous avons déconseillé la publication, a vu le
jour en 1972. Il soutient une étymologie différente de la nôtre, ce qui
est légitime. Mais, les 187 pages dont il est composé constituent l'exem-
ple typique de confusion de pensée. Nous en avons rendu compte dans
'Ελληνικά, 26 (1973) 370—376 et Byzantinische Zeitschrift, 68 (1975)
402—404.
Le présent travail, prêt depuis plus d'une décennie, n'a pas pu
être publié à cause des mésaventures de l'auteur2 et faute de fonds.
2 Nos changements continuels de lieu de résidence etc. nous ont rendu impossible le
recours chaque fois aux éditions les plus récentes des textes dans lesquels nous
puisons nos renseignements. Cette situation se reflète parfois dans nos renvois. Nous
nous en excusons auprès de nos lecteurs.
Préface IX
C'est pourquoi nous tenons à remercier vivement nos collègues M. M.
H.-G. Beck, A. Kambylis et R. Keydell qui ont bien voulu l'accepter
dans la Série Supplementa Byzantina qu'ils dirigent. Nous remercions
aussi la Deutsche Forschungsgemeinschaft qui en a subventionné la
publication.
Nous devons un grand merci à nos collègues et amis L. Coutelle et
J. Grillot qui ont revu notre manuscrit français et ont rendu notre
style plus digne des lecteurs internationaux. Le premier a souvent joué
l'avocat du diable, ce qui est une preuve de plus de l'intérêt qu'il a
porté à ce travail.
Le maître à qui cet ouvrage est dédié a le plus grand droit à notre
gratitude: en homme libre, et dans les moments tragiques que nous
avons traversés, en même temps que notre pays d'origine, il a su nous
apporter, comme du temps de notre collaboration à l'Université de
Hambourg, un soutien et un encouragement inestimables.
Enfin nous devons ajouter deux mots sur l'histoire de cette
publication: peu de temps après la correction des épreuves des pre-
mières feuilles typographiques, nous avons été la victime d'un infarctus
du myocarde qui, à trois reprises nous a amené pour de longs mois à
l'hôpital. C'est alors le directeur de Γ Institut d'Etudes Néohelléniques
de l'Université de Thessalonique, M. B. Foris, qui s'est volontiers
chargé de la correction du reste de l'ouvrage. Notre assistante, Mme
Marthe Moros a entrepris de dresser les index des mots et d'autres
travaux du genre. Nous aimerions bien survivre à la publication de
cet ouvrage pour leur témoigner notre reconnaissance.
Table de matières
Page
Préface VII
Sigles et abréviations XIII
PREMIÈRE PARTIE. Sources, étymologie, histoire 1
I. Position du problème 3
II. Examen des étymologies les plus sérieuses 5
1. Difficultés historiques 19
2. Difficultés linguistiques 30
III. Les témoignages des sources 39
1. La tradition écrite jusqu'à la fin du 15 e siècle . . .. 39
2. La tradition orale 65
IV. Examen critique des sources 72
1. La chronique de Monemvasie 72
2. Les autres textes étymologiques 77
3. Le texte bulgare 85
4. Le poème allemand 97
5. La légende athonite 102
V. Etymologie du nom 130
1. Le sens 132
2. La phonétique 136
3. La morphologie 154
VI. L'institution des tzacones 157
1. Datation de l'institution 157
2. Lieu d'apparition de l'institution 168
3. Missions des tzacones 174
4. Emoluments et privilèges des tzacones 191
5. Uniforme et emblème des tzacones 195