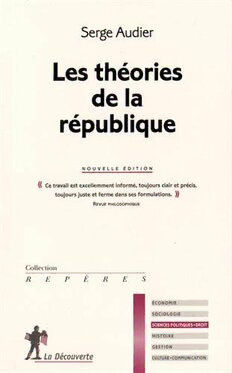Table Of ContentSerge Audier
Les théories
de la république
NOUVELLE ÉDITION
t.a Découverte
9 bis, rue Abel-Hovelacque
75013 Paris
Remerciements. Je remercie Pascal Combemale et Philippe Chanial pour
leur relecture attentive et leurs conseils. Il va de soi que je suis seul respon
sable des choix et des imperfections qui demeurent.
Merci aussi à Alain Boyer, ainsi qu'à Stéphane Chauvier, qui m'ont
associé à leur recherche lors d'un colloque pionnier, organisé à l'université
de Caen en 1998, autour du renouveau républicain contemporain.
Ce livre a été voulu et suivi, dès l'origine, par Jean-Paul Piriou. Sans
son soutien et ses encouragements, il n'aurait pas existé. Je le dédie à sa
mémoire.
Si
vous désirez être tenu régulièrement informé des parutions de la collection
«Repères», il vous suffit de vous abonner gratuitement à notre lettre d'information
mensuelle par courriel, à partir de notre site http:// www.collectlonreperes.com,
où vous retrouverez l'ensemble de notre catalogue.
ISBN : 978-2-7071-7850-3
1?'1\ DANGER Ce logo a pour objet d'alerter le lecteur sur la menace que repré-
u sente pour l'avenir du livre, tout particulièrement dans le
~PK:~ domaine des sciences humaines et sociales, le développement
massif du photocopillage. Nous rappelons donc qu'en applica
tion des articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle, toute
photocopie à usage collectif, intégrale ou partielle, du présent ouvrage est interdite
sans autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue
des Grands-Augustins, 75006 Paris). Toute autre forme de reproduction, intégrale ou
partielle, est également interdite sans autorisation de l'éditeur.
© Éditions La Découverte, Paris, 2004, 2015.
Introduction : le retour du républicanisme
Une
des mutations intellectuelles des dernières décennies du
xx• siècle aura été le retour de l'idée républicaine. Si elle n'a
jamais déserté le vocabulaire politique, elle avait rarement fait
l'objet d'investigations philosophiques rigoureuses depuis le
début du siècle. Dans les travaux anglophones, le républica
nisme était en partie oublié, au point d'être absent des diction
naires de philosophie politique. En France, bien que le discours
républicain ait perduré, l'effort de conceptualisation est tombé
en sommeil. Les raisons de cet effacement sont complexes.
L'une d'elles tient à la montée des critiques socialistes et surtout
marxistes du libéralisme, reléguant dans l'ombre la référence
républicaine. Le poids de la science politique, des sciences
sociales ou de certains courants philosophiques - de Michel
Foucault au « postmodernisme » - a aussi contribué à recou
vrir une tradition politique perçue comme dépassée. En effet,
le républicanisme semble peu scientifique et très ancien, nous
ramenant à l'Antiquité avec ses valeurs centrales du bien
commun, de la vertu civique et du règne des lois.
Cependant, le regain d'intérêt pour le républicanisme a été
préparé de longue date, sous des modalités diverses, au cours
du xx• siècle. Une esquisse historiographique est déjà instruc
tive quant aux usages et traditions politiques hétérogènes qui
ont mobilisé l'héritage républicain. Dans le champ académique
anglophone, le retour du républicanisme a été précédé d'investi
gations sur l'« humanisme civique » de la Renaissance. Un rôle
clé revient ici à Hans Baron (1900-1988). Ce grand historien alle
mand, puis américain, de la Renaissance et des idées républi
caines était aussi un intellectuel juif soucieux de la fragilité de la
4 lES THÉORIES DE LA RÉPUBLIQUE
République de Weimar et bouleversé par l'arrivée d'Hitler au
pouvoir. Son travail prend le contre-pied de celui de l'historien
jacob Burckhardt qui avait centré son analyse de la Renaissance
sur l'individualisme. Baron insiste, lui, sur la culture civique des
petites cités républicaines et sur la combinaison entre forma
tion classique et nouvelle mentalité bourgeoise des milieux
marchands de Florence. Dès les années 1920, il parle d'« huma
nisme civique » (plus précisément, de Bürgerhumanismus) pour
définir sa vision du républicanisme et il persistera après son exil
américain [Baron, 1955, 1988]*, exerçant une influence considé
rable dans les milieux intellectuels. Cette exhumation du répu
blicanisme sera bientôt enrichie des travaux sur la tradition
anglaise du xvne siècle de Zera Fink [1945] et Carolyn Robbins
[1959]. Les recherches sur la République de Venise par les
Américains Frederic C. Lane et William j. Bouwsma apportent
aussi, dès les années 1960-1970, un nouvel éclairage à ces
problématiques.
Mais ce sont surtout les investigations consacrées à la tradi
tion politique et aux sources de la Révolution américaine qui
réactivent la référence au républicanisme : les historiens Bernard
Baylin [1967] et Gordon Wood [1969], chacun à leur façon,
combattent la conviction selon laquelle les idéaux américains
procéderaient seulement d'une culture des droits naturels propre
au libéralisme de John Locke. Autour des thèmes de la vertu,
de la corruption et du bien commun, un républicanisme venu
d'Angleterre et d'Europe aurait inspiré les révolutionnaires
américains. Les enjeux théoriques et politiques de ce « révision
nisme républicain» trouvent une expression saisissante avec la
fresque controversée de john Pocock (né en 1924), Le Moment
machiavélien, paru en 1975 :dans sa quête d'un langage républi
cain remontant à Aristote et à l'idéal de l'homme comme
«animal politique», l'historien veut reconstruire un récit alter
natif au paradigme libéral, en focalisant son approche interna
tionale - de la Renaissance aux États-Unis en passant par
l'Angleterre - autour des idées de vertu et de civisme. Avec
Pocock, l'« humanisme civique » se teinte d'une tonalité ant i
libérale, au moment même où le débat normatif se diffuse dans
le monde anglophone, depuis la publication de la Théorie de la
* Les références entre crochets renvoient à la bibliographie en fin d'ouvrage.
INTRODUCTION 5
justice de John Rawls en 1971, autour des forces et des limites du
libéralisme. Combinée à des enjeux de méthodologie histo
rique, cette recherche se reconfigure avec les travaux de l'école
de Cambridge et du « néo-républicanisme » - Quentin Skinner,
Maurizio Viroli ou Philip Pettit - qui puisent dans le passé une
vision républicaine de la liberté alternative au libéralisme. Bien
d'autres actualisations du républicanisme seront proposées, de
facture tantôt juridique et libérale, tantôt communautaire.
En Europe, la redécouverte du républicanisme a emprunté
d'autres voies. En France, des historiens soucieux de la chose
publique, comme Maurice Aghulon (1926-2014) et surtout le
spécialiste de la Rome antique Claude Nicolet (1930-2010), ont
marqué ce domaine. Le jeune Nicolet avait été un de ces univer
sitaires et intellectuels qui s'étaient engagés dans le Parti radical
après l'appel de Pierre Mendès France en 1954. Il participe à
l'aventure des Cahiers de la République qui redessine les contours
d'une gauche modernisée et ouverte, entre communisme
marxiste d'un côté et gaullisme de l'autre, mais aussi à distance
des libéraux. Publié dès 1957, son livre de la collection «Que
sais-je?», Le Radicalisme, ouvre un champ de recherches qui
aboutira à son ouvrage majeur de 1982, L'Idée républicaine en
France, qui redécouvre la pensée des républicains de laIne Répu
blique. Ici, le républicanisme est indissociable d'une certaine
apologie du rôle de l'État, de la rationalité scientifique et de la
laïcité.
Différents furent les chemins du retour du républicanisme en
Italie. La plus grande figure dans ce domaine - peut-être même
au plan international - est l'historien Franco Venturi
(1914-1994) dont la trajectoire fut marquée par les idéaux répu
blicains du socialisme antifasciste et libéral: dès les années 1930,
il participe au groupe antifasciste Giustizia e Libertà, puis au
Parti d'action (Partito d' Azione), foyer du renouveau démocra
tique et républicain de l'Italie. Cet admirateur des Lumières, qui
consacra sa thèse à la jeunesse de Diderot, a scruté toute sa vie la
façon dont les combats pour la liberté intellectuelle et politique
se sont diffusés en Europe. Se méfiant d'une pure histoire des
idées, il a insisté sur l'ancrage historique des idéaux républicains,
avec les expériences concrètes des Républiques de Gênes ou de
Venise, encore au xvm• siècle [Venturi, 1970]. Manière égale
ment de relativiser une vision trop centrée sur l'Antiquité, mais
aussi sur l'hégémonie révolutionnaire française ...
6 LES THÉORIES DE LA RÉPUBLIQUE
L'historiographie du républicanisme invite donc à ne pas
privilégier une seule aire géographique et nationale, à ne pas
essentialiser hâtivement la République et à prendre conscience
qu'il y a plusieurs manières d'en élucider l'histoire et la philo
sophie pour en dégager d'éventuelles leçons politiques. Suivant
les avertissements de Venturi, on restituera ici les grandes étapes
du républicanisme en évitant de céder à une histoire trop
linéaire- celle de Pocock ou de l'école de Cambridge- qui
fixerait les traits d'un républicanisme pérenne depuis Athènes
et Rome jusqu'à nos jours, traversant l'histoire avec une relative
permanence. On évitera ici de gommer les éléments attestant
la diversité, les débats et les discontinuités de cette tradition.
Notre détour historique - de l'Antiquité à la Renaissance
(chapitre I), puis du républicanisme britannique jusqu'aux révo
lutions française et américaine (chapitre II), et, enfin, au
xix• siècle (chapitre m) - repérera certaines des mutations de
l'« idée républicaine ». Un examen qui s'impose d'autant plus
que les philosophes contemporains du républicanisme mobili
sent cette tradition pour définir leur position comme une alter
native au libéralisme. On se demandera s'ils y sont parvenus,
en dégageant les enjeux du débat sur l'actualité de ce para
digme (chapitre IV). Si le républicanisme a pour spécificité une
conception de la politique qui vise le bien commun ou l'intérêt
général, il se décline de façon hétérogène. Sous plusieurs angles
- le passage à la modernité politique, le rapport au libéra
lisme et aux droits fondamentaux, la manière d'accueillir ou de
rejeter la conflictualité -, on peut en faire ressortir la diversité
et la complexité. Il s'agit sans doute là d'un préalable indispen
sable pour élucider ce que peut signifier, aujourd'hui, une posi
tion philosophique et politique qui se dit «républicaine».
1 1 Aux sources du républicanisme :
les idéaux antiques et leurs reformulations
à la Renaissance
Genèse de l'idée de res publica
Le mot «république», de l'expression res publica, a un sens
complexe, désignant « l'activité publique », « les affaires
publiques», « l'intérêt public », « la communauté constituée par
le peuple». La res publica, antithèse de res privata, désignait dans le
monde romain les biens du domaine public servant aux néces
sités et à la vie politique de la cité, mais son sens était bien plus
large - juridique, symbolique et politique [Stark, 193 7 ; Poma,
1998; Kharkhordin, 2009; Moatti, 2009]. En un sens, les idées
républicaines remontent à l'Antiquité grecque, mais « res publica »
n'y a pas de strict équivalent. Quand les Romains traduisent en
grec «res pub/ica», ils usent parfois de l'expression «ta dèmosia
pragmata », «les choses du peuple». Un équivalent grec semble
être« to koinon »,la« communauté», ou « to koinon agathon», le
«bien commun>> [Schofield, 2001]. En tout cas, la genèse de l'idée
républicaine est indissociable de la naissance de la politique avec
la démocratie athénienne. C'est en effet en Grèce que s'invente
une notion de la politique comme domaine spécifique, à partir du
clivage entre les affaires communes (to koinon) et ce qui appartient
au particulier (to idion), dont le lieu est la famille (oikos). L'idée de
république trouve aussi une origine lointaine dans l'idée de liberté
(éleutheria), antithèse de la servitude.
Aristote : la cité, communauté de citoyens
La source philosophique majeure du républicanisme se
trouve, davantage que dans la typologie des régimes de Platon,
8 LES THÉORIES DE LA RÉPUBLIQUE
chez Aristote (384-322 av. j.-C.), qui anticipe la philosophie
de la république en distinguant, dans La Politique (Politika),
les régimes qui visent le « bien commun » et ceux qui sont au
service du « bien particulier » des gouvernants.
Alors qu'Aristote écrit dans une période où la cité grecque
(polis) rencontre les monarchies hellénistiques, il voit encore en
celle-ci le lieu de réalisation de l'excellence humaine. La cité est
une communauté (koinonia) qui se différencie essentiellement
des parties que sont la «famille» et le «village». Critiquant
Socrate et Platon, Aristote réfute ainsi « ceux qui croient que chef
politique (politikos), chef royal (basilikos), chef de famille (oikono
mikos) et maître d'esclaves (despotikos) sont une seule et même
notion». Ainsi se dessinent deux grands types d'autorité qui
seront au centre du républicanisme : celle « despotique »,
exercée par le maître (le despotes) sur ses esclaves, et celle propre
ment« politique)), exercée par le chef qui gouverne (le politikos).
La famille, unité de base de la cité, résulte de l'instinct de
reproduction et de celui de conservation. Elle inclut le rapport
entre maître et esclave (qui est tel par nature), dont l'association
vise la satisfaction des besoins quotidiens. Toutefois, la famille
ne se suffit pas à elle-même, et implique une communauté plus
large, le village. Reste que ni la famille ni le village ne permet
tent la réalisation des finalités les plus hautes de l'être humain.
Seule la cité, grâce aux lois et aux institutions politiques, permet
à chacun de dépasser son égoïsme pour vivre conformément
non pas à ce qui est subjectivement bon, mais à ce qui l'est
objectivement. Car la cité a pour finalité ultime la réalisation de
la« vie bonne)) (eu zèn). Si donc elle apparaît en dernier, la cité
est en vérité première. Selon sa philosophie« finaliste))' Aristote
considère que la cité accomplit la finalité des autres commu
nautés. Elle n'est pas une réalité artificielle-issue d'une conven
tion -, mais naturelle et autosuffisante. Et elle est antérieure à
l'individu, car ce n'est qu'au sein de l'institution politique que
l'homme réalise sa finalité propre. Ainsi s'explique la définition
aristotélicienne de l'homme comme « animal politique )) (zôon
politikon) : la nature« ne fait rien en vain» et les hommes sont
les seuls à posséder la parole, ce qui implique que leur finalité est
de mettre en commun leurs idées du juste et de l'injuste.
La cité est une communauté de citoyens. Le critère de la citoyen
neté n'est pas seulement le fait d'habiter un territoire, ou de
pouvoir prendre part à une action juridique, mais la participation
AUX SOURCES DU RÉPUBliCANISME 9
aux fd,nctions judiciaires et aux fonctions publiques en général.
Certes~ cette définition connaît des variations selon les régimes,
et elle !s'adapte particulièrement à la démocratie athénienne. La
pratiq"(le de la « rotation des charges » est en effet au centre de
cette cbnception de la citoyenneté, en écho aux principes démo
cratiqt,les grecs : le citoyen doit être à tour de rôle gouvernant
et gouyerné, ce qui nécessite un fort investissement dans la vie
publiq(ue. Ainsi sont exclus de la citoyenneté non seulement les
esclav~s, les étrangers, les métèques, mais aussi les artisans.
Aristote avance dans le livre III de La Politique une typologie
qui ndurrira la tradition républicaine. Il y a en effet trois types
de « c~nstitutions » - traduction imprécise du mot politeia,
correspondant plutôt au terme «régime» - selon que l'auto
rité souveraine est entre les mains ou bien d'un seul, ou bien
du pe~t nombre, ou bien de la masse des citoyens. Mais, à ce
critère! quantitatif (dont Aristote montre ensuite la dimension
sociale~ s'ajoute un critère qualitatif, entre constitution« droite»
et« déViée». Dans le premier cas, le gouvernement a pour objet
l'intérêt commun; dans le second, il ne vise que l'intérêt particulier
-qu'ill s'agisse de celui d'un seul, de plusieurs, ou de la masse.
Il y a ~insi trois formes « bonnes » de constitutions : la monar
chie, 11aristocratie et la politeia (ce qu'on a souvent traduit, en
italien~ français ou allemand, par« république», ou« gouverne
ment donstitutionnel » comme régime « droit » de la majorité).
1
Et il y ~ aussi trois formes « mauvaises » : la tyrannie, l'oligarchie
et la dfmocratie. Les interprètes et traducteurs ont souvent été
intrigu~s par le fait qu'Aristote utilise volontairement le même
mot, p'pliteia, pour désigner à la fois les diverses constitutions
et la constitution « droite » du plus grand nombre. Certains ont
jugé priudent de garder le mot grec, tout en précisant qu'il s'agis
sait del « l'authentique forme de gouvernement républicain »
[Bien, IJ980]. Déjà au temps de la Renaissance italienne, on
traduitl parfois politeia chez Aristote par « république ».
Aris~ote ne donne certes pas de réponse simple à la question
de sav9ir quelle constitution est la meilleure. En tout cas, à
condi~on d'être «droite», chacune est, à sa manière, un bon
régime~ son objet étant le bien commun et non le bien particu
lier de~ gouvernants. S'il se trouve, dans une cité, un homme
aux qu~lités extraordinaires pour gouverner, c'est à lui que doit
revenit le pouvoir monarchique. De même, si un groupe
d'hommes montre des vertus exceptionnelles, le pouvoir