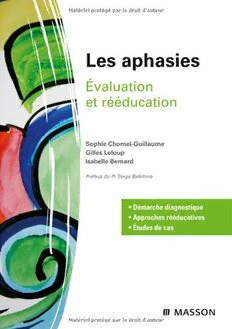Table Of ContentLes aphasies
Évaluation et rééducation
Chez le même éditeur
Neuropsychologie et troubles des apprentissages, par M. Mazeau. 2009, 320 pages.
La rééducation du langage de l’enfant, par C. Thoulon-Page. 2009, 216 pages
Traumatismes psychiques, par L. Crocq. 2007, 328 pages.
Les bilans de langage et de voix, par F. Estienne, B. Piérart et coll. 2006, 312 pages.
Le langage de l’enfant, par C. Chevrie-Muller. 2006, 480 pages.
Troubles fonctionnels et somatisation, par P. Cathébras. 2006, 256 pages.
Troubles dysphasiques, par G. De Weck, M.C Rosat. 2003, 240 pages.
Les aphasies
Évaluation et rééducation
Sophie Chomel-Guillaume
Gilles Leloup
Isabelle Bernard
Avec la collaboration de
Isabelle Riva et Carolyne François-Guinaud
Ce logo a pour objet d’alerter le lecteur sur la menace que repré-
sente pour l’avenir de l’écrit, tout particulièrement dans le domaine
universitaire, le développement massif du « photo-copillage ».
Cette pratique qui s’est généralisée, notamment dans les établisse-
ments d’enseignement, provoque une baisse brutale des achats de
livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des
œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd’hui
menacée.
Nous rappelons donc que la reproduction et la vente sans autorisa-
tion, ainsi que le recel, sont passibles de poursuites. Les demandes
d’autorisation de photocopier doivent être adressées à l’éditeur ou
au Centre français d’exploitation du droit de copie : 20, rue des
Grands-Augustins, 75006 Paris. Tél. 01 44 07 47 70.
Remerciements à nos familles et nos amis pour leur soutien et leur aide précieuse.
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées
dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont
autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective et, d’autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d’information
de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété
intellectuelle).
© 2010, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
ISBN : 978-2-294-08852-0
Elsevier Masson SAS, 62, rue Camille-Desmoulins, 92442 Issy-les-Moulineaux cedex
www.elsevier-masson.fr
V
Préface
Depuis la publication de la référence que constitue encore l’ouvrage L’aphasie coor-
donné par les regrettés André Roch-Lecours et François Lhermitte (Flammarion,
1979), de nombreux ouvrages consacrés aux troubles aphasiques ont été publiés tant
en français, qu’en anglais. L’immense majorité, néanmoins, était consacrée aux aspects
purement cognitifs de cette pathologie et bien peu abordaient les aspects rééducatifs.
L’ouvrage publié par Sophie Chomel-Guillaume, Gilles Leloup et Isabelle Bernard vient
à point nommé combler ce manque.
Les auteurs ont su réunir dans un ouvrage concis tous les éléments permettant de
disposer de bases solides pour aborder une des fonctions les plus complexes du cer-
veau humain. En effet, le langage et la communication sont, chez l’homme, à l’inter-
face de multiples processus sensori-moteurs, cognitifs et émotionnels. Ces processus
reposent sur l’intégrité de nombreuses régions hémisphériques (réseaux corticaux
et sous-corticaux, voies de communications de la substance blanche), mais aussi
de structures cérébelleuses et du tronc cérébral, comme de nombreuses structures
sous-jacentes.
Les connaissances sur ce système complexe ont été lentement acquises, comme le
rappelle opportunément le premier chapitre de ce livre. Les avancées ont longtemps
reposé sur l’étude des patients cérébrolésés, en particulier d’origine vasculaire.
Ce n’est que très récemment que les progrès de l’imagerie cérébrale fonctionnelle
(d’abord en médecine nucléaire, puis en IRM fonctionnelle) ont permis d’appréhen-
der in vivo chez le sujet sain les structures cérébrales impliquées dans le fonctionne-
ment normal du langage. Ces techniques ont aussi permis de confronter les modèles
cognitivistes à « la réalité neuronale ». Ces éléments sont clairement présentés dans
le deuxième chapitre.
L’apport le plus important de l’ouvrage tient dans les chapitres suivants qui illustrent la
démarche diagnostique et la mise en œuvre de la remédiation des troubles de la parole
et du langage. La qualité de cette dernière partie tient à la réunion de trois compétences
remarquables, réunion qui à mon sens était indispensable pour obtenir un résultat
de cette qualité, à savoir celle de deux orthophonistes de haut niveau et d’une neu-
rologue très expérimentée en neuropsychologie. Lorsque j’étais en charge du Centre
du Langage et de Neuropsychologie à La Salpêtrière, j’ai eu le plaisir de travailler de
nombreuses années avec Sophie Guillaume-Chomel, de collaborer avec Gilles Leloup
dans le cadre d’un réseau d’aphasiologie, et de contribuer à la formation d’Isabelle
Bernard, expliquant sans doute qu’ils m’aient fait tout trois le plaisir et l’honneur de
me demander cette préface.
Je pense que tous ceux qui s’intéressent à l’aphasie et à sa prise en charge, ortho-
phonistes, neuropsychologues, neurologues, médecins rééducateurs et étudiants de
ces diverses disciplines trouveront dans cet ouvrage de quoi répondre à la majorité
de leur questions et alimenter leur curiosité. Les cas cliniques proposés à la fin de
l’ouvrage leur permettront aussi de tester leurs connaissances sur des situations
concrètes.
Cet accomplissement me réjouit doublement, d’une part en raison de la qualité
incontestable du résultat, mais aussi par l’implication d’une équipe faisant interagir
VI
neurologue et orthophonistes en une équipe soudée, comme cela devrait l’être dans la
prise en charge concrète de cette pathologie.
Pour finir, je souhaite un succès mérité à cet ouvrage et de nombreuses rééditions, pour
tenir compte des progrès qui ne peuvent manquer de survenir dans cette discipline.
Pr Serge BAKCHINE
Reims, le 5 octobre 2009
V
La rééducation de l’aphasie
chez l’adulte
162
Introduction
L
es chapitres précédents ont montré, si le lecteur n’en avait déjà pas conscience,
la complexité de diagnostiquer les aphasies et l’intérêt d’une démarche diagnos-
tique s’appuyant sur les examens neurologiques, aphasiologique et neuropsycho-
logiques. La difficulté du diagnostic n’a pas de commune mesure avec la nouvelle
tâche qui attend le thérapeute qui est de construire des axes de remédiation et de
les appliquer sur le long cours avec les patients cérébro-lésés. Nous avons tenté
de montrer que les évaluations sont le point de départ de la rééducation, non pas
comme un relevé des troubles mais comme une compréhension du dysfonctionne-
ment cognitif et comportemental du patient. Cette synthèse des performances aux
tests définit la ligne de base du travail rééducatif. Les mécanismes de récupération
vont dépendre de différentes variables telles que l’âge, le sexe, la latéralisation,
le niveau de scolarisation et plus particulièrement les concepts de plasticité et de
flexibilité. Ce chapitre présente les bases d’une réflexion sur la conduite de réédu-
cation aphasiologique en exposant les mécanismes de récupération cérébrale, ainsi
que les étapes de la démarche clinique à partir du diagnostic jusqu’à l’évaluation
de l’efficacité thérapeutique. Les différentes approches rééducatives contemporai-
nes sont également exposées.
I
De l’histoire des aphasies
à une réflexion clinique
moderne