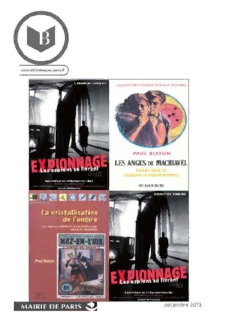Table Of ContentPAUL BlfTON
LES ANGES DE MACHIAVEL
Après un doctorat à l'École Pratique des Hautes études à Paris sous
la direction de Roland Barthes, des expériences d'enseignement en
lycée technique en France, au Collège Stanislas de Montréal et à
l'Université McGill, Paul Bleton œuvre depuis 1982 à la TÉLUQ
(l'université à distance de l'Université du Québec), où il est
professeur titulaire en lettres.
Ce travail de Paul Bleton a été communiqué à la Bibliothèque des
littératures policières et d’espionnage dans le cadre de son
exposition :
EXpionnage, les espions se livrent
(du 15 novembre 2013 au 24 mars 2014)
Exposition conçue et réalisée avec Bruno Fuligni, écrivain,
historien, auteur de Dans les archives inédites des services secrets
et du Livre des espions, aux éditions L’iconoclaste.
À partir des fonds de la bibliothèque, mais aussi des collections
historiques des services français, l'exposition se propose de
dévoiler la relation trouble et complexe entre les services de
renseignement et l’écrit, de 1800 à 1989.
Les anges de Machiavel
140 ans de fiction d’espionnage en France
Paul Bleton
Paul Bleton, Les anges de Machiavel.
SOMMAIRE
FICTION D’ESPIONNAGE ? ............................................ 4
LE SECOND PLUS VIEUX MÉTIER DU MONDE ? ..................... 6
Effectivement, Il y avait bien eu… ................................ 6
Le franc-tireur de la nuit. ........................................... 8
Premières variations sur le thème. ................................ 9
Espions sériels. ....................................................... 12
L’ENTRE-DEUX-GUERRES ............................................ 15
L’émancipation du genre. .......................................... 15
LA GUERRE FROIDE .................................................. 18
Hésitant retour. ...................................................... 18
L’âge d’or des collections. ......................................... 19
La crise 007 ........................................................... 25
UNE NOUVELLE CONFIGURATION .................................. 29
Et après les collections ? ........................................... 29
BD,TV : intégration de l’espion à la culture médiatique ? ... 30
En contraste, le cinéma… .......................................... 33
Un Changement de la garde ....................................... 35
DEMAIN ? ............................................................... 44
Pour en savoir plus : ................................................ 46
Paul Bleton, Les anges de Machiavel.
FICTION D’ESPIONNAGE ?
La fiction d’espionnage occupe aujourd’hui un espace compris
entre l’exténuation du récit que proposent les jeux vidéo et la
narration sérieuse, voire sourcilleuse, de l’espionnage réel.
D’un côté, DARK, No One Lives Forever, Secret Services, GoldenEye
: Au service du Mal, CellFactor: Revolution, Mission Impossible,
Syphon Filter ; voire jeux déclinés en plusieurs versions comme
Project IGI, Splinter Cell, Metal Gear, James Bond 007... Pour les
joueurs, plus qu’à la guerre secrète réelle, c'est de films, de séries
télévisées, de BD (comme XIII, rare jeu français, créé à partir de la
série de Jean Van Hamme et William Vance) que ces jeux doivent
leur univers ; et aux formes concurrentes de jeux vidéo qu’ils se
comparent – combat de rue, guerre des étoiles, châteaux de
Zelda…
D’un autre côté, les ouvrages de témoins, historiens,
encyclopédistes servant de mémoire, de conservatoire à
l’espionnage réel :
• Ouvrages techniques, comme Michel Auer et Eaton S.
Lothrop (1978), Georges Moréas (1990), Gérard Desmaretz (1999),
Alain Charret (2006).
• Ouvrages vulgarisateurs, comme Kurt Singer (1963), David
Wise et Thomas Ross (1975), Jean-Pierre Alem (1980, 1987), Jean-
Jacques Cécile (2005).
• Synthèses thématiques, comme Vernon Hinchley (1969),
Jacques Bergier (1971, 1973), Jacques Bergier et Jean-Philippe
Delaban (1973), Roger Faligot et Remi Kauffer (1983), Bertrand
Warusfel (2000), général Jean Guyaux (2002), Frédéric Moser et
Marc Borry (2002).
• Synthèses historiques, comme Stewart Alsop et Thomas
Braden (1964), Pierre Faillant de Villemarest (1969), Jean-Pierre
Alem (1977), Pascal Krop (1994), David J. Alvarez (1999), Genovefa
Étienne et Claude Moniquet (2000, 2002), Rodney Carlisle (2007).
• Histoire anecdotique, historiographie et études de cas,
comme Allen Dulles (1969), Janusz Piekalkiewicz (1977), Joseph
Doudot (1977), Kirill Khenkin (1981), Fabrizio Calvi et Olivier
Fiction d’espionnage ? 4
Paul Bleton, Les anges de Machiavel.
Schmidt (1988), Gilbert Bloch (1999), Jean Deuve (2000), Jean
Guisnel (2002).
• Dictionnaires – ceux où l’ordre alphabétique n’est qu’un
artifice de présentation, comme Nicolas Fournier et Edmond
Legrand (1979), Ronald Payne Christopher Dobson (1985), ou réels
dictionnaires comme le bilingue de Jean-Paul Brunet (2000) ou
l’encyclopédique de Thierry Vareilles (2001).
• Colloques savants, comme le recueil du Centre d'études
d'histoire de la défense, Commission Histoire du renseignement
(2000).
Première approximation :
Entre jeu et savoir, prenant pour objet la guerre secrète, version
vénéneuse des relations internationales, la fiction d’espionnage a
d’abord emprunté des formes de la narration populaire à des
genres qui l’avaient précédée (l’action au roman d’aventures,
l’enquête au roman policier), quitte à ultérieurement innover avec
l’intrigue du démontage d’une intoxication.
Une certaine plasticité idéologique lui vient des proportions
relatives de trois discours que chaque roman amalgame : « les faits
parlent d’eux-mêmes » de l’immanentisme libéral, « la remise en
cause du délicat équilibre actuel conduira à la catastrophe » du
conservatisme, « tout est la faute d’une cause cryptique et
malveillante qu’il faut inlassablement dénoncer » du
ressentiment.
Elle doit son paradoxe fondateur de s’ancrer dans la culture
médiatique, transparente, grand public, alors qu’elle évoque des
choses tenues jalousement secrètes par les États : comment un
genre fictionnel dépeignant un milieu professionnel ésotérique,
dépendant d’appareils d’État énigmatiques, livrant des guerres
secrètes aux objectifs inquiétants, apocalyptiques mais flous, en
est venu à plaire au public de la culture médiatique, elle-même
très exotérique ?
Voilà qui pourrait permettre de dévider un fil historique remontant
au choc de la défaite de 1870.
Fiction d’espionnage ? 5
Paul Bleton, Les anges de Machiavel.
LE SECOND PLUS VIEUX MÉTIER DU MONDE ?
Mais pourquoi se contenter de 140 ans, alors que l’espionnage a
cette sulfureuse réputation de s’enraciner dans un passé bien plus
archaïque ?
Effectivement, Il y avait bien eu…
Par la scène primitive que mobilise le mot, le regard caché d'un
agent fixé sur un patient sans défiance, cet agent (secret) se
trouve à l'intersection de plusieurs logiques :
• Militaire – l'espion se définit par rapport à l'éclaireur, au
soldat en service commandé, au déserteur, etc.
• Policière – il se définit par rapport au policier, à la mouche,
au délateur, etc.
• Politique – il se définit par rapport au diplomate, au traître,
etc.
• Éthico-psychologique – il se définit par rapport à l'indiscret,
au fouineur, au jaloux, etc.
Et depuis l’origine, l’espionnage traîne une connotation péjorative
étroitement attachée à la fonction – « l'infamie nécessaire de
l'espion fait juger de l'infamie de la chose », Montesquieu… Infâme,
peut-être, mais nécessaire. L’espionnage est en effet discuté,
raconté, recommandé, théorisé depuis longtemps :
• Dans L’Art de la guerre de Sun Tzu, paru au IVe siècle avant
notre ère, sans doute le plus ancien traité de stratégie au monde.
• Avec l’Arthashastra [l'« Enseignement du profit »], le
brahmane Chanakya, surnommé Kautilya [le Retors], rédige le
premier traité de réalisme politique connu. Chandragupta, en
réponse aux conquêtes d’Alexandre, devait fonder l’empire
Maurya, conquérir l’empire Nanda battu par les Macédoniens,
éliminer les satrapes laissés par Alexandre dans le nord-ouest de
l’Inde, enfin conquérir presque tout le sous-continent. Et Kautilya
était son conseiller…
Le second plus vieux métier du monde ? 6
Paul Bleton, Les anges de Machiavel.
• Dans Stratagèmes, Frontin (Julius Frontinus) commence les
quatre livres de son traité par l'art de cacher ses entreprises et de
découvrir celles de l'ennemi, et ne néglige pas son pendant, la
conduite à tenir à l'égard des transfuges et des traîtres.
• Dans Nombres (XIII), Moïse envoie une mission de
reconnaissance dans le pays de Canaan, sur l’ordre de Yahvé. Après
quarante jours, de retour à Cadès, les éclaireurs choisis pour
représenter les douze tribus reviennent avec des opinions divisées :
bien que le pays « ruisselle de lait et de miel », « le peuple qui
l'habite est puissant ». Sauf Caleb qui se prononce pour l’invasion,
les autres défendent une opinion de prudence en distordant ce
qu’ils ont observé.
• Dans Josué (II, 1-21), Josué expédie deux espions dans
Jéricho. Rahab, la courtisane qui les cache et les aidera à fuir, leur
décrit l’état d’esprit calamiteux des habitants de la ville, apeurés
par les épisodes de la traversée de la Mer Rouge et des défaites des
Amorrhéens de Séhon et de Og, roi de Basan ; information
déterminante pour la suite du projet d’invasion. Rahab ment aux
soldats pour sauver les deux espions ennemis, alliance des deux
plus anciens métiers du monde ; indirectement, ce mensonge
mènera les compatriotes de Rahab à leur perte. Péché ? Sans doute
pas si l’on en croit l’abondance de commentaires rabbiniques ou
chrétiens sur ce point ; de mécréante et pécheresse, voilà la
prostituée convertie et devenue, selon telle tradition, épouse de
Josué, selon telle autre prophétesse. Il suffit de mentir pour le bon
dieu.
Mais attention :
• La première rencontre de l’espion et d’un genre littéraire
en français n’a pas institué le roman d’espionnage. Gian-Paolo
Marana, dans L'Espion Du Grand-Seigneur, Et Ses Relations Secrètes
: Envoyées au Divan de Constantinople, et découvertes à Paris,
pendant le Règne de Louis le Grand (1684) invente, avec l’espion,
l’artifice narratif d’un regard culturellement extérieur et
philosophiquement critique. Cette variante du roman épistolaire
sera immortalisée par Les lettres persanes (1721) de Montesquieu.
Le second plus vieux métier du monde ? 7
Paul Bleton, Les anges de Machiavel.
• Dans L’Espion de police (1826) d’Étienne-Léon baron de
Lamothe-Langon, l’espion est un mouchard de police. En outre, ce
premier roman de mœurs insiste sur la seule dimension éthique,
méprisable, de ce type romanesque.
Le franc-tireur de la nuit.
Les défaites de l'été 1870 contre la Prusse et l’occupation inspirent
moins de romans marquants que le siège de Paris, ou la Commune.
Mais un genre patriotique exaltant l'héroïsme des vaincus fait florès
dans la décennie soixante-dix ; il efface la défaite par
d’innombrables victoires en escarmouche. Remémoration
douloureuse, dénégatrice, rassurante : oui, une revanche est
possible. Par leur conduite, ces braves défaits qui ne méritaient
pas de l'être serviront de modèle aux jeunes générations. Ces récits
ont pour héros le franc-tireur.
Ce genre émule les Romans nationaux d’Erckmann-Chatrian, parus
sous le Second empire, évoquant une invasion précédente, à la fin
de l'épopée napoléonienne.
Le franc-tireur romanesque est aux antipodes du Prussien, être
essentiellement militaire, défini par son appartenance à l’armée et
à un État militarisé, sujet d'un État quasi-dépourvu de société
civile, réactivation de l'archaïque modèle des chevaliers
teutoniques. L'explication de l'inimaginable défaite ne gît-elle pas
dans un comble de ce sujet d'un État sans société civile, à la fois
civil et militaire, faux civil mais vrai militaire : l'« espion prussien »
? Criminel, ce dernier est d'abord un scandale, le court-circuit d'un
des universaux indo-européens, l'opposition entre civil et militaire,
la coprésence simultanée mais cryptique, dans un même type
d'apparences civiles mais trompeuses qui dissimulent une réalité
militaire menaçante.
Pour le contrer, Les Espions (1874) d'Alphonse Brot appelle le
franc-tireur à imaginer l'inimaginable, à combattre le perfide sur
son propre terrain pour le démasquer. Ce roman invente le « franc-
tireur de la nuit », figure éponyme de tous les contre-espions
amateurs.
Le second plus vieux métier du monde ? 8
Paul Bleton, Les anges de Machiavel.
Dans cette inspiration, on peut aussi lire :
• Victor Valmont, L'Espion prussien, roman anglais (1872).
• Paul Féval, L'Homme du gaz (1872) – réédité sous le titre Les
Éclaireurs secrets (1929).
• Paul Féval, L'Ogresse. Histoire de Pierre Pentecôte dit
Parisien-la-Belle-Humeur – seulement parue (et incomplètement)
sous forme de feuilleton dans Le Petit Moniteur universel, du 5
novembre 1874 au 27 mars 1875.
• Alfred Assollant, Le Dr. Judassohn (1873).
Premières variations sur le thème.
La veine anti-allemande reste longtemps structurante.
Elle se poursuit notamment dans :
• Gustave Aimard, Les Aventures singulières de Michel
Hartman [1887-1888].
• Jean-Louis Dubut de Laforest, Les Dévorants de Paris et sa
suite L'Espion Gismarck (1885).
• Georges Pradel, Les Drames de la frontière et sa suite
L'Espion Rabe (1894).
La forte homogénéité idéologique et narrative ne doit toutefois pas
faire oublier une première apparition de l’ambiguïté pragmatique
(témoignage ? fiction ?) dans la fiction d’espionnage. L’histoire
secrète réinvestie par le point de vue de l’espion sert de modèle
d’interprétation à la réalité historique :
• Théodore Labourieu, Mystères de l’Empire par un espion
politique et militaire recueillis et mis en ordre par Th. Labourieu
(1874) – cette féroce critique de la mise en coupe réglée de l’État
par le régime bonapartiste ne succombe pas aux fantasmes
antisémites quant au capitalisme bancaire international juif mais,
à plus juste titre, évoque la fortune de Charles de Morny, de très
loin supérieure à celle des Rothschild de Londres.
Le second plus vieux métier du monde ? 9
Description:Dans L'Espion de police (1826) d'Étienne-Léon baron de. Lamothe-Langon, l'espion est un mouchard de police. En outre, ce premier roman de