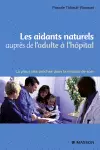Table Of ContentLes aidants naturels
auprès de l’adulte
à l’hôpital
CCCCHHHHEEEEZZZZ LLLLEEEE MMMMÊÊÊÊMMMMEEEE ÉÉÉÉDDDDIIIITTTTEEEEUUUURRRR
Relation d’aide en soins infirmiers, par la SFAP, M.-C. DAYDE, M.-L. LACROIX,
C. PASCAL, E. SALABARAS CLERGUES. 2007, 160 pages.
S’asseoir pour parler, par R. BUCKMAN. 2001, 224 pages.
Psychologie clinique en soins infirmiers, par S. RÉZETTE. 2008, 184 pages.
La maladie d’Alzheimer. Quelle place pour les aidants ?, par A. COLVEZ, M.-E. JOEL.
2002, 288 pages.
Les aidants naturels
auprès de l’adulte
à l’hôpital
PPPPaaaassssccccaaaalllleeee TTTThhhhiiiibbbbaaaauuuulllltttt----WWWWaaaannnnqqqquuuueeeetttt
AAAAvvvveeeecccc llllaaaa ccccoooollllllllaaaabbbboooorrrraaaattttiiiioooonnnn ddddeeee
CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiinnnneeee HHHHeeeeiiiittttzzzz
FFFFaaaannnnnnnnyyyy TTTThhhhiiiibbbbaaaauuuulllltttt
PPPPrrrrééééffffaaaacccceeee ddddeeee EEEEvvvveeeellllyyyynnnneeee MMMMaaaallllaaaaqqqquuuuiiiinnnn----PPPPaaaavvvvaaaannnn
Ce logo a pour objet d’alerter le lecteur sur la menace que représente pour
DANGER l’avenir de l’écrit, tout particulièrement dans le domaine universitaire, le déve-
loppement massif du « photocopillage ».
Cette pratique qui s’est généralisée, notamment dans les établissements
d’enseignement, provoque une baisse brutale des achats de livres, au point
que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de
les faire éditer correctement est aujourd’hui menacée.
Nous rappelons donc que la reproduction et la vente sans autorisation, ainsi que
le recel, sont passibles de poursuites. Les demandes d’autorisation de photo-
LE
copier doivent être adressées à l’éditeur ou au Centre français d’exploitation du
PHOTOCOPILLAGE
droit de copie :
TUE LE LIVRE 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris Tél. : 01 44 07 47 70
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour
tous pays.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque procédé que ce
soit des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illi-
cite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions stricte-
ment réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, et
d’autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d’information de
l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de
la propriété intellectuelle).
© 2008 Elsevier Masson S.A.S. – Tous droits réservés.
ISBN : 978-2-294-70530-4
ELSEVIER MASSON S.A.S. - 62, rue Camille-Desmoulins, 92442 Issy-les-Moulineaux Cedex
Préface
◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆
Lorsqu’un membre adulte de la cellule familiale développe une maladie, un handicap
ou une conduite addictive pouvant l’amener à une rupture de santé, chaque membre
de la famille réagit à son rythme, selon ses propres représentations mentales, son
degré d’attachement, sa propre histoire de vie personnelle et professionnelle… Les
liens familiaux et sociaux viennent soutenir ou faire défaut dans le processus d’adap-
tation individuel et collectif, aidant à faire face à la situation de rupture de santé,
momentanément ou à plus long terme. La confrontation aux pertes progressives liées
à la maladie, au handicap, à la chronicité…, l’attente d’un diagnostic, d’une échéance
ou d’un résultat…, les modifications et remaniements de rôles socio-familiaux qui en
résultent… sont autant de bouleversements influençant la santé de chaque aidant.
De son côté, la personne soignée perçoit à sa manière la qualité des relations avec ses
proches, la nécessité de leur présence à ses côtés, de leur information voire du sou-
tien à leur apporter, par elle-même ou un tiers ; ses propres perceptions, exprimées
souvent en terme de volontés, sont en accord ou désaccord avec les perceptions que
chaque membre de la famille dévoilera à l’équipe soignante, en sa présence ou en
dehors…
Avant tout être humain inséré dans un milieu, le professionnel du soin inscrit ses
habitudes de pratiques en écho avec ses connaissances professionnelles, mais aussi
son propre mode de représentations mentales et sociétales. Ainsi, témoins ou
acteurs de relations entre les familles et les patients, avec et entre les familles elles-
mêmes, les soignants sont partie prenante de ces réactions d’adaptation humaine.
Les aides-soignantes et les infirmières sont au premier plan lors des visites ou des
soins. Le médecin est celui qui doit savoir et qui informe. Le cadre infirmier joue un
rôle tampon entre l’équipe soignante, les médecins, l’institution et les différents
membres de la famille… L’assistante sociale est tout autant associée. De plus, les élé-
ments d’informations recueillis par les autres partenaires de l’équipe (paramédicaux,
psychologues, étudiants, bénévoles, administratifs…) peuvent se compléter ou
s’opposer ; cela suppose donc d’accepter que l’être humain (ici le patient ou la
famille) peut être différent d’un moment à l’autre de la prise en charge voire de la
journée, peut choisir la nature des confidences faites à untel ainsi que les stratégies
de communication et de compliance utilisées, selon le professionnel en présence ou
le moment du projet de soin. Source de conflit par excellence, le décalage de valeurs
concernant la notion de besoins et d’autonomie, de droits et de devoirs ainsi que de
perceptions de chacun (côté patient – côté famille – côté soignant – côté équipe) peu-
vent induire une prise de pouvoir délétère de l’un sur l’autre, la conviction d’être
dans son bon droit empêchant la remise en cause objective et l’individualisation des
soins au patient et à sa famille.
Les premières expériences vécues d’intégration d’une famille à la prise en charge du
malade influencent considérablement les postures soignantes individuelles et
VII
Les aidants naturels auprès de l’adulte à l’hôpital
d’équipe, les situations conflictuelles faisant davantage débat au sein des réunions
d’équipes. Dans ce contexte de prise en soin d’adulte, de nombreux cas de figures
s’observent en pratique, tels :
– un patient souhaitant voir auprès de lui uniquement telle personne de sa famille
alors que d’autres aidants, présents dans l’unité, insistent auprès de l’équipe pour ce
droit de visite… : comment respecter la demande du patient tout en témoignant à la
famille présente l’attention portée au sens de leur propre démarche ? ;
– deux frères omniprésents dans la prise en charge de leur père de 65 ans qui ne dit
pas un mot sur ses propres souhaits lorsqu’ils sont présents… : comment favoriser la
parole de l’un sans nuire à l’expression des autres et à la qualité du lien ? comment
faire en sorte que les entités patient/famille/équipe puissent trouver un compromis
satisfaisant ? ;
– l’une des filles d’une patiente de 75 ans ne voulant pas que sa mère soit informée
de… alors qu’une autre le demande expressément… : comment garantir l’écologie
de la relation entre ces deux sœurs et éviter que l’équipe prenne partie pour l’une ou
l’autre ? comment respecter le droit à l’information de la patiente elle-même ? ;
– l’épouse d’un patient de 53 ans avec qui tout allait bien et que l’équipe connaît
depuis plusieurs années, toujours très présente avec son mari… qui n’accepte pas
que son époux ait désigné une personne de confiance : comment aider ces deux
époux à se comprendre, à ne pas réduire la désignation prévue par la loi comme un
gage de non confiance ? qui doit être référent pour l’équipe ?
Ainsi, de nombreuses questions déontologiques et éthiques sont posées aux équipes
de soins, à prendre en considération dans le fond comme dans la forme, tant pour
développer une culture d’équipe que dans le cadre de la formation interdisciplinaire,
l’analyse comme l’adoption du comportement soignant adapté étant directement en
lien (écoute, qualité de l’information donnée, recadrage d’une attitude déviante d’un
collègue ou d’un aidant, capacité à savoir passer la main à bon escient…).
En France, que nous exercions à domicile ou en structure de soins, garantir la place
des aidants naturels dans le système de soins est un défi de santé publique sans cesse
à questionner, en lien avec l’évolution des connaissances biopsychosociales et cultu-
relles, des mentalités, des textes, des enjeux économiques et socio-sanitaires, des
organisations de travail. Induire le changement au sein de l’équipe interdisciplinaire,
composée qui plus est de générations différentes d’une même profession, suppose
de recontextualiser les postures professionnelles des uns et des autres. À défaut, le ris-
que serait de prendre pour loi les choix influencés à un temps T par les idées forces,
modes et programmes d’enseignement en vigueur, valorisant ou rejetant certaines
pratiques au fil du temps.
Certes, grâce au militantisme notamment des acteurs des soins palliatifs et de la géria-
trie, les textes régissant la pratique attendue et son évaluation sont une précieuse res-
source pour les aidants, les patients comme pour les professionnels moteurs.
Néanmoins, développer une culture institutionnelle d’équipe nécessite une ténacité
dans l’identification, la mise en œuvre et la codification des interventions soignantes
garantissant un accueil, une place et un accompagnement appropriés des aidants. De
fait, dans le contexte de la prise en soin d’adultes – jugés à priori en capacité de con-
tribuer et d’accepter les axes thérapeutiques proposés, la plus-value de la présence
VIII
Préface
des aidants comme de leur soutien formalisé commence à être reconnue dans sa
fonction d’utilité sociale. Le développement d’associations d’aidants1 ainsi que la
promotion du concept de proximologie2 en sont deux indicateurs, tout comme les
référentiels d’évaluation des pratiques professionnelles (notamment dans le cadre
des structures d’hébergement pour personnes âgées). Ces dynamiques mettent en
exergue la nature du soutien offert aux patients par les aidants et par les profession-
nels aux aidants eux-mêmes, relayant les travaux précurseurs d’infirmières, de tra-
vailleurs sociaux et de psychologues, publiés certes mais plus ou moins connus voire
peu mis en lien les uns avec les autres, démontrant la difficulté de faire reconnaître la
promotion de la santé, inscrite pourtant notamment comme l’une des normes inter-
nationales de qualité des soins…
Dans son ouvrage, Pascale Thibault - infirmière et cadre expérimentée, promotrice et
actrice du travail interdisciplinaire - nous invite à redéfinir le concept même de
famille ainsi que l’identification des soins à la famille. À l’instar de théoriciennes nord-
américaines qui ont influencé l’enseignement et la pratique française, Pascale Thi-
bault nous offre un canevas réflexif regroupant les éléments clés pour appréhender
ce phénomène complexe de l’aide aux aidants, amenant à reconsidérer tant le milieu
de travail qu’à resituer l’être humain biopsychosocial dans ses interactions avec son
environnement. Recontextualisant les aspects historiques, législatifs, sociologiques,
psychosociaux et organisationnels, ce livre est une base de référence pour élargir la
compréhension des multiples facettes à s’approprier dans le but de faire évoluer
l’accueil et le soutien des aidants accompagnant un proche adulte, malade ou dépen-
dant. Au cœur de la double optique d’humanisation des prises en soins et de promo-
tion de la santé, les différents chapitres proposés sont autant d’ouvertures
communautaires permettant à chaque équipe d’enrichir la mise en lien des options
possibles à renforcer ou à développer, favorisant la prise de recul de chaque acteur
du soin, notamment impliqué dans le management et la transmission des savoirs.
Evelyne MALAQUIN-PAVAN,
Cadre infirmier spécialiste clinique, médiateur non médical
Conférencière et auteur d’articles et de recherches en soins infirmiers
sur le thème du soutien des aidants3
1. Par exemple Eurocarers : organisation européenne associative à but non lucratif regroupant 15 as-
sociations nationales d’aidants familiaux ou instituts de recherche de 9 pays de l’Union Européenne
www.eurocarers.org.
2. [email protected]
3. Notamment travaux de recherche suivants : - 1996 : Accompagner une personne souffrant de la
maladie d’Alzheimer : aspects spécifiques du deuil des aidants naturels pistes de soutien (publié dans
la revue de l’ARSI) – 2005 : Rôle du cadre dans le soutien des aidants naturels de personnes agées
souffrant de démence d’Alzheimer institutionnalisées : entre posture et organisation apprenante.
IX
Introduction
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
« Qui aurait cru, quand le législateur travaillait encore au projet de reconnaître
des droits à la personne malade, que bientôt, la réflexion l’élargirait
à la problématique des proches, à leurs besoins et à toute la difficulté
de leur imaginer un statut spécifique ? »1
Éric Cornut
Objectifs
Pourquoi écrire un ouvrage sur la présence des « aidants naturels » auprès du
malade hospitalisé en 2008 ? Des connaissances éparses, une hétérogénéité des
pratiques, des convictions contradictoires, une littérature confidentielle, un ensei-
gnement timide, des nécessités économiques grandissantes.
Lorsque le patient bénéficie de soins à son domicile, quoi de plus normal pour
l’infirmier, le médecin, le kinésithérapeute que de réaliser ces soins en présence
d’un proche de la personne malade ? Quoi de plus normal que de s’adresser au
conjoint, à l’ami(e), aux enfants du patient, voire de se faire aider par l’un d’eux
pour réaliser certains soins ?
Or dès que le malade entre à l’hôpital, l’institution, à travers son fonctionnement
parfois encore très marqué par l’histoire, impose ses règles et ses façons de faire,
isolant ainsi la personne de ressources affectives précieuses à son bien-être et
son rétablissement.
Pourtant, en 2008, le patient hospitalisé, quel que soit son lieu d’hospitalisation,
a le droit d’avoir ses proches auprès de lui.
Ce droit a considérablement évolué au cours des dernières années, compte tenu
des mutations rapides des problèmes de santé publique. Il a notamment été inté-
gré dans la charte européenne des droits du patient hospitalisé et il apparaît dans
la procédure de certification des établissements de soins.
Dans ce contexte nouveau est apparu le concept de proximologie.
La proximologie peut se définir comme l’étude de la place et du rôle de l’entou-
rage de la personne malade. Ces proches sont appelés « aidants naturels »
lorsqu’ils apportent à la personne malade ou handicapée une aide régulière et
indispensable à sa qualité de vie. Ceux-ci peuvent être les proches du malade
ou de la personne handicapée, qu’il existe entre eux un lien de parenté ou non,
qu’ils soient bénévoles ou rémunérés dans le cadre d’une aide à domicile.
Ces préoccupations nouvelles touchent tous les secteurs de soins et tous les profes-
sionnels de santé. Mais elles ont été en grande partie réactivées par l’augmentation
1. Caro D., L’entourage du patient en médecine générale. Manuel de proximologie, Le quotidien du
médecin, 2006.
1
Les aidants naturels auprès de l’adulte à l’hôpital
du nombre de personnes âgées et la prise de conscience de l’isolement de certaines
d’entre elles, largement mis en évidence lors de la canicule de l’été 2003.
Dans ce contexte d’évolution, il devient de plus en plus nécessaire que les équi-
pes de soin travaillent en collaboration avec l’entourage du malade.
Cette conception s’intègre aisément à la notion de prise en charge globale bien
connue des personnels infirmiers. Enseigné depuis de nombreuses années dans
les Instituts de Formation en Soins Infirmiers, ce concept signifie que le patient
doit être soigné en tenant compte de son environnement personnel, familial,
social, culturel, etc.
Qu’en est-il alors de l’accueil des familles et des proches du malade en milieu
hospitalier ?
La fin du XXe siècle a vu se développer le concept d’humanisation des hôpitaux. De
nombreuses initiatives ont permis que la vie quotidienne des personnes hospitali-
sées s’améliore : ouverture de l’hôpital sur la vie de la cité, sur la culture, dévelop-
pement des liens de l’hôpital avec son environnement. Toutes ces initiatives ont
amené les équipes de soins à faire évoluer les relations avec le malade, ce qui a
abouti à la promulgation de la loi sur les droits des malades en mars 2002.
Néanmoins, la législation ne suffit pas à modifier les pratiques, et surtout les
comportements.
Dans les services hospitaliers recevant des personnes adultes et âgées, l’accueil
des familles fait l’objet de grandes disparités. Les propos des personnels soignants,
mais aussi des familles sur ce sujet confirment fréquemment l’hétérogénéité des
pratiques, relevant plus souvent de la sensibilité individuelle de chaque soignant
que d’une attitude professionnelle réfléchie dans le cadre d’un travail d’équipe.
Actuellement, les horaires de visites peuvent être extrêmement différents selon les
services ; le travail avec les familles connaît d’importantes variations, y compris au
sein d’un même établissement. Les professionnels, très différemment formés à cet
accueil et cette présence, peuvent adopter des attitudes changeant selon leurs pro-
pres convictions, mais aussi en fonction du patient et de son entourage.
Ainsi malgré l’ouverture de tous les services hospitaliers aux familles et aux pro-
ches des personnes hospitalisées, des difficultés persistent, d’autres ressurgis-
sent. La charge de travail, la gêne occasionnée dans certaines organisations de
travail, les contraintes liées à l’application de nouvelles mesures d’hygiène, les
difficultés éprouvées par les soignants pour établir une relation duelle avec le
patient en présence d’un membre de leur entourage, mais aussi les confronta-
tions à des comportements culturels multiples peuvent expliquer les réticences
ou difficultés de certains soignants à accueillir l’entourage du patient.
Si dans certains secteurs de soins (services de pédiatrie, de soins palliatifs, de
gériatrie par exemple), des réflexions ont été menées, principalement à la suite
des travaux des psychologues, d’autres adoptent à l’égard des familles des régle-
mentations et des pratiques parfois très éloignées de l’intérêt des patients.
Pourtant, des études réalisées le plus souvent dans les services de pédiatrie, ont
montré que la présence des parents, y compris lors des soins, n’avait pas d’inci-
dence sur l’attitude de l’enfant ni sur celle du soignant dans la réalisation du
soin. Même si des différences fondamentales (respect du secret médical,
2
Introduction
absence de dépendance légale) existent dans la relation soignant/soigné selon
l’âge et l’état de dépendance du patient, il ne semble pas incohérent de penser
que ces résultats puissent s’appliquer dans les services accueillant des adultes.
En effet, certaines différences fondamentales existent dans la relation entre le
soignant et le patient dès lors que ce dernier est majeur et en pleine capacité de
ses moyens de décision. Dans ce cas, la relation s’établit directement entre le
soigné et le soignant, ce dernier est tenu au secret professionnel et seul le patient
peut décider de la place accordée à son entourage. Encore faut-il que le soignant
accepte la présence de cet entourage auprès du malade.
Lorsque le patient est mineur, le soignant doit obligatoirement apprendre à tra-
vailler avec ses représentants légaux, le plus souvent ses parents. Bien entendu,
le patient adulte n’a pas les mêmes besoins, en particulier psychoaffectifs, que
l’enfant ; il est capable de supporter plus aisément l’isolement provoqué par
l’admission à l’hôpital. Par ailleurs, de nombreux progrès ont été faits : diminu-
tion des durées d’hospitalisation, élargissement des horaires de visites, y compris
dans des unités très fermées comme les réanimations. Néanmoins, les soignants
expriment encore parfois « la perte de temps ou les difficultés qu’entraîne le tra-
vail avec les familles ».
Si certains soignants considèrent la place des proches du malade comme une
évidence, d’autres n’en comprennent pas la nécessité, n’en voient pas l’intérêt.
En fait, la présence des familles auprès de la personne malade dans les services
hospitaliers est encore vécue par certains d’entre eux comme une obligation
dont, parfois, ils ne comprennent pas le sens, n’en connaissant pas l’intérêt pour
le premier concerné : le malade.
Ils sont donc susceptibles de remettre en question la place de la famille et des
proches du patient hospitalisé sous la pression de la charge de travail, des
recommandations d’hygiène ou d’autres nécessités de service plus pressantes.
Ils ne sauront pas apporter les arguments en faveur de cette présence lors de
réflexions d’équipes menées pour faire évoluer la qualité des relations des
familles au sein des services hospitaliers : possibilité d’obtenir un lit d’appoint
dans chaque chambre, création d’un espace réservé aux familles dans un service
ou d’une cafétéria dans un ensemble hospitalier. De la même façon, ils ne sau-
ront pas défendre l’intérêt de la formation des personnels, pourtant indispensa-
ble pour travailler de façon constructive avec l’entourage du patient hospitalisé.
Mais, en réalité, est-il si simple pour un jeune professionnel, médecin ou infir-
mier, d’assurer sa fonction en présence des proches du malade ? Comment y a-
t-il été préparé ? Quelles informations a-t-il reçu ? Et les familles d’aujourd’hui
sont-elles différentes de celles des générations précédentes ? Quelles sont leurs
attentes, leurs revendications, mais aussi leurs capacités à être présentes auprès
de la personne malade ?
En 2008, le droit pour le malade d’avoir ses proches auprès de lui à l’hôpital ne
peut pas être remis en cause, mais la qualité des relations soignants/familles peut
très certainement s’améliorer.
Il existe encore aujourd’hui des difficultés pour faire appliquer les mesures pré-
conisées en faveur de la personne hospitalisée. Les raisons en sont multiples et
3