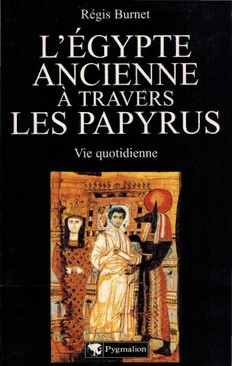Table Of ContentL'ÉGWTE ANCIENNE
À TRAVERS
LES PAPYRUS
Vie quotidienne
Merci au professeur Jean Gascou
pour ses suggestions
et merci à mes premiers relecteurs.
Sur simple demande adressée à
Pygmalion, 70, avenue de Breteuil, 75007 Paris
vous recevrez gratuitement notre catalogue
qui vous tiendra au courant de nos dernières publications.
© 2003 :Éditions Flammarion, département Pygmalion
ISBN 2-85704-810.6
Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5 (2° et 3° a),
d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective» et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans
un but d'exemple et d'illustration, «toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite» (art. L. 122-4).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une
contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
RÉGIS BURNET
,,,
.
L'EGYPTE ANCIENNE
À TRAVERS
LES PAPYRUS
Vie quotidienne
Pygmalion
INTRODUCTION
Les textes que l'on va lire sont des rescapés. Par une conjonc
tion unique de paramètres climatiques et de résistance du sup
port de l'écriture - le papyrus-, ils se trouvent être quasiment les
seuls écrits originaux conservés de !'Antiquité. Les autres textes
ne proviennent que de copies, dont l'exemplaire le plus ancien
date souvent du Moyen Âge (à l'exception du texte biblique) : par
exemple, pour les œuvres de Platon, deux manuscrits du IXe siècle,
le Bodleianus 39 et le Paricinus 1807 ; pour le De Natura Rerum de
Lucrèce, deux manuscrits également du IXe siècle, les deux
Vossianus; pour la Politique d'Aristote, deux manuscrits encore plus
tardifs, le Parisinus Coislinianus 161 (XIV" siècle) et l' Ambrosianus
B 105 sup (XV' siècle).
Non seulement les originaux ont disparu, mais four texte
même a rarement été transmis: seuls ceuxjugés dignes d'intérêt
ont été reproduits ; autrement dit, les textes littéraires majeurs.
Recopier un texte pour le sauvegarder constitue un investisse
ment coûteux en temps et en argent. Même s'ils étaient nom
breux, s'ils y passaient leur vie et s'ils n'étaient pas récompensés -
sinon spirituellement-, on voit mal comment les moines copistes
frileusement encoignés dans leur scriptorium auraient pu reco
pier les quittances de loyer, les déclarations d'impôts, les lettres
d'amour, les pense-bêtes des hommes de !'Antiquité!
7
Tout s'est donc évanoui. .. à part les papyrus miraculeusement
préservés par la sécheresse du climat dans les déserts d'Égypte. Au
sein d'obscures provinces traversées par le Nil ou ses affluents, des
milliers de papyrus ont survécu au cours des siècles. Miraculés, ils
livrent la vie quotidienne de ces habitants dont les voix se sont
éteintes depuis deux millénaires.
Comment parlaient les hommes de !'Antiquité? La plupart des
romanciers qui situent leur intrigue dans le lointain passé ne se
posent pas la question. Et que dire des films 1 Ou bien les person
nages parlent avec l'hiératisme de la Phèdre de Racine ou bien avec
la truculence du Gargantua de Rabelais. Et quel que soit le film,
Cléopâtre parle comme une actrice hollywoodienne. Cette antho
logie ne se contente pas de révéler la vie quotidienne des habitants
de l'Égypte gréco-romaine : elle révèle que ni la componction ni le
débraillé ne caractérisent la manière antique.
1. - PAPYRUS, PLOMB, PARCHEMIN, CIRE ET POTERIE
Ce miracle s'explique par l'extraordinaire résistance d' yperus
papyrus, le papyrus nilotique, que les Grecs nommaient papyros ou
U:Jblos. Il pousse en abondance sur les bords du Nil, dans le Delta
et dans le Fayoum. Dans l'Égypte ancienne, cette plante servait à
tout : on la mangeait, on en faisait des objets usuels (paniers,
cordes, barques, etc.) et l'on s'en servait pour écrire. On écrasait
sa tige pour la réduire en fines lanières que l'on disposait à plat en
les croisant et que l'on faisait sécher. On obtenait alors une feuille
souple. Il suffisait de la poncer pour la rendre bien lisse, de tracer
éventuellement des lignes avec une mine de plomb et d'écrire
avec un roseau taillé en biseau, le calame, que l'on trempait dans
une encre faite de noir de charbon ou de substances animales
(comme l'encre de seiche). Le papyrus joua le rôle de« papier de
!'Antiquité»; l'usage s'en répandit dans le Bassin méditerranéen
à partir du ne millénaire avant notre ère et ne cessa pas jusqu'à la
conquête des Arabes : en prenant le contrôle de l'Égypte, ces der
niers contribuèrent à tarir les exportations. La Méditerranée et
l'Europe se tournèrent alors vers d'autres supports: le dernier
papyrus papal date de 1057, et il semble déjà archaïque.
Éloigné de l'humidité, le papyrus demeure quasiment indes
tructible. Il ne s'est conservé que dans les régions extrêmement
8
sèches : les « papyrus d'Égypte » ont été trouvés en majorité au
Fayoum et dans les zones arides du pays. Dans le Delta ou dans la
brillante capitale économique, politique et culturelle de l'Égypte
gréco-romaine, Alexandrie, il pourrit. Aussi avons-nous perdu bon
nombre de documents qui auraient pu être d'un intérêt capital et
conservons-nous les archives d'obscurs fonctionnaires et de petits
paysans.
Le papyrus n'était pas le seul support sur lequel on pouvait
écrire dans l'Égypte gréco-romaine. On utilisait aussi le parche
min, confectionné à partir d'une peau de bête non tannée, qui
fut inventé en Perse et se répandit en Égypte à partir du me et du
IV" siècle de notre ère : beaucoup plus cher, il ne servait que pour
les textes officiels ou les textes littéraires. Dans la vie quotidienne,
on utilisait des tessons de poterie que l'on nommait ost:raca (au
singulier : ostracon). Ramassés dans les dépotoirs, ils avaient le
mérite de ne rien coûter, mais l'inconvénient d'être de format
réduit et de surface irrégulière. Certains textes magiques étaient
gravés sur des tablettes de plomb. Enfin, pour prendre des notes
ou pour les exercices scolaires, on utilisait la cire meuble : il suf
fisait de l'égaliser après usage pour pouvoir indéfiniment s'en
servir.
2. -
LES HÉRITIERS DE L'ÉGYPTE DES PHARAONS
La conservation exceptionnelle des papyrus d'Égypte s'ex
plique donc par d'exceptionnelles conditions climatiques: seuls
les hasards de la météorologie font que l'on connaît avec autant
de précision la vie de ceux qui demeuraient sur les bords du NiL
Qui sont ceux dont on va lire les écrits?
À l'époque que couvre cette anthologie (332 av. J.-C.-395
ap. J.-C.), les habitants de l'Égypte sont en leur grande majorité
les successeurs des Égyptiens de l'époque pharaonique: l'apport
culturel, racial, technique ou économique des conquérants ne
modifie pas radicalement la physionomie du pays, à l'exception
de quelques grandes villes. Les conditions générales de vie, l'agri
culture, la religion évoluent très lentement et l'on retrouvera tout
au long de l'ouvrage des traits très anciens, au point que ces
témoignages d'une période postérieure éclairent souvent la vie
quotidienne de l'Égypte des Pharaons.
9
Mais pas seulement. En Égypte coexistent une multitude d' eth
nies; qui ne se mélangèrent que lentement. Vivant au milieu des
Égyptiens de la campagne, on trouvait des habitants du monde
hellénisé : Grecs, mais aussi Perses, habitants d'Asie Mineure, habi
tants de la côte orientale de la Méditerranée, etc. Ils se mariaient
souvent avec des indigènes et formèrent un groupe intermédiaire,
les Gréco-Égyptiens. Dans les cités dites « grecques » habitaient
des Grecs de souche; ils formaient une sorte d'aristocratie grâce
à leur statut civique privilégié. Après la conquête romaine, on
rencontrait quelques rares Romains, surtout dans les hautes
fonctions militaires et dans l'entourage des préfets à Alexandrie.
Il faut enfin mentionner les Juifs, présents dès le V" siècle dans
la colonie juive d'Éléphantine, puis à partir de l'époque ptolé
maïque, dans la campagne et à Alexandrie.
3. - GREC, COPTE, IATIN, HIÉROGLYPHIQUE OU DÉMOTIQUE ?
L'étude des papyrus révèle une étrange surprise : la majorité
d'entre eux est écrite en grec. Pourtant, jamais l'ensemble des
Égyptiens ne parla grec : jusqu'à la conquête arabe, ils parlaient
l'égyptien (en fait, de multiples dialectes), puis ils adoptèrent un
dialecte de l'arabe. Pourquoi alors a-t-on rédigé tant de papyrus
en grec?
Pour comprendre, il ne faut pas hésiter à comparer le monde
méditerranéen au monde actuel : une multitude de peuples, une
multitude de langues et le besoin vital de communiquer. Dans
cette configuration, tout naturellement, une langue s'impose,
rarement la plus simple, mais souvent celle du peuple économi
quement, culturellement ou politiquement « dominant», Dans
!'Antiquité, le sumérien, le phénicien, l'araméen jouèrent ce rôle,
et à partir de la conquête d'Alexandre, ce fut le grec. Langa franca,
le grec qui s'imposa se dépouilla (comme il arrive souvent; c'est
d'ailleurs ce qui arrive de nos jours à l'anglais) de la plupart de ses
traits dialectaux et se «normalisa», en adoptant toutefois des
tours de phrase et des expressions propres aux locuteurs « indi
gènes». Plus d'attique, de dorique, d'ionien, mais simplement un
grec «commun», le grec de la koinè, de la« communauté», qui
subit les influences de la Syrie, de l'Asie Mineure et surtout du
parler d'Alexandrie.
10