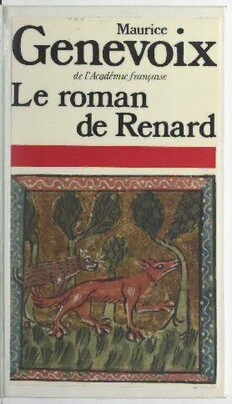Table Of ContentLE ROMAN
DE
RENARD
ŒUVRES DE MAURICE GENEVOIX
DANS PRESSES POCKET :
LA FORÊT PERDUE
BEAU-FRANÇOIS
MAURICE GENEVOIX
de l'Académie française
LE ROMAN
DE
RENARD
roman
Préface et dossier de
Jean DUFOURNET
Professeur à l'Université de la Sorbonne Nouvelle
PLON
La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de
l'article 41, d'une part, que les copies ou reproductions strictement réser-
vées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective,
et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but
d'exemple et d'illustration, toute représentation ou reproduction intégrale
ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit
ou ayants cause, est illicite (alinéa 1 de l'article 40). Cette représentation
ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une
contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.
© 1968.
MAURICE GENEVOIX
ET
LE ROMAN DE RENARD
« Ainsi, lorsque plus tard j'ai arrangé à
ma manière l'histoire de Renard le goupil,
c'est seulement après avoir entendu l'appel
du rude petit fauve, revu trembler à cet
appel, silencieusement, sur l'horizon inté-
rieur où nos projets passent, comme des nua-
ges, de longs éclairs de poésie. Le seul jeu
. littéraire ne m'y eût jamais décidé. »
Maurice Genevoix, Jeux de glace, p. 145.
I
Comédie animale qui est un décalque coloré, souvent
satirique, de l'éternelle comédie humaine, le Roman de
Renard a été, dès le Moyen Age, un vaste chantier sur
lequel des écrivains plus ou moins doués ont travaillé pen-
dant près d'un siècle, reprenant des scènes, des motifs et
des expressions'. M. Genevoix, à son tour, s'est mis à
l'ouvrage (1958), près d'un siècle après Paulin Paris (1861)
et un peu avant Philippe Van Tieghem et Maurice Toesca
(1962), Albert-Marie Schmidt (1963) et Jacques Haumont
(1966).
Inutile de s'attarder sur les emprunts à l'avant-texte,
nombreux et attendus. On trouvera, dans le dossier qui
suit le texte, un tableau des correspondances entre les cha-
pitres de M. Genevoix et les branches du Roman de
Renard médiéval. Il faut préciser que certaines histoires
ne viennent pas de l'œuvre médiévale, comme celles de
Renard et du héron Pinçart en I, 6 ou le loup et le lima-
çon, le chasseur chassé en II, 9. M. Genevoix a emprunté
à son modèle des noms propres et des aventures, des mots
anciens comme chemin ferré, grenons « moustaches »,
avaler « descendre », grailes « trompettes au son aigu » 5
plessis « enclos », des proverbes (« le besoin qui fait
vieilles trotter... ») et des tours formulaires très divers (du
méchant nain, du puant nain pour qualifier Renard, à
Pinte qui pond les gros *œufs, ou grave comme un prêtre
au synode, ou ça lui pendait à l'œil, pp. 150 et 200), des
esquisses, comme celle du prêtre qui étend son fumier
(p. 203), des procédés comme le recours comique au latin
(p. 154) et les énumérations (p. 79).
Plus intéressantes sont les suppressions, sans doute
pour limiter le volume du roman, mais surtout pour élimi-
ner tout ce qui ressortissait à un anthropomorphisme trop
appuyé, c'est-à-dire les scènes où Renard joue au jongleur
(branche Ib) ou au médecin (branche X) - il est simple-
ment rappelé qu'il est mire (p. 135) -, les scènes où il
tonsure Isengrin (branche IV), essaie de croquer le grillon
(branche V) et met en pratique les leçons de magie appri-
ses à Tolède (branche XX), les scènes d'église avec le chat
Tybert (branche XII ou le loup Primaut (branche XIV),
le duel entre le goupil et le coq Chantecler
(branche XVII), l'intervention du chameau qui est légat
du pape (branche Va). M. Genevoix a négligé aussi la
scène de Renard teinturier (branche Ib), sans doute après
avoir hésité, puisque nous lisons dans le dossier cette
note :
« Peut-être retenir épisode de la cuve du teinturier : thème
du déguisement qui sera bien à sa place dans ce cycle. »
De même disparaît la première partie de la
branche XXIV qui, racontant la naissance du goupil, en
fait un animal féminin et diabolique, un fils d'Eve, et que
Paulin Paris a reprise dans le Prologue de son adaptation,
tout comme L. Chauveau
Enfin, M. Genevoix a éliminé des scènes trop
connues, telles que le corbeau et le renard (le fromage) ou
le renard et le coq (du moins la ruse par laquelle le goupil
s'empare du second), toutes les allusions à l'actualité qui
caractériseront les branches postérieures du Roman de
Renard, et surtout tout ce qui ralentit le rythme de l'ac-
tion, comme le rappel des mauvais tours du goupil, qui
convenait à la déclamation fragmentée de l'ensemble du
roman - encore que M. Genevoix y recoure dans l'épisode
du plaid quand Renard entreprend de se défendre -,
comme le redoublement de certaines scènes qui, dans l'ori-
ginal, sont annoncées et préparées, puis réalisées : ainsi,
dans la branche IX, Renard propose-t-il son plan (vers
645-719) qu'il applique ensuite (vers 741-936); M. Gene-
voix, dans le chapitre VII de la seconde partie, se contente
de noter :
« Constant serra le poing et le brandit vers le fossé.
- A moins que... souffla Renard, de sa voix la plus sucrée.
- A moins que ? répéta le vilain en ralentissant sa course.
- Ecoute-moi, Constant, dit Renard. Tu ne le regretteras
pas.
Il a fait des progrès, Renard. Il connaît à présent son
monde. De l'un, de l'autre, il sait tirer parti pour réaliser ses
desseins. Mais ses desseins ne sont que de Renard, et chacun y
aura son tour » (p. 119).
Toujours dans la branche IX, Brunmatin, la femme
du vilain, indique, pour se débarrasser de Renard, le stra-