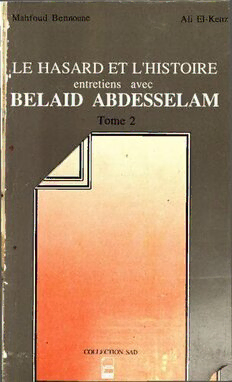Table Of Contentahfoud Bennoune Ali El-Kenz
CX)LLECnON SAD
AJHFOUD BENNOUNE ALI EL-KENZ
'/
LE HASARD ET L ’HISTOIRE
y
ENTRETIENS
AVEC
Bel ai d A B D E S S E L A M
Tome 2
INwlANA UNIVERS!
LIBRARIES
8L00MINGT0N
Collection “ SAD”
dirigée par Ali El-Kenz
© ENAG / Editions - 1990
Suite de la
troisième partie
LES PROBLEMES DU DÉVELOPPEMENT
ni
Les plans de développement :
Une stratégie qui se construit dans l’adversité
Bennoune : Peux-tu nous parler, maintenant, de l'expérience de
développement et des différents plans qui l'ont marquée.
Abdesselam : Les discussions qui ont précédé ces plans remon
tent à plus de douze ans ; aussi, je vais m’efforcer de rassembler
mes souvenirs personnels.
Après avoir été chargé du problème du gaz, de la révision des
accords d’Evian, etc., j’ai été amené logiquement à me préoccuper
des problèmes de développement. En outre, pour un nationaliste,
son aspiration est de voir son pays atteindre le rang de
développement des autres pays...
Il s’agissait d’abord de se débarrasser du carcan d’Evian et,
ensuite de penser comment rattraper les autres... Bien sûr, cela
supposait qu’on ait répondu aux questions : « Qu'est-ce que le
progrès ? Le développement ? ».
Il y a, évidemment, différentes manières de concevoir le
développement. Il y a deux démarches possibles : l’une qui met en
avant l’objectif financier ou bien, en disant les choses autrement,
celle qui a pour moteur exclusif ou quasi exclusif la recherche du
profit, et l’autre qui met en orbite une action qui tend à sortir le
pays d’un état pour le mener à un autre, celui atteint par les pays
pris comme référence, généralement les pays développés, de
l’OCDE... Et, on observe un certain nombre de critères, d’indices
- consommation d’acier par habitant, formule alimentaire, ration
calorifique, instruction, scolarisation, etc. - et, de proche en
proche, on s’aperçoit que le développement, c’est une multitude
d’objectifs à réaliser. On engage le pays, par une action
déterminée, à atteindre un objectif déterminé. Le développement
ne consiste pas seulement en une masse d’investissements, mais
aussi en un mouvement d’actions engagées, une marche forcée...
7
Le hasard et l’histoire
Il faut essayer d’aller rapidement, de court-circuiter certaines
étapes, etc.
On débouche alors, sur une forme d’action qui n’entre pas dans la
démarche capitaliste qui, elle, consiste à lancer un certain nombre
d’incitations et à attendre que les choses se réveillent d’elles-
mêmes. C’est pourquoi, on retrouve, dans le langage des
théoriciens capitalistes, qui ne connaissent pas ou ne veulent pas
connaître la démarche socialiste, la notion de démarche
volontariste qui nfreint les mécanismes des lois naturelles ou,
pour employer un vocable aujourd’hui à la mode, des lois
universelles de l’économie et du marché... Je prends, par exemple,
les cimenteries. En 1968, quand nous avions nationalisé ce secteur,
il y avait deux grandes cimenteries de 500 000 tonnes chacune et
une petite - celle de Meftah - de 40 000 tonnes. Pour le
propriétaire - Lafarge -, il était impensable de multiplier, au-delà
d’une certaine limite, cette capacité. Quelques années après, nous
nous retrouvons avec un programme de création de cimenteries,
qui devait nous conduire à mettre en place une capacité de plus de
dix millions de tonnes... Alors, selon que l’on adopte l’une ou
l’autre démarche, il y a des conséquences qu’il faut accepter
consciemment, et avant de s’y engager... Je vous dis cela à titre
de rappel ; car, la vision du développement, j’ai eu l’occasion de
vous en parler longuement, auparavant...
Bon, le plan triennal a été lancé en 1967-1969, il a été préparé en
1966, donc, dès le lendemain de la prise de pouvoir de
Boumediène. A l’époque, nous n’avions pas voulu lancer un plan
complet de développement, car nous estimions que nous n’étions
pas suffisamment bien informés sur les réalités de l’économie
algérienne et que nous ne disposions pas encore d’un certain
nombre d’objectifs à accomplir, pendant ces trois années
considérées comme une période préparatoire pour le lancement
d’un plan qui, alors, s'inscrirait dans une perspective à plus long
terme.
Du point de vue de l’industrie, les actions engagées étaient des
actions d’urgence, soit dans le domaine de ce que nous avions
entre les mains - il s’agissait de remettre sur pied, un certain
nombre d’entreprises qui fonctionnaient difficilement, d’engager
des actions de formation, des investissements complémentaires ou
de remplacement -, soit les actions dans d’autres domaines où les
besoins se faisaient sentir, comme dans le secteur alimentaire, soit
continuer un certain nombre d’actions déjà engagées dans le cadre
8
Entretiens avec Belaid Abdesselam
du Plan de Constantine, comme la sidérurgie de Annaba, et
amorcer quelques projets qui avaient déjà mûri, comme les engrais
phosphatés à Annaba, le complexe d’engrais azotés à Arzew et
lancer, sur le terrain, notre politique pétrolière, à partir de 1966,
après les accords de 1965 avec les Français.
A ce moment-là, il n’y avait pas de problèmes particuliers à
l’industrie, car elle était considérée par tout le monde comme la
solution pour régler bon nombre de problèmes, notamment celui
du chômage. Le problème majeur, qui se posait alors, était de créer
des emplois pour résorber le chômage. En manière
d’infrastructures - c’était l’idée qui prévalait à l’époque -, on
considérait que la France nous avait laissé une très belle
infrastructure, à laquelle il n’y avait pas grand-chose à ajouter. Il
fallait, donc, se contenter seulement d’actions d’entretien... et l’on
considérait même, parfois, que ce legs ne méritait même pas d’être
entretenu. C’est ainsi que des aéroports ont été fermés ! On
considérait qu’il y avait trop d’aéroports pour l’Algérie ! Des
routes étaient abandonnées, des ports délaissés, comme inutiles...
On raisonnait par rapport aux pays sous-développés... On partait
de l’idée simpliste qu’on avait un chemin de fer... que la SNCFA
étant déficitaire, il fallait trouver le moyen de la subventionner ; il
n’était pas question de nouvelles voies ! « Déjà, les lignes que
nous avons, nous n'arrivons pas à les rentabiliser !... » Voilà quel
était alors le raisonnement. Même raisonnement pour l’agriculture :
« Comment arriver à écouler la production ?... Comment vendre
à l'extérieur du vin, des oranges et des mandarines ? » On avait, à
ce moment-là, un excédent de production pratiquement dans toutes
les catégories de cultures, sauf les céréalières, par rapport à la
consommation nationale. On réfléchissait aux moyens de
rentabiliser les domaines autogérés... On reprochait, alors, à
l’agriculture de ne pas payer d’impôts, de ne pas dégager de
bénéfices pour alimenter le Trésor...
Voila enfin toute la philosophie qui prévalait à l’époque. Et
l’industrie était considérée comme la locomotive qui pouvait faire
démarrer l’économie... Ensuite, les actions engagées sur le plan
pétrolier étaient envisagées principalement dans le cadre d’une
coopération avec la France. Au plan industriel, à Annaba, l’usine
sidérurgique se faisait, en partie, en coopération avec les Français
et les autres projets étaient des projets où, plus ou moins, les
Français étaient intéressés. J’ai eu l’occasion de vous expliquer le
cas d’Arzew {ammoniac)... Bon, on n’a pas réussi à engager ce
9
Le hasard et l’histoire
projet dans le cadre d’une société mixte ; mais, les Français étaient
contents d'obtenir la réalisation du projet. Sur le plan de la
liquéfaction du gaz, le projet de Skikda n’est pas tout à fait arrivé à
maturité, à cause du problème du prix ; mais, il était envisagé avec
les Français.
Bref, dans l'ensemble, il n’y avait pas d’hostilité envers
l’industrie. Celle-ci bénéficiait d’un préjugé favorable, tant sur le
plan interne que du côté français. Les quelques escarmouches qui
ont éclaté, à l’époque, l’ont été avec la gauche - les commu
nistes..., ils essayaient d’attaquer le régime dans son ensemble et
ils disaient que j’étais l’agent des Français et un peu celui des
Américains ; car, j ’essayais de trouver une percée, du côté
américain, dans le domaine pétrolier. Voilà en gros la réaction. Je
vous signale, aussi, qu’à l’époque, les forces qui attaquent
aujourd’hui l’industrie étaient focalisées sur l’agriculture.
Pourquoi ? Parce que c’était dans l’agriculture qu’était concentré
le système socialiste. C’était le domaine où la part du secteur
socialiste était la plus grande, à la suite des nationalisations des
terres des colons... tandis que, dans l’industrie, la part du secteur
socialiste était relativement faible ; la plupart des entreprises
industrielles existant dans le pays se trouvaient encore entre les
mains de propriétaires étrangers, français dans leur quasi-totalité.
L’agriculture était, à cette époque, l’objet d’attaques virulentes...
Vous trouverez, dans notre histoire économique du lendemain de
l’indépendance et du 19 juin 1965, du côté du ministère des
Finances, des tentatives d’étouffement du secteur agricole : des
contrôles paralysants et empreints de la volonté de nuire, des crédits
coupés - les crédits du Trésor -, sans compter, qu’à ce moment-là,
les banques étaient privées. La seule banque algérienne était la
Banque centrale ; mais elle n’avait pas de contacts avec les secteurs
économiques, à l’exception de Sonatrach à laquelle elle servait de
banque primaire, afin d’éviter que notre industrie pétrolière
naissante passe par les mains des banques privées étrangères. Les
autres secteurs avaient affaire soit aux banques privées françaises,
soit au Trésor ou à la CAD et faisaient l’objet de toutes sortes de
mesures draconiennes... «Vous mangez de l’argent ; vous ne
produisez pas, etc. » leur disait-on. Enfin, les responsables de notre
agricu ture et nos domaines autogérés agricoles étaient en butte aux
mêmes critiques qui sont dirigées, maintenant, vers le secteur
industriel. Il y a eu, même, à l’époque, une campagne organisée à
rencontre des gestionnaires de lVgriculture : on les mettait en