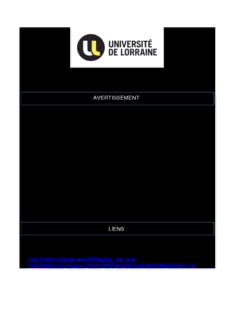Table Of ContentAVERTISSEMENT
Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite
encourt une poursuite pénale.
Contact : [email protected]
LIENS
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm
UNIVERSITÉ de Lorraine
École doctorale Fernand BRAUDEL
Le contrôle de l’espace européen par
les rois de Macédoine, des origines à la
fin de la monarchie
(VIe siècle av. J.-C. – 168 av. J.-C.)
VOLUME 1 : TEXTE
Thèse soutenue par Pierrick PARISOT
Le 01 juillet 2015
Pour l’obtention du grade de docteur en Histoire ancienne
Sous la direction de Michel SÈVE, professeur d’Histoire ancienne
Composition du jury :
Cédric BRÉLAZ, maître de conférences
Université de Strasbourg
Michèle BRUNET, professeur d’Histoire ancienne
Université de Lyon 2
Patrice HAMON, professeur d’Histoire ancienne
Université de Rouen
Sandrine HUBER, professeur d’Archéologie
Université de Lorraine
Laurent LESPEZ, professeur de Géographie
Université de Paris Créteil
REMERCIEMENTS
Je tiens en premier lieu à remercier le professeur Michel Sève, pour avoir accepté de diriger cette
thèse. Ses remarques et ses conseils ont été d’une aide plus que précieuse. Sans la confiance et le
soutien indéfectible dont il a fait preuve à mon égard, ce travail n’aurait pas pu voir le jour.
Je remercie également le personnel de l’École française d’Athènes pour m’avoir accueilli à deux
reprises au cours des dernières années. Les conseils d’Alexandre Farnoux m’ont beaucoup apporté.
Mes remerciements s’adressent également :
À Miltiade Hatzopoulos, rencontré lors de mon premier séjour à Athènes, avec qui j’ai pu avoir des
échanges éclairants,
Au personnel de la bibliothèque universitaire de Sarrebruck,
À Antoine Chabrol, membre scientifique de l’École française d’Athènes, qui m’a transmis ses
connaissances sur l’utilisation des logiciels de traitement des données géographiques,
À Matthieu Ghilardi, qui m’a fait profiter de son travail sur la plaine centrale de Macédoine,
À tous mes amis, collègues et doctorants qui ont manifesté de l’intérêt pour mes travaux et n’ont cessé
de m’encourager au cours de ces années,
À ma compagne Mylène, qui m’a accompagné à travers le territoire de l’ancien royaume de
Macédoine. Sa présence et son soutien au quotidien m’ont été d’un grand secours,
À mon père, pour son travail de relecture et ses conseils,
Je tiens enfin à exprimer ma gratitude à tous les membres de ma famille pour leur compréhension, leur
soutien moral et matériel. Sans eux, cette thèse n’aurait sans doute pas pu aboutir.
3
LISTE DES ABRÉVIATIONS
To ArcaiologikÒ `Ergo sth Makedon…a kai Qr£kh
'ΑρχαιολογικÕn Deλt…οn.
AJAH American Journal of Ancient History
ArchEph 'Αρχαιολογικ¾ 'Εφημερ…ς.
Arch. Rep Archaeological Reports.
AR Archaeological Reports
BCH Bulletin de Correspondance Hellénique.
BSA Annual of the British School at Athens
CQ Classical Quarterly
FGrHist Fragmente der griechischen Historiker
JHS Journal of Hellenic Studies
JRS Journal of Roman Studies
Praktik£ thj en Aqhna…j Arcaiologik»j Etaire…aj
REG Revue des etudes grecques
SEG Supplementum Epigraphicum Graecum
TIR Tabula Imperii Romani
ZPE Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
N. G. L. HAMMOND, Macedonia : N. G. L. HAMMOND, A History of Macedonia, 3 vol.,
Oxford 1972-1988.
M. B. HATZOPOULOS, Institutions : M. B. HATZOPOULOS, Macedonian Institutions Under The
Kings, Athènes, 1996
F. PAPAZOGLOU, Villes : F. PAPAZOGLOU, « Les villes de Macédoine à l'époque romaine »,
BCH Supplément 16, 1988.
5
INTRODUCTION
Celui qui devient prince d’une cité ou d’un État, particulièrement si la base de
son pouvoir est faible, et s’il ne veut établir ni une monarchie, ni une république,
trouvera le meilleur moyen pour conserver son pouvoir en organisant le
gouvernement de façon totalement nouvelle, comme par exemple nommer de
nouveaux gouverneurs avec de nouveaux titres, de nouveaux pouvoirs et de
nouveaux gens ; il peut rendre le pauvre riche, comme David qui, en devenant
roi, remplit de biens ceux qui étaient dans le besoin et renvoya les riches avides.
Après cela, il doit détruire les anciennes cités et en construire de nouvelles, et
transférer les habitants d’une place vers une autre ; en bref, il ne doit rien laisser
inchangé dans son royaume, de sorte qu'il ne devrait y avoir ni rang, ni grade, ni
honneur, ni richesse qui ne soit reconnu comme venant de lui. Il doit prendre
Philippe de Macédoine, père d’Alexandre, pour son modèle, qui, en procédant
ainsi, de petit roi, devint maître de toute la Grèce.
Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, I, 26.
Ce passage de Machiavel rend parfaitement compte de la politique menée par Philippe II au sein de
son royaume pendant les années 359 à 3361. Arrivé au pouvoir dans des conditions particulièrement
difficiles, Philippe II parvient, en quelques années seulement, à donner à la Macédoine une place de
tout premier ordre dans le monde grec. Après avoir repoussé les envahisseurs illyriens responsables de
la mort de son frère et prédécesseur Perdiccas III, le jeune roi affirme progressivement son autorité.
Un tel destin n’avait cependant rien d’assuré : la Macédoine jouissait d’une position géographique
ingrate, à la croisée des chemins venant de Grèce méridionale, d’Épire, d’Illyrie, de Péonie, de Thrace
et d’Asie. Aussi les prédécesseurs de Philippe II avaient-ils dû faire face à de nombreuses tentatives
d’invasion, échouant le plus souvent à protéger leur territoire à moins d’une aide extérieure. La
1 Toutes les dates mentionnées dans ce travail sont entendues, sauf indication contraire, avant J.-C.
7
situation devait cependant évoluer avec Philippe II. Un an après son avénement, il se rend maître des
terres de Haute-Macédoine. En 357, il occupe Amphipolis puis, en 356, repousse la frontière du
royaume jusqu’au Nestos en annexant Crénidès, rebaptisée Philippes. La même année, il assiège
Pydna et, deux ans plus tard, la cité voisine de Méthone. Dix ans à peine après sa prise de pouvoir, la
Chalcidique est conquise à son tour. La Macédoine atteint alors son extension maximale, près de
35 000 km². Dans l’intervalle compris entre 359 et 349, Philippe II est également élu archonte de
Thessalie et mène plusieurs opérations en Illyrie, en Péonie et en Thrace. Il obtient le contrôle de ce
dernier territoire en 340. C’est finalement l’année 338 qui marque le début de la mainmise
macédonienne sur l’ensemble de la Grèce. Après sa victoire à Chéronée, il est assuré de la coopération
des États grecs dans le cadre de la Ligue de Corinthe, et peut désormais se tourner vers l’Empire perse.
Cependant, son assassinat en 336 conduit son fils Alexandre à reprendre à son compte les ambitions de
son père. C’est à lui que revient désormais de mener les troupes macédoniennes hors d’Europe.
En un peu plus d’une vingtaine d’années, Philippe II était parvenu à tripler quasiment la taille de son
royaume et à obtenir le contrôle de l’ensemble des États voisins. De telles superficies demandaient une
réorganisation complète du territoire afin de permettre au roi d’avoir à sa disposition un royaume
pacifié et surtout unifié. L’extrait de Machiavel donne trait pour trait le détail des mesures prises par
Philippe II entre 359 et 336 et reprises ensuite par ses successeurs jusqu’en 168, date à laquelle Persée
est défait par les armées de Paul-Émile.
Définition du sujet
La présente thèse se propose d’étudier les moyens mis en œuvre par les rois de Macédoine pour
contrôler leurs possessions européennes.
Les limites chronologiques et spatiales du sujet découlent de l’étendue du royaume et de ses
possessions extérieures sous la monarchie. La période considérée s’étend sur près de quatre siècles. Le
point de départ correspond aux premiers temps du royaume, c’est-à-dire aux environs de l’année 550.
À cette date débutent les premières expéditions de conquêtes et les premières annexions territoriales. Il
faut cependant bien admettre que l’histoire du royaume n’est véritablement connue qu’à partir des
guerres médiques, au moment où Amyntas Ier, puis son fils Alexandre Ier, se trouvent directement
confrontés à l’invasion perse. Auparavant, nos informations demeurent particulièrement fragmentaires.
La date butoir de ce travail ne saurait être une autre que l’année 168, année de la défaite macédonienne
à Pydna. À ce moment, les plus éminents Macédoniens, les proches du roi, et les généraux sont
contraints de quitter le territoire sous peine de mort2. Les quelques tentatives de rétablissement de la
monarchie n’y changeront rien, bien au contraire : la révolte d’Andriscos, usurpateur au trône
macédonien en 149, avait déclenché la quatrième guerre de Macédoine et conduit Rome à transformer
2 Tite-Live XLV, 32, 2, 4.
8
l’ancien royaume qui devient en 148 une province romaine. Une dernière tentative de soulèvement en
142 ne donna pas davantage de résultats. Le royaume conquis et organisé par Philippe II avait cessé
d’exister après Pydna.
Le cadre géographique de ce travail se limite à « l’espace européen » de la Grèce antique, y compris
les îles de la mer Égée. Au cours de la période archaïque et de la période classique, le contrôle
territorial exercé par les rois de Macédoine ne s’est manifesté qu’à l’intérieur des terres conquises sous
le règne de Philippe II. On notera cependant quelques tentatives en Thessalie avant cette date. Il faut
attendre, on l’a vu, le règne de Philippe II pour que le contrôle s’exerce ailleurs que dans les limites du
royaume à proprement parler. Les royaumes hellénistiques, nés du morcellement de l’empire
d’Alexandre, n’entrent pas dans le cadre de cette étude.
Par « contrôle », nous entendons toute opération par laquelle une autorité s’assure de la conformité
d’une situation à une règle. D’après la définition qu’en donne le dictionnaire Larousse, le verbe
« contrôler » signifie à la fois « soumettre quelqu’un ou quelque chose à un contrôle pour en vérifier le
bon fonctionnement », et « maîtriser, dominer, avoir sous son autorité, quelqu’un ou quelque chose ».
Comme toute structure étatique, le royaume de Macédoine implique l’existence d’une forme de
contrôle. C’est par ce contrôle que l’on pourra s’assurer que les objectifs fixés par le roi sont atteints,
si nécessaire au moyen d’un ajustement. On distingue ainsi deux formes de contrôle :
- Le contrôle réactif, qui implique qu’un écart déclenche une action afin de rétablir la situation.
On pensera ainsi à une mesure punitive : exil, amende, intervention militaire, etc.
- Le contrôle proactif, qui se fonde sur l’idée de prévention : il s’agit d’anticiper les événements
qui, à défaut d’une action immédiate, font surgir d’autres difficultés. Cela peut aussi bien
s’apparenter à une hiérarchisation institutionnelle du royaume qu’à une présence militaire
dans une zone « à risques », agissant donc à des fins dissuasives.
En somme, le contrôle des territoires sous domination macédonienne pouvait se présenter sous deux
formes : contrôle administratif et institutionnel d’une part et contrôle militaire d’autre part.
Au cours des dernières décennies, le royaume argéade, puis antigonide, a fait l’objet d’une attention
particulière de la part des archéologues et des historiens. On dispose aujourd’hui d’une abondante
bibliographie grâce à laquelle il est possible d’appréhender la Macédoine tant dans sa globalité que sur
des questions plus précises. Pourtant, si le passage de Machiavel donne les grandes lignes de la
politique appliquée par Philippe II et ses successeurs dans leurs possessions, on ignore encore
beaucoup de la manière par laquelle le territoire était contrôlé. Ce travail tentera d’apporter un
éclairage nouveau sur cette question.
Les rois disposaient en effet de nombreux outils indispensables à un contrôle efficace : mise en place
de représentants du pouvoir royal chargés de faire appliquer les décisions à l’échelle locale,
expéditions punitives à l’égard des populations rebelles, déplacements de population destinés à éclater
9
les groupes d’opposants. Or, parmi les moyens de contrôle cités par Machiavel, il en est un qui
n’apparaît pas : les forteresses. Celles-ci jouaient pourtant un rôle essentiel tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur des frontières du royaume. Leur utilisation est en effet au cœur des enjeux territoriaux des
rois macédoniens depuis le règne des premiers Argéades jusqu’à celui de Persée. Qu’il s’agisse de
forteresses ou de cités fortifiées, l’apparition de ce type de site n’a rien d’anodin. Dans un cas comme
dans l’autre, l’existence d’une forteresse ou d’une cité fortifiée se présente comme la réponse apportée
à des impératifs militaires au sein d’une région récemment annexée qu’il était nécessaire de contrôler
ou qu’il fallait protéger des incursions ennemies, notamment aux confins du royaume.
Progressivement, ces sites sont apparus plus nombreux à mesure que le royaume macédonien
s’étendait. Depuis la découverte d’un diagramma concernant le service de garnison à Kynos identique
à celui découvert à Chalcis, il est désormais certain que les rois macédoniens disposaient d’un réseau
de forteresses soumises à une règlementation unique. De cette découverte découlait deux questions :
où se trouvaient ces forteresses ? Et étaient-elles toutes soumises à ce règlement ? Nous tenterons
d’apporter des réponses à ces interrogations.
La plupart de ces forteresses sont connues depuis leur signalement par les voyageurs du XIXe siècle.
D’autres étaient quant à elles mentionnées occasionnellement dans tel ou tel article. Cette thèse
constitue donc la première étude archéologique et historique d’ensemble traitant des forteresses et
places fortes réparties sur le territoire macédonien. En cela, elle s’inscrit dans la continuité de
l’ouvrage de J. Ober paru en 1985 intitulé Fortress Attica. Defense of the Athenian Land Frontier 404-
322 B.C., mais aussi des études plus récentes de S. Fachard, La défense du territoire. Étude de la
chôra érétrienne et de ses fortifications, parue en 2012, et de N. Coutsinas, Défenses crétoises.
Fortifications urbaines et défense du territoire en Crète aux époques classique et hellénistique, parue
en 2013. Ces deux derniers ouvrages ont été publiés peu après que j’ai moi-même achevé, en 2011, un
travail de master traitant de ces mêmes questions à l’échelle du royaume de Macédoine. Ce mémoire
ne concernait alors que les forteresses, réparties sur les sols macédoniens, thessaliens, thraces et
illyriens à un moment où ils étaient soumis aux rois Argéades puis Antigonides. Leur étude avait
révélé un rôle de premier ordre comme moyen de contrôle territorial, et il était nécessaire de leur
accorder une place centrale dans cette thèse.
Le recensement des sites proposé dans le présent travail inclut l’ensemble des sites ayant été, à un
moment ou un autre, tenus par les soldats macédoniens : 121 sites fortifiés en Macédoine, 62 en
Thessalie, 28 en Thrace, 12 en Illyrie et 18 en Grèce centrale et méridionale. Le total s’élève donc à
241 sites. Pourtant, rares sont ceux à avoir donné lieu à une étude précise, loin s’en faut. Bien au
contraire, l’immense majorité des forteresses n’est connue que par quelques lignes de description
figurant dans les rapports de fouilles. Aussi, une recherche d’ensemble menée sous un angle
d’observation nouveau, s’appuyant sur de nouveaux éléments archéologiques, et parfois
épigraphiques, était nécessaire. L’étude des sites les plus isolés a nécessité une première localisation,
10
Description:S. Le Bohec, Antigone Dôsôn, roi de Macédoine, 1993, p. 87, reprend . forçant Antigone Dôsôn à mener une expédition aux confins de son royaume pour stopper la menace (Polybe II,. 70, 1, 4-6). antique, qui passait jadis au pied de la colline, avait été décrite à la fin du XIXe siècle p