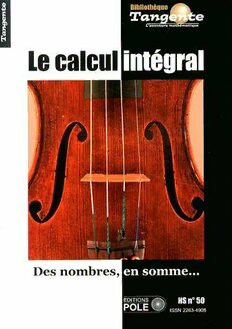Table Of Contentcalcul
le
Des no1nbres,
Bibliothèque
Tcing e
L'a.venture '"4thénia.tique
Tangente Hors-série n° 50
le calcul intégral
Des nombres, en somme ...
POLE•
© Éditions POLE - Paris - Mars 2014
Toute représentation, traduction, adaptation ou reproduction, même partielle, par tout procédé, sur
quelque support que ce soit, en tout pays, faites sans autorisation préalable, est illicite et exposerait
le contrevenant à des poursuites judiciaires (loi du 11 mars 1957).
ISBN: 9782848841571 ISSN: 2263-4908 Commission paritaire: 1016K80883
Prochaine01ent
dans la Bibliothèque Tangente
EDITIONS.
POLE
L'intégrale
Aux origines de l'intégrale
Newton vs Leibniz
L'accueil mouvementé du calcul intégral
De Cauchy à Lebesgue
Le surplus du consommateur
L'intégration en physique
L'A bel intégrale
l •X•l-}1 i3 , 1
l'intégrale de Riemann
L'intégrale, outil analytique par excellence, répond à
l'origine à un besoin de nature géométrique : calculer
l'aire délimitée par des courbes du plan.
Aire et intégrale
La quadrature de la cycloïde
La construction de l'intégrale de Cauchy
Les sommes de Darboux et de Riemann
L'intégrale de Riemann
L'intégrale pour mesurer des grandeurs
Les formules de la moyenne
l •X•l-}1 i3 ; I
Les bases du calcul intégral
Une fois l'intégrale définie et son usage délimité, se
pose la question de son calcul. Si certaines méthodes
n'exigent qu'un minimum de technique, la plupart des
intégrales nécessitent un calcul qui passe par la
détermination de primitives de la fonction à intégrer.
De la primitive à l'intégrale
L'intégration par parties
La technique du changement de variable
Les règles de Bioche
Les méthodes de quadrature
Calcul approché d'intégrales
Les méthodes de Monte-Carlo
Les théorèmes de Guldin
L'élégance de l'intégration terme à terme
La formule de Wallis
(suite du sommaire au verso)
Hors série n° 50.
I •I • 1i 4 , 1
f}
Extensions de la notion d'intégrale
L'histoire de l'intégrale ne s'arrête pas avec Riemann,
ni même avec Lebesgue ! Sa construction non plus. De
nombreux mathématiciens ont cherché à étendre la
notion d'intégrale à des classes de fonctions de plus
en plus générales, pour simplifier la présentation ou
pour les besoins d'une application.
Les intégrales multiples
L'intégrale de Stieltjes
Théorie de la mesure et intégrale de Lebesgue
Y a-t-il une intégrale après Lebesgue?
Le passage difficile de l'intégrale de Riemann
à l'intégrale stochastique
Dérivées et intégrales dans le monde des o et des 1
Intégration dans le plan complexe :
Le théorème des résidus
La puissance de l'intégration fractionnaire
Les intégrales de Coxeter
l •X•f$ 1 i4 , 1
l'intégrale en analyse
L'intégrale est omniprésente en mathématiques et
dans les applications. Elle intervient aussi bien en
physique qu'en théorie du signal ou en tomographie,
et dans pratiquement tous les domaines de l'ingénie
rie et de la finance.
Convergence d'intégrales impropres
Intégrales de Fresnel, intégrale de Poisson
Suites et fonctions définies par une intégrale
Calcul de pi
Les intégrales eulériennes
La transformée de Laplace
Série et transformée de Fourier
Les atouts de la comparaison entre série et intégrale
Intégrales de bases
Le produit de convolution
En bref
Problèmes
Solutions
Ta.ngente Hors série n° 50. L'intégrale
par A. Zalmanski & E. Thomas EN BREF
L'origine étymologique d'un mot, dans son intégralité
Comme beaucoup de mots du vocabulaire mathéma ments. » Le nom sera rendu au langage courant pour par
tique tels qu 'ellipse, hyperbole ou dérivée, intégrale a ler d'œuvre littéraire ou musicale: l'intégrale des sym
été emprunté par les mathématiques au langage usuel. phonie de Schubert, l'intégrale de la poésie de Baudelaire ...
Sa filiation en est pourtant plus noble puisque l'adjec
tif intégral est un dérivé-paradoxal, non?-savant du On notera que le verbe inté
latin classique integer - venu lui-même de in- (priva ANALYSE grer avait été, quant à lui,
DES MESUII.ES
tit) et trangerer (toucher). Il signifiait donc « entier, emprunté, dès 1340, au latin
complet, intact». Il est attesté vers 1370 par Oresme, UDUCTION OIS lN'TIIOaALU integrare («réparer, renouve
AUX LOGARITHMES,
dans le sens, encore vivant au XVIIe siècle, de « qui ler, et par extension recréer). Il
contribue à la qualité du tout». Il est repris au XVII° siècle sera repris en mathématiques
pour qualifier ce qui n'est l'objet d'aucune diminution, dans le sens de « effectuer I' in
....... .
d'aucune restriction -donc entier. Cette acception, prise ... tégration de» .
a.., ~'.:!h'::~.i.~!"C.:
au sens moral, fournira intègre. ,,r.,.,.,,U~ut,-•1rn1ru -1•v..-i. Le verbe fournira par la suite
À la fin du XYil" siècle, le mathématicien Jacques Ber de nombreux termes mathé
noulli empruntera au latin moderne l'emploi de l'adjectif matiques : intégrable, intégrabilité, intégrateur. .. À la
integralis en mathématiques, pour parler de « calcul fin du XIXe siècle, il reversera à l'argot étudiant le sens
intégral ». En même temps apparaîtront les termes de« rentrer», puis dans le langage courant, celui d'en
mathématiques intégrer et intégration. Il faudra attendre trer dans un ensemble. L'informatique l'a repris récem
1749 pour voir imprimer le mot intégrale dans un ment à son compte pour désigner! 'incorporation d'un
ouvrage. Charles Walmesley ! 'emploie dans le sens sous-programme ou d'un graphisme dans un logiciel
« somme totale », par opposition à « somme d'élé- ou dans une page Web.
Quel est l'animal qui inuenta le calcul intégral 7
En 1967, le chanteur pour pseudonyme Évariste et se lance dans la pop.
populaire Évariste pose Sa chanson « Connais-tu l'animal qui inventa l' cal
la question suivante, qui cul intégral?» est déjantée, mais truffée de clins
lui apportera un succès d'œil aux mathématiques.
commercial certain : En particulier, le légendaire mathématicien fran
« Connais-tu l'animal çais Évariste Galois (1811- 1832, voir Tangente
qui inventa ['calcul inté Sup 60) est évoqué sous la forme d 'Evarix le Gau
gral ?» (Dise' AZ, EP lois, qui permet de rebondir sur Aplusbegalix, du
1088). nom du chef qui défie Abraracourcix dans Astérix :
En fait, Joël Sternheimer (de son vrai nom) était le combat des chefs (Hachette, 1967).
à l'époque un brillant chercheur français. Doc Et dès le début de la chanson il prolonge la ques
teur en physique théorique à 23 ans (après une tion que pose le titre : « Est-ce Leibniz ou bien
licence de sciences mathématiques), il était assis Newton ou bien est-ce que c'est moi qui déconne ? »
tant à Princeton auprès du célèbre Eugene Wigner, La réponse se trouve dans ce numéro !
prix Nobel de physique en 1963. Mais en 1966 les Après ce succès éphémère, Joël Stemheimer s'ins
frais de la guerre du Yiêt Nam conduisent à des tallera comme chercheur indépendant, essentiel
restrictions de postes dans les universités améri lement dans le domaine de la biologie végétale.
caines. En particulier, celui de Joël Sternheimer Mais on pourra retenir que grâce à lui des milliers
est supprimé. de personnes se sont peut-être demandé qui, de
S'inspirant alors du phénomène Antoine, chanteur Newton ou de Leibniz, a bien pu inventer le cal
iconoclaste diplômé de l'École centrale, il prend cul intégral. Et ce n'est déjà pas si (ani)mal.
Hors-série n° 50. L'intégrale Tangente
HISTOIRES par Élisabeth Busser
Hux origines de l'intégrale
D'Hrchimède à Pascal
Les mathématiciens ont, depuis l'A ntiquité, mis beaucoup
d'énergie dans le calcul des aires, d'où est née la théorie de la
mesure et de l'intégration. Parmi les précurseurs, on trouve
Archimède, Cavalieri, Fermat, Pascal et bien d'autres. Leur
approche est essentiellement géométrique.
Parti de la méthcxle d'exhaustion des ginez deux disques, D de diamètre d et
géomètres grecs Euclide, Eudoxe d'aire a et D' de diamètre d' et d'aire
puis Archimède, cheminant avec a'. Il s'agit de comparer les rapports
les améliorations des savants arabes, dl d' et al a', ou plus exactement de
prenant corps, mais sous le feu de la cri démontrer que al a' est égal au carré de
tique, avec Cavalieri et ses « indivi dl d'. Champions du raisonnement par
sibles», mis en beauté par les découpages l'absurde, les Grecs vont ici l'utiliser à
de Fermat ou Pascal, le calcul intégral plein : si, par exemple, al a' était stric
a mis deux millénaires à s'établir. Retour tement supérieur à (dl d')2, il existerait
sur sa préhistoire. un disque ~d'aire b telle que
bla' = (dld')2 et on aurait alors a> b.
Hrchimède, le précurseur C'est donc que l'on peut inscrire dans
le disque Dun polygone d'aire c telle que
Ce sont les travaux d' Antiphon, contem c soit entre a et b, soit a> c > b. Si on
porain de Socrate (vers 430 avant notre inscrit, parallèlement, dans le disque D'
ère), puis ceux, malheureusement per un polygone d'aire c' semblable à D, on
dus, d'Eudoxe de Cnide (-408, -355), sait pour l'avoir déjà démontré que
repris au Livre V des Éléments d'Eu clc' = (dld')2 = bla'. Or a'> c' ,donc
clide (-330, -275), qui ont permis aux bla' < bic' et on aurait ainsi c < b, en
géomètres grecs de développer leur contradiction avec la position de ~ et
méthode d'exhaustion et de l'appliquer du polygone d'aire c. On démontre de
aux calculs d'aires et de volumes. Elle même que ala' ne peut pas être non
est l'ancêtre du calcul intégral. plus strictement inférieur à (dl d')2. C'est
Reposant sur un principe simple, elle donc que finalement al a'= (dl d')2. La
va lier les rapports d'aires et de lon méthode servit en particulier à Archi
gueurs ou ceux de volumes et d'aires. Ima- mède à calculer l'aire du cercle: le cal
cul d'aires autre que celles de polygones
était né !
La méthode d'exhaustion, appliquée
Archimède a même fait mieux que cal
aux calculs d'aires et de volumes,
culer l'aire du cercle; il a calculé celle
est l'ancêtre dù calcul intégral. du segment de parabole, c'est-à-dire
Tcingente Hors-série n°SO. L'intégrale
la quadrature de la parabole par Archimède
Archimède écrit son traité la Quadrature de la parabole (Ille siècle
8 avant notre ère) sous forme de lettres. À son ami Dosithée, il envoie
une méthode géométrique, réservant une méthode« mécanique», par
pesées, à Ératosthène.
N'utilisant que la seule géométrie, il construit à l'intérieur du seg
ment de parabole dont il veut déterminer l'aire un premier triangle
dont la médiane est parallèle à l'axe de symétrie de la parabole,
démontrant au passage que son aire est maximale.
À Dosithée, il écrit : « Tout segment compris entre une droite et une
parabole est équivalent aux quatre tiers du triangle ayant même base
C et même hauteur que le segment» et il le démontre en utilisant une
itération de la construction : triangles ADC et BEC, etc., construits sur le modèle du triangle
ABC. Se fondant sur les propriétés de la parabole (F milieu de [AB], H de [AC], 1 de [BC]), il
obtient que la somme des aires des deux triangles ADC et BEC est le quart de celle du triangle
ABC. Il construit ainsi, étape après étape, une suite géométrique de raison 1/ 4 et il s'avère que,
après1 n) étapes, l'aire polygonale Pn obtenue est égale à
n+I
(
l- 4 1 (1)"
4
----= - x Aire(ABC) - - x - x Aire(ABC).
1-! 3 3 4
4
Là s'exprime encore une fois tout le génie du géomètre grec : contournant ce que nous appel
lerions aujourd'hui le« passage à la limite», il privilégie une méthode d'exhaustion.
Considérant qu'au bout d'un nombre n assez grand d'étapes l'aire P n est comprise entre
~Aire(ABC) et l'aire S du segment de parabole, il utilise« sa» double réduction à l'absurde:
3
• Si S était supérieure à ~Aire(ABC), on aurait
3
}) n+I]
4 4
P. = [1 -(4 x 3 x Aire(ABC), donc P n :S3 Aire(ABC). Contradiction.
• Si S était inférieure à ~ Aire(ABC),Archimède montre qu'on aurait P n > S, tout aussi absurde
3
vu la construction de P n· Voilà donc démontrée la propriété annoncée à Dosithée.
D'. disque d'aire a',
de diamèLre t/'
l'aire comprise entre une parabole, qu'il
appelait fort justement « section du cône
D. diaque d'aile o.
de dillnl,ae d rectangle », et une droite en utilisant
également pour ce faire un double rai
sonnement par l'absurde, identique à
Polygone celui de la méthode d'exhaustion.
d'aire c
Après les Grecs, les mathématiciens
arabes du Moyen Âge ne sont pas en
à, diaque
d'm b
La méthode d'exhaustion.
Hors-série n• 50. L'intégrale Tangente
HISTOIRES Aux origines de l'intégrale
reste. Ayant traduit en arabe les textes Les géomètres grecs comme les mathé
des géomètres grecs, ils vont perfec maticiens arabes l'avaient bien com
tionner leurs méthodes. C'est ainsi que pris : pour calculer une aire, mieux vaut
Thabit Ibn Qurra (836-901) et Ibn al-Hay la découper en morceaux, de préférence
tham (965- 1040), plus connu sous le très petits, mais cela va forcément mettre
nom de Alhazen, découpent autrement en jeu des techniques infinitésimales,
la surface du demi-segment de parabole parfois controversées. Ainsi, Bonaven
en choisissant des droites dont les dis tura Cavalieri (1598-1647), mathéma
tances sont proportionnelles aux entiers ticien italien qui avait lu Euclide et
impairs, ce qui simplifie les calculs. lis s'inspirait de la méthode d'exhaustion
font, comme ils l'ont appris des Grecs, d'Archimède autant que de celle de
appel à un double raisonnement par l'ab Kepler sur la théorie des quantités infi
surde pour conclure, ce que nous ferions niment petites, bâtit vers 1629 sa théo
aujourd'hui par un simple passage à la rie des indivisibles pour calculer aires et
limite. Alhazen va plus loin en calcu volumes. Pour lui, une surface plane est
lant le volume du solide engendré par la une juxtaposition de lignes parallèles,
rotation de ce segment de parabole autour segments - comme si on empilait des
de divers axes, anticipant ainsi sur le feuilles de papier - ou arcs de cercles
calcul des volumes par intégration. concentriques, les indivisibles, pour
s'inspirer de la terminologie de Kepler.
Caualieri, le successeur
Dans sa théorie, deux surfaces qui seraient
constituées de lignes de la même longueur
seraient égales, deux surfaces qui seraient
constituées de lignes toujours dans le
même rapport seraient elles aussi dans
le même rapport. Pour Cavalieri, donc,
la surface d'un parallélogramme de hau
teur b et de base a est, tout comme celle
d'un rectangle de mêmes dimensions,
constituée de segments (les fameux indi
visibles) tous de longueur a, comme sur
le dessin. Il conclut qu'elles ont même
aire, soit le produit de a par b.
Il établit de la même façon une cor
respondance entre un cercle de rayon
a et une ellipse de grand axe b et de
petit axe a, comprises toutes deux entre
des parallèles de distance 2a. Les indi
visibles sont ici dans le rapport b /a,
qui est donc celui de l'aire de l'ellipse
à l'aire du cercle. L'ellipse a donc pour
aire (b/a) x na2 = nab. Cavalieri uti
lise encore ce principe pour comparer
non plus les lignes, mais les puissances
Bonaventura Francesco Cavalieri (1598-1647). des lignes comme celles d'un parallé
logramme et d'un triangle constitué par
un demi-parallélogramme.
Tangente Hors-série n"SO. L'intégrale