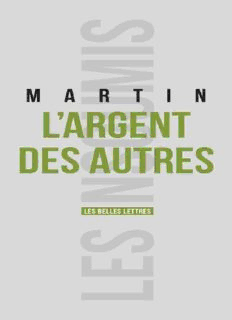Table Of Contentcollection dirigée par
patrick smets
parus
PAscal salin,
libérons-nous !
cédric parren,
le silence de la loi
françois monti,
prohibitions
benoît malbranque,
d’or et de papier
à paraître
Copeau,
Les Rentiers de la Gloire
Pierre-Olivier Drai,
Self-sécurité
www.lesbelleslettres.com
Retrouvez Les Belles Lettres
sur Facebook et Twitter.
© 2014, Société d’édition Les Belles Lettres
95 bd Raspail 75006 Paris.
ISBN : 978-2-251-90051-3
Réalisation de l’ePub : Desk
À Pauline
INTRODUCTION
Je tiens ma fille dans mes bras, elle a à peine deux mois. Elle est totalement
dépendante de moi. J’en suis responsable : je dois être un bon père, la nourrir, la
changer, la consoler quand elle pleure, la protéger.
La protéger. C’est pourquoi je veux comprendre comment Pauline est née avec
une dette de 26 000 euros, gracieusement léguée par la génération de mes
parents et celle de mes grands-parents – mais aussi la mienne. La « génération
68 » notamment, éprise de liberté mais, visiblement, pas vraiment de
responsabilité, s’est voté des droits bien sympathiques, des retraites
confortables, etc. en envoyant la facture aux générations futures, à Pauline… en
appelant cela de la « solidarité » ! Tranquillement – avec l’argent des autres.
Il semblerait de prime abord que cette (ir)responsabilité soit collective. Mais
derrière ce collectif se cache chacun d’entre nous. L’irresponsabilité collective
est le symptôme, l’aboutissement au niveau collectif de mécanismes
institutionnalisés d’irresponsabilité individuelle. La responsabilité individuelle,
cette capacité de répondre de ses actes quand on commet des erreurs, me semble
être le fondement, le liant, d’une société dite civilisée. Elle tend à se diluer à
grande vitesse, notamment dans les champs économique et politique. Je veux
donc comprendre comment nous sommes devenus cette société à
irresponsabilité illimitée.
Crise de l’endettement donc, mais aussi crise de l’euro, crise des subprimes :
comment en sommes-nous arrivés là ? Comment est-il possible qu’avec tous les
esprits si intelligents qui nous gouvernent, flanqués d’étages entiers de
commissaires, de régulateurs et de planificateurs à Paris, à Bruxelles ou à
Washington, secondés, en France, par une armée d’énarques et de
polytechniciens, nous connaissions une telle crise ? Comment les centaines de
milliers de pages de législations, de régulations, de directives et autres décrets
qui encadrent nos vies ne nous ont-elles pas épargné ces revers de fortune ?
Mystère ? Non. Et c’est ce que je tenterai de décortiquer ici en faisant usage,
d’une manière très simple, de l’analyse économique.
LE POINT DE VUE
ÉCONOMIQUE
L’économie, ce n’est pas si compliqué
Les économistes passent souvent pour des espèces de marabouts des temps
modernes, eux qui s’adonnent souvent à la prévision économique avec de
magnifiques modèles bourrés d’équations compliquées. Peut-être,
paradoxalement, parce que ces économistes-là n’ont pas vraiment compris
l’économie, d’ailleurs. Une économie est éminemment imprévisible, du fait de
l’innovation, de la nouveauté, du changement perpétuel et des surprises que ce
dernier porte. Étant donné les erreurs manifestes de prévisions, il n’est pas
étonnant qu’on ait bien souvent pu qualifier des économistes de charlatans.
Cependant la compréhension économique des phénomènes est importante et
permet d’éclairer l’action politique. Elle est moins précise, plus qualitative, et se
penche davantage sur la direction probable qu’un système va prendre. Non sur la
base de statistiques bien précises et d’équations mais plutôt sur une
compréhension des mécanismes profonds d’une économie, dont l’élément
premier est l’homme.
En été 2006 par exemple, un économiste américain, Peter Schiff, prédisait,
contre le consensus de l’époque et deux ans en avance, l’écroulement de
l’économie américaine. Parce qu’il avait compris son caractère « bullaire ». Il
avait compris que la croissance américaine était en fait fondée sur un système
généralisé d’endettement irresponsable : insoutenable à long terme.
En réalité, « voir la vie de façon économique » n’a rien de très compliqué.
L’économie (mondiale ou d’un pays) en elle-même est d’une inimaginable
complexité bien sûr. Mais l’analyse économique peut se ramener à quelques
idées de bon sens que nous explorerons en toute simplicité tout au long de ces
quelques pages. Elles nous permettront ainsi de dérouler le fil de la
déresponsabilisation, cause première des crises que nous vivons.
Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas
L’économiste français du xixe siècle Frédéric Bastiat disait qu’un bon
économiste est celui qui est capable de percevoir non seulement « ce qu’on
voit » mais, surtout, « ce qu’on ne voit pas », c’est-à-dire les effets induits de
telle ou telle mesure, qui ne sont pas évidents, qui ne se voient pas tout de suite,
mais qui sont bien réels : les « conséquences inattendues ».
Un homme politique arrive, tel le Père Noël, avec une mesure politique pleine
de bonnes intentions pour certaines catégories. Les gens, tout heureux, qui
reçoivent ce « cadeau » politique, c’est « ce qu’on voit ». Les autres
conséquences moins visibles, qui ont un coût énorme, c’est « ce qu’on ne voit
pas » (et l’art du politique est bien évidemment de cacher ces coûts). Méfions-
nous donc de la politique des bonnes intentions et pensons toujours aux
conséquences inattendues.
Ainsi, en 2002, le président américain George W. Bush propose l’American
Dream Downpayment Act, une loi visant à subventionner l’apport personnel de
ménages pauvres désireux d’acheter une maison à crédit. C’est beau. C’est
compassionnel. C’est « social ». Sauf évidemment que l’on a permis (en
combinaison avec d’autres politiques que nous verrons plus loin) de s’endetter à
des gens qui ne pouvaient en réalité pas emprunter ; et donc pas rembourser.
L’apport personnel est un signal important de fiabilité et de sérieux de la part de
l’emprunteur aux yeux du prêteur. Le supprimer a coupé cette étape
fondamentale du « contrôle » de fiabilité. La suite de l’histoire, c’est la crise des
subprimes.
D’une certaine manière l’économie c’est un peu comme l’ostéopathie. Vous
avez mal dans le cou, mais en fait le problème vient peut-être des pieds, qui sont
déséquilibrés par exemple. L’ostéopathe doit donc remonter toute la chaîne de
causalité qui se propage à travers les muscles et articulations du dos, des
jambes, etc. et trouver le point d’origine du problème pour vous soulager.
Exactement comme l’on peut tenter de prédire les effets, en économie il faut
aussi réfléchir à ces causes « que l’on ne voit pas » instantanément, et mieux
saisir les raisons ultimes d’un blocage par exemple (on parle doctement
d’analyse causale-génétique puisqu’on « remonte dans les causes »).
Le marché du logement fournit une bonne illustration. Il y aurait une « crise du
logement » en France. Loyers inabordables, propriétaires trop regardants,
pénurie. « Le marché ne fonctionne pas ! » nous explique-t-on, « le
gouvernement doit intervenir ! ». À ceci près que si « le marché ne fonctionne
pas » c’est peut-être du fait d’interventions existantes qui l’en empêchent,
justement. Les SCOT (schéma de cohérence territoriale) et PLU (plan local
d’urbanisme) sont devenus si restrictifs par endroits qu’il est presque impossible
de construire dans certaines villes : l’offre étant restreinte par la réglementation
elle-même, faut-il s’étonner de la pénurie et de l’augmentation des prix ?
De même, les lois sur la protection des locataires mauvais payeurs – partant
d’un bon sentiment, celui de protéger le « gentil » locataire contre le « méchant »
propriétaire – ont permis aux locataires mauvais payeurs de profiter du système.
Résultat ? Les propriétaires ont peur de louer, préférant parfois laisser leur bien
vacant, ou demandant des garanties telles, que seules les personnes aisées
peuvent avoir accès à la location. La réglementation a ici bloqué le marché :
évidemment qu’il ne fonctionne pas !
Il importe donc de toujours regarder un peu plus loin et de se demander si le
problème social ou économique auquel on fait face n’a pas des causes dans les
politiques mêmes déjà mises en place, notamment les politiques pleines de
bonnes intentions.
Les incitations, ça compte
Voilà une idée importante en économie, qu’un petit exemple permettra
d’éclairer aisément.
Nous sommes un samedi matin au milieu des années quatre-vingt. Voilà plus
de dix minutes que nous attendons, mes parents et moi, dans la voiture coincée
dans le mini-embouteillage à l’entrée du supermarché. Une des raisons
principales ? Les clients ne remettent pas les chariots du supermarché à leur
place après avoir déchargé leurs courses dans leur coffre de voiture. Résultat : les
chariots laissés au milieu du parking empêchent une bonne partie des voitures
non seulement de circuler correctement à l’intérieur du parking mais aussi de se
garer. D’où le bouchon.
Aujourd’hui les chariots sont bien rangés. Miracle ? Non. Un ingénieur futé,
peut-être inconsciemment bon économiste, a pensé à ce système dans lequel il
faut glisser une pièce de 1 euro pour obtenir un chariot, et remettre le chariot à sa
place pour récupérer sa pièce. Autrement dit un système « incitatif ». Le
problème des chariots mal rangés a été résolu en modifiant les incitations des
Description:À l'aide de quelques principes simples de l analyse économique, l auteur montre comment la responsabilité a déserté l économie et la politique. Depuis des années, États régulateurs et groupes financiers ont fait disparaître le vrai capitalisme au profit d un capitalisme de connivence. Para