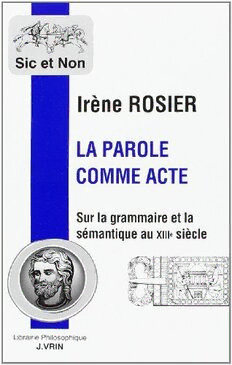Table Of ContentDU MEME AUTEUR
La gram1naire speculative des Modistes. Lille, Presses Uni- Sic et Non
versitaires, 1983.
(ed.), L'ambigui"te, cinq hudes historiques. Lille, Presses Uni-
Collection dirig6e par Alain de LIBERA
versitaires, 1988.
(ed.), L'hi!ritage des grammairiens Latins, de l'Antiquite aux
Lumieres. Louvain, Peeters, 1988.
LA PAROLE
DANS LA MEME COLLECTION COMMEACTE
ABELARD : Des intellections. Texte etabli (latin en vis-a-vis),
introduit, traduit et commente par Patrick MORIN, 176 pages.
BURIDAN : Sophismes. Texte introduit, traduit et annote par Joel
BIARD, 304 pages.
MICHON Cyrille : Nominalisme. La theorie de la Signification de Sur la grammaire et la semantique au XIJ/e siecle
Guillaume d'Occam, 528 pages.
par
EN PREPARATION
ALBERT LE GRAND : Sur I 'Intellect. Texte introduit, traduit et Irene ROSIER
annote par Alain de LIBERA.
Directeur de Recherches au C.N.R.S.
ROGER BACON : Sur les signes. Texte introduit, traduit et annote
par Laurent CESALLI.
GUILLAUME HEYTESBURY : Sophisn1ata asinina. Une introduction
aux disputes logiques du Mayen Age. Presentation, edition
critique et analyse par Fabienne P!RONET.
JEAN DE LA ROCHELLE : Summa de anima (extraits). Texte etabli
(latin en vis-a-vis), introduit, traduit et annote, par J.-G.
BouoEROL.
PARIS
LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE J. VRIN
6, Place de la Sorbonne, ye
1994
A vant-propos
La parole comme acte au XIIIe siecle. Ce titre 6voquera in6vita-
Cll/V
blement des travaux recents sur le langage, qu' il s. agisse de la
philosophie dite du langage ordinaire d' Austin ou Searle, ou des
a
linguistes travaillant dans le cadre de I' enonciation, de Ch. Bailly E.
Benveniste, 0. Ducrot ou A. Culioli. Le XIII' siecle fera penser aux
premieres universit6s et aux grandes syntheses scolastiques. Et il sera
bien question dans ce livre de l'histoire d'un courant d'id6es linguis-
tiques meconnu, proposant une conception dynarnique de la parole,
profond6ment ancree dans son siecle.
Ce courant peut se caract6riser par deux theses fortes. La premiere
est que la valeur d'un enonce ne peut etre appr6ciee qu'en rapportant le
sens produit au sens vise. Elle permet de rendre compte de la correc-
La loi du 11mars1957 n'autorisant, aux termes des alin6as 2 et 3 de tion et la compl6tude des enonces, plus generalement de leur
l'article 41, d'une part, que les «copies ou reproductions strictement production et de leur interpretation, et, au-delft, de la dialectique entre
r6servees a !'usage prive du copiste et non destinCes a une utilisation le sensible et !'intelligible qui definit la signification. La seconde these
collective» et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans est la reconnaissance d' une opposition entre deux types d' enonces, ceux
un but d'exemple et d'illustration, «toute representation ou reproduction qui servent a signifier et ceux qui servent a agir. Ces deux theses
int€grale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses trouvent leur place dans une conception globale qui cherche a articuler
ayants droit ou ayants cause, est illicite» (Alin€a ler de l' article 40). les relations complexes entre ce qui est donne et ce qui est produit,
Cette representation ou reproduction, par quelque procecte que ce entre la convention et l'enonciation (prolatio).
soit, constituerait done une contrefagon sanctionnCe par les Articles 425 Je m'etais d'abord interessee aux traites sur les «Modes de
et suivants du Code penal. signifier», fascinants par leur dimension a la fois philosophique et
formaliste. Roger Bacon, compare aux Modistes, faisait ensuite figure
de marginal. Son insistance sur l' intention de signifier, son interet pour
© Librairie Philosophique J. VRIN, 1994 les 6nonc6s figures OU elliptiques, Sa description des diff6rents niveaux
de sens, 6taient des themes absents des trait6s modistes. Or il s' est avere
Printed in France
qu'avant Roger Bacon, il y avail Robert Kilwardby, et que gravitaient
ISSN 1248-7279
autour d'eux une foule d'auteurs anonymes dont les id6es donnaient,
ISBN 2-7116-1202-3
ignorees, dans des manusc1its, depuis le x111e siecle ...
8 La parole com1ne acte Avant-propos 9
Dans les pages qui suivent, le lecteur reconnaitra des problemes, II fallait tenter de comprendre, en synchronie, le fonctionnement et
des notions, des distinctions qui lui rappelleront des questions actuelles, la coherence des doctrines rencontrees, et de restituer le cadre qui en
citons en vrac les actes de discours, la notion de force illocutionnaire, avait penni I' en1ergence. Rechercher des ancetres OU des precurseurs
l' opposition entre signification conventionnelle et signification inten- des theories de I'enonciation n'etait pas, pour moi, la tilche prioritaire.
tionnelle, la distinction CnoncC/ Cnonciation, etc. Ces thCmatiques Ce n'est done pas dans une perspective archeologique que j'ai voulu
contemporaines ne sont certes pas sans avoir orientC ma recherche. travailler. On ne trouvera pas de ce fait dans ces pages les paralleles
Plus prCcisCment, j'ai retenu de l'enseignement d'A. Culioli deux avec la pensee linguistique contemporaine, qui, sur le plan de 1'6va-
de ses idCes fortes: que le langage est une activitC syrnbolique et luation ou de la portee heuristique des theories medievales seraient
intersubjective et qu'une thCorie du langage est une analyse des formes utiles, et restent a faire. La demarche historique que j'ai voulu adopter
linguistiques, con9ues comme des marqueurs ou des rCsultats d'opC- me se1nblait seule possible, dans un premier temps, pour se prevenir
a
rations. J'ai ete ainsi tres sensible l'ilnportance qu'accordaient d'une lecture anachronique qui aurait n6cessairement procede par
Kilwardby ou Bacon, au couple locuteur I auditeur. Par ailleurs, dans preievements ponctuels d'elements arbitrairement selectionnes, appau-
l' analyse des constructions figurees ou des variations linguistiques vrissant necessairement le corpus de depart. Elle etait aussi motivee, ii
acceptables en general, mes auteurs appliquaient un principe que l' on faut le reconnaltre, par une curiosite historique, un etonnement devant
pourrait citer en paraphrasant une formule culiolienne, selon lequel Jes ramifications et intrications des reflexions des medievaux sur le
toute variation de forme est l'indice d'une variation de sens, cette langage, jusque dans leurs aspects Jes plus techniques et Jes plus
derniere etant pour eux la trace d'une intention de signifier. Pour sophistiques.
prendre un exemple, minime en apparence, le go n 'etait pas equivalent Pour le clerc-gramrnairien, le pretre qui <lit In nomine Patris et
de ego le go, contrairement a ce qu' affirmaient les Modistes. Pour eux, .filii et spiritus sane ti, « exerce la benediction». S' interesser a ce type
a
si deux formes proches sont distinctes, c'est que cette distinction est la d'enonces a des consequences importantes: constater qu'il est
a
fois possible et significative. Enfin, l'approche que je cherchais inco1nplet, qu'il a une certaine force, qu'il ne nom1ne pas l'acte qu'il
decrire ne semblait pas relever, au sens strict, d'une pragmatique du effectue, etc. En tant qu' analyste du Ian gage, il voit sa parente avec
langage, puisque l'objet n'etait pas l'acte de langage en tant que tel. Ce d' autres sequences, et releve qu' en utilisant le vocatif 0 maftre ! , on
type d'approche trouverait plut6t sa place, au Moyen Age, dans Jes appelle quelqu 'un, et en pronon9ant Un, deux, trois on compte, on ne
chapitres ecrits par les theologiens ou les juristes, sur les vceux, les denote pas des chiffres. En tant que philosophe, il conna!t l' opposition
serments, les formules sacramentaires etc. et l'on aura d'ailleurs aristotelicienne entre le speculatif et le pratique, le rationnel et
1' occasion de faire de breves incursions dans ces domaines. Les auteurs l'affectif. Il lui est ainsi naturel d'invoquer ces distinctions pour
du courant qui m'interessait etaient des gramrnailiens, dont l'objet etait appuyer sa description. Et il peut aussi faire intervenir bien d'autres
a
les enonces. C'est partir de leurs particularites formelles que, pans du savoir, de la psychologie a l'astrologie, et passant par la
notamrnent, ils etaient amenes ap oser que certains avaient la propriete biologie ou la philosophie naturelle. C' est ce type de parcours, indique
de permettre au locuteur ct' «effectuer des actes ». par Ies auteurs eux-mCmes, signale par les choix terminologiques
Tous ces auteurs etaient des grammairiens, mais cette approche quand des notions nouvelles etaient introduites (acte exerce, sens vise)
centree sur !'intention de signifier, l'acle de parole et l'interlocution que j, ai cherche a explorer.
etait nouvelle dans la tradition grammaticale. Par ailleurs, ils n' etaient J' ai done voulu faire un travail d 'historien des idees linguistiques
pas seule1nent des grammairiens. C' etaient des clercs, maltres de la qui soit un travail d'historien tout court. Le lecteur s'apercevra chemin
faculte des Arts, des «artistes», des logiciens et des philosophes, par faisant que ce n'est pas par gofit de l'exotisme qu'une recherche sur les
consequent. Un Roger Bacon avait aborde la question du langage dans theories du langage est a1nenee a parler de l' envoO.tement ( « fascina-
des ouvrages relevant de genres differents, le concevant dans un cadre tion » ), a passer de la semiologie a l' astrologie, de la grammaire a la
serniologique d'ensemble, et d6crivant son caractere efficace en se theologie. 11 constatera aussi que les enjeux des discussions des
fondant sur des traites de magie ou d'optique. Cette diversit6 et cette grammairiens ne concernent pas simpJement l'analyse de la parole,
cornplexite ne pouvaient etre ignorees. mais touchent a des questions aussi importantes que les relations entre
IO
"La parole comme acte
a1istotelisme et augustinisrne. II verra enfin, avec Roger Bacon, que la
conception d'une parole comme acte participe d'une certaine vision de
l 'homme, Stre volontaire et rationnel, dote de libre-arbitre et situe
dans le cosmos.
*
* *
J' exp rime ma reconnaissance a taus les amis et collegues qui, Introduction
depuis plusieurs annees, ant accompagne ma route. Plusieurs d'entre
eux m' ant fait b6n6ficier de leurs remarques en Iisant tout ou partie de
cet ouvrage, Joel Biard, Christine Brousseau, Jeremiah Hackett, Serge
Lusignan et Claude Panaccio. Nina Catach s'est n1ontree une lectrice
attentive et une conseillere de taus les instants. Je dais beaucoup a Jean L' approche « intentionaliste »
Stefanini et Jean-Claude Chevalier, pionniers dans le domaine de
L'on connalt principalement des theories linguistiques m6di6vales
l'histoire des id6es linguistiques, et qui furent mes premiers maitres. Je a
les trait6s De Modis Significandi, grftce de nombreuses 6ditions et des
remercie Sylvain Auroux, directeur de 1'6quipe de recherches a a
laquelle j'appartiens (CNRS-UA 381), pour des discussions toujours etudes approfondies 1• Ces traites, qui apparaissent Paris dans !es
annees 1270 proposent, de maniere originale, une analyse du langage
stimulantes. Je souhaite remercier tout particulierement Sten Ebbesen,
fondee sur une ontologie et une psychologie. !ls combinent des
guide g6n6reux et critique exigeant, et Alain de Libera, qui, par son
retlexions.Televant de la phi!osophie du langage et d'autres qui SOnt
enseignement, m'a incit6e a sortir des sentiers battus, et a suivi,
proprement grammaticales, 1'616ment le plus int6ressant 6tant certaine-
toujours avec amitie et confiance, l' elaboration de ce travail.
ment l' articulation de la description des constituants linguistiques de
base et des regles de la syntaxe, permettant de definir automatiquement
la correction et la compl6tude des 6nonc6s. Le fait que les constituants
comme les regles soient d6finis en termes d'une notion unique, celle de
«mode de signifier», qui se fonde elle-meme de maniere ind6pendante
sur un <<mode d'etre» au plan de la r6alit6, et un «mode d'intelliger »
au plan de la pensee, confore au systeme elabore par !es Modistes une
coherence remarquable et explicitement revendiqu6e.
Nous voulons ici centrer notre attention sur un ensemble de textes
relevant egalement de la production universitaire du XIII' siecle, mais
pour une p6riode au moins en partie ant6rieure. Les contours de cet
ensemble sont assez flous: si l'on excepte deux auteurs d'origine
anglaise, Robert Kilwardby et Roger Bacon, ii sera constitue en grande
partie d'6crits anonymes et le plus souvent in6dits, de cornmentaires, de
sophisrnes, de questions. De cet ensemble se d6gage n6amoins claire-
ment une apptoche particuliere des phenomenes langagiers, au point
1. Pinborg 1967, Bursill-Hall 1971, Rosier 1983, Covington 1984, etc. V?ir
la discussion critique de Larobertini 1989, notre article bibliographique (Rosier
l 990b), et les presentations synthetiques de MaierU 1990 et Libera et Rosier 1992.
L'ouvrage de C. Marmo 1994 en donne un expose d'ensemble, integrant les
recherches les plus recentes et une analyse de mat6riaux nouveaux.
12 W parole comme acte Introduction 13
que l'on pourra parler d'un veritable «Courant» doctrinal. P1usieurs tions de possibilite d' emergence de telle OU telle notion. Nous devrons
traits la caract6risent: le r6le de I' interlocution, avec la prise en considerer les problCmes soulevCs dans leur contexte, mais en meme
compte du locuteur et de l' auditeur; l' importance accord6e a Ia notion temps recenser les outils dont disposaient les auteurs pour les resoudre,
d' «intention» (intention du locuteur, sens vis6), qui permet de porter dans le monde intellectuel qui 6tait le leur. L'on verra alors intervenir
a
sur l' enonce un jugement qui ne se fonde pas uniquement sur le constat dans la reflexion grammaticale des considerations empruntCes la
de sa correction gram_maticale; l'6laboration d'un modele int6grant Physique ou la Mhaphysique d' Aristote pour definir les notions de
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) et enonces deviants; la reconnaissance, parmi les construction ou de compl6tude, d' autres tirCes du De Anin1a ou de
enonces deviants, d'un type tout a fait particulier d'6nonces qui l' Ethique pour dCcrire les processus volontaires ou instinctifs interve-
permettent d'effectuer des actes. Le second de ces traits nous a conduite nant dans !'analyse de !'interjection, d'autres encore empruntees aux
a baptiser « intentionalistes » - malgre I' ambiguYte (cid:0) (cid:0) (cid:0) ce terme (cid:0) (cid:0) les traites d' optique pour expliquer le mode de propagation des sons, par
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) representatifs de l'approche ou du courant en question, parallele avec celui de la lumiere, etc.
qui mentaient une designation plus specifique que celle generalement Si la doctrine e!aboree par Jes Modistes se veut un modele de la
utilisee de « prC-rnodistes ». constitution des Cnonces canoniques, l' approche intentionaliste propose
Le point de depart de noire elude est done constitue par un une description de ce que l'on appelerait aujourd'hui l'activite langa-
ensemble de textes de gramrnaire. Or les lois de l'interlocution et la giCre, prenant en compte la production et l'interprCtation des enonces
prise en compte de la dimension perlocutoire du langage ont tradi- dans un contexte et une situation donnee. L'on conyoit alors qu'une
tionnellement fail partie de la tradition rhetorique, dont la !ache etait telle approche deborde largement le champ de la grammaire. Modele
prCcisCment d'envisager la production de discours dans un contexte et d'interprCtation, elle se rapprochera de l'exegese, modCle d'ajustement
a a
une situation donnee, en fonction de l'effet produire. II faudra done d'individus des rCgles et d'evaluation des productions individuelles,
tenter d'expliquer pourquoi et comment des reflexions de cette nature elle rencontrera d'autres fonctionnements nonnes, telles les conditions
ont pu Stre intCgrCes dans la grammaire universitaire du XJIIe siecle. de 1' administration des sacrements, de Ia validit6 des serments, et
On devra surtout montrer qu'il ne s'agit pas seulement de remarques meme de la prononciation des formules magiques.
gCnCrales sur le fonctionnement du langage, mais d'une analyse a
caractere technique, elaborant des notions et conceptualisations spCci- a ...
De la grammaire la magic
fiques pour rCsoudre des problemes linguistiques nouveaux. Pour ce
faire, les gramrnairiens ont dfi partir de matCriaux 16gues par la tradi- Le probleme pose au dCpart est simple: on ne peut pas toujours
tion grammaticale ancienne, qui ont ete renouvelCs et remanies, bous- utiliser un discours correct pour ex primer adCquatement ce que l' on
culCs par des questionnements en partie exterieurs a leur discipline. veut dire. Ii importe parfois de se servir d'un discours incorrect,
Les principales caractCristiques de l'approche intentionaliste incomplet ou redondant, bref d'enoncCs non canoniques, ce qui souleve
meritent d'Stre saisies selon un double mouvement. EnvisagCes selon deux questions: les variations possibles restent-elles soumises a des
un mouvement centripete, ell es s' articulent pour fonner un modele de rCgles ou sont-elles totalement a16atoires? Comment l'auditeur, qui
production et d'interprCtation des CnoncCs fonde sur les regles, un connalt les regles du discours correct, peut-il non seulement
systeme de nature proprement grammatical. Ces caractCristiques se comprendre ces sequences d6viantes, mais surtout saisir !'intention de
a a
laissent aussi etudier autrement, selon un mouvement centrifuge; signifier qui a preside leur 6nonciation? Ces questions conduisent
a
chacune touche en effet un domaine distinct, qui a pu lui donner poser deux degr6s de completude hiCrarchisCs, qui se fondent l'un sur
naissance et oll, du mains, on la voit fonctionner. Cette seconde pers- les proprietes grammaticales, 1' autre sur l' appreciation du rapport
Ia
pective explique que notre parcours nous mCnera dans des directions entre sens produit et sens vise. A partir de peut etre proposCe une
multiples, au-delft des arts du trivium. Pour expliquer !'apparition de typologie regroupant les diffCrents cas de reconstluction d'une fonne
notions nouvelles dans le champ de la grammaire, il faudra bien plus canonique a_ partir d'un Coonce deficient OU figur6 (chap. 1).
qu'une simple recherche de sources ou d'influences. II s'agira de Parmi les Cnonces non canoniques, c'est-fl-dire, selon les gram-
d6gager les reseaux conceptuels permettant de comprendre les condi- mairiens, ceux qui ne comportent pas un nom et un verbe correctement
14 La parole comme acte Introduction 15
construits, se trouvent certains 6nonc6s «communs», qui comportent et son usage, sa «proferation», entre les proprietes conferees origi-
une interjection. La question grammaticale de la construction des nellement aux noms et celles que manifeste leur utilisation? Certains
interjections se fondant sur celle pr6liminaire de leur signification, les auteurs envisagent cette difficulte a partir de ses fondements : quel est
grammairiens proposent alors, en empruntant a la psychologie, une le processus originaire par lequel un son vocal se trouve associe a un
opposition entre deux modes distincts de la signification, sur le mode contenu mental specifique, et le mecanisme quotidien par lequel ce
du concept et sur le mode de !'affect, fond6e sur une distinction entre meme contenu se retrouve a chaque enonciation? D'autres l'abordent
actions rationnelles et actions instinctives. Mais deux difficult6s se de maniere plus pragmatique: Roger Bacon developpe sa theorie de la
pr6sentent: peut-on vrairnent penser qu'il existe une parole qui ne soit renovation de la signification, selon laquelle chaque locuteur est
pas gouvern6e par la raison, qui soit purement «affective»? Et, si comme un nouvel « instituteur » du langage. On touche Ia, avec cette
c'est le cas, comment distinguer ces expressions signifiant sur le mode problematique des «transferts de sens» (translationes), a l'hermeneu-
de l'a ffect des sons vocaux emis par Jes animaux (chap. 2)? tique: Jes tropes et paraboles de l'Ecriture correspondent a des
L'on est ainsi entralne sur un terrain qui, aux yeux d'un rnodeme, modifications par rapport a !'usage commun, qu' Augustin analysait, de
semble plut6t celui de la semiologie que celui qui constitue tradition- fait, cornme un phenomene de «renovation» de signification. Mais un
nellement le domaine de la grammaire. Et c'est precisement sur ce enonce qui <lit autre chose que ce qui lui est donne de signifier en vertu
terrain que se place Roger Bacon, lorsqu'il propose, dans le De Signis, de I' institution n'est-il pas un mensonge? Ce n'est pas le cas, repond-
de placer l 'interjection cornme intermediaire entre sign es naturels et on, si cette discordance a pour origine une intention de signifier
signes conventionnels, comme le font les grammairiens. Mais le niveau Iegitime. Et nous rejoignons a nouveau la problematique initiale des
de !'analyse a change: Bacon ne se situe plus sur le plan des sons grammairiens : si l' on ne peut comprendre une sequence donnee en
vocaux (voces), mais sur celui des signes (signa). C'est en effet une fonction des regles communes, constituant l'intellection premiere ou
definition et une classification des signes que propose ce traite, dont ordinaire, il importe de faire intervenir des regles d'un autre type,
l'originalite doit etre mise en perspective. En fait !'apparition de constituant une intellection seconde. L'on peut alors remettre ensemble
rnateriaux d'inspiration augustinienne, dans une analyse sernantique les differents morceaux du De Signis de Roger Bacon, que I' on a
dominee par l'aristotelisrne, ne commence pas avec le De Signis et a des rapproches ici de !'analyse grammaticale, !ii des chapitres sur les
consequences importantes. Robert Kilwardby en important, deux sacrements, la encore de l'exegese, en tenant compte des parties
decennies plus t6t, la definition augustinienne du signe dans son com- perdues qui l' accompagnaient, et en le pensant dans le cadre originel de
rnentaire sur le Peri Hermeneias, l'utilisait immediatement pour !'Opus Majus don! il faisait partie; ce travail permet d'en apprecier
distinguer le plan du locuteur et celui de I' auditeur. II en deduisait, et plus precisement l'originalite (chap. 4).
d' autres avec lui, une distinction entre la face sensible et la face Parmi Jes enonces deviants, autres que ceux deja mentionnes, les
intelligible du langage, entre l 'expression qui s' offre aux sens et ce grammairiens remarquent que certains, grammaticalement incom-
qu'elle fait venir d !'intellect. Or cette distinction se trouve precisement plets, sont tels que le verbe manquant ne doit ni ne peut etre restitue, a
au cceur du modele d'interpretation elabore par Jes grammairiens. Le la difference d'un sous-entendu ordinaire. Ces enonces se distinguent
recentrage de Bacon sur la notion de signe, et plus generalement par le fait qu'ils n'ont pas pour fonction d' enoncer quelque chose, mais
l'intervention de ces elements de semiotique augustinienne dans le sont des instruments perrnettant au locuteur de faire quelque chose:
corpus artien, ne s'expliquent que si l'on se deplace vers le lieu naturel l'acte etant exerce, il n'a pas a etre signifie. Ils constatent egalement
oil ces elements se sont trouves etudies et developpes, a savoir la que cette valeur particuliere d' acte peut dependre soit d'une propriete
theologie des sacrements. Dans ce contexte particulier, on trouvera intrinseque de !'expression (exemple du vocatif), soil de !'usage qui en
aussi bien l'idee d'une double relation constitutive du signe, ace qu'il est fait, dans une situation donnee. Nous aurons a montrer l'importance
signifie et a ce pour qui il signifie, qu 'une classification generale des de cette notion d' actus exercitus, et son fonctionnement en grammaire
signes (chap. 3). et en logique. Mais elle nous ramenera une fois de plus a la theologie:
Le probleme de I' interpretation des enonces deviants souleve une cette notion fait echo de maniere tres precise a la definition des sacre-
question tres generale: quel rapport y a-t-il entre !'institution d'un mot ments, qui ont pour particularite d' «effectuer ce qu'ils signifient». De
16 La parole comme acte
Introduction 17
maniere plus specifique, !'analyse de la forrnule de l'eucharistie fern
Nornrne par le Pape Cardinal et eveque de Porto en 1278, ii fut ensuite
a
appel ces deux valeurs, (( significative » et «operative» du langage a a
(chap. 5). rappele Rome, et mourut Viterbe le 10 septembre 12793.
Sa cetebre classification des sciences, le De Ortu Scientiarum,
L'id6e du langage comme acte ne se limite pas aux developpements
composee vers 1250, marque le point de rupture entre les deux
techniques e!abores dans Jes disciplines logique OU grarnmaticale. Elle periodes de la vie de Robert Kilwardby. Les Anna/es de Nicolas Trivet
trouve sa place, chez Bacon, dans·une·conception g6n6rale qui conc;oit
indiquent bi en qu' avant son entree dans I' ordre dominicain, il fut
le langage comme un processus genere physiquement, d6termin6 par
«regent en Arts», et particulierement competent en Grammaire et en
un ensemble de conditions cosmologiques, psychologiques, corpo- a
Logique, alors qu'il se consacra, ensuite, la lecture des saintes
a
relles. Bacon en d6rnontre ainsi la redoutable efficacit6, en s' attachant
Ecritures et des Peres. De cette seconde periode <latent des questions
distinguer son usage mal6fique, qui releve de Ia rnagie, d'un usage
sur Jes quatre livres des Sentences de Pierre Lombard (ca. 1260),
b6n6fique que l 'Eglise pourrait mettre a profit contre ses ennemis. La a a
correspondant son enseignement de theologie Oxford, ainsi que des
a
question du «pouvoir des mots», qu'il aborde diverses reprises, et
sermons et d'un traite sur !'incarnation. II mis au point d'importants
notamment dans une section voisine du De Signis, a des enjeux impor-
instruments de travail, tables alphabetiques, tables des matieres et
a a
tants, puisqu'elle touche la magie et l'astrologie, au deterrninisme
concordances des reuvres pour plusieurs auteurs, et notamment
en general. La place que Bacon lui accorde nous permettra de saisir la
Augustin. 11 ecrivit en outre un petit traite sur la relation et deux
coherence profonde d'une perspective d'ensemble, qui considere la
ouvrages de nature philosophico-theologique, le De Tempore et le De
parole cornme un acte, produit intentionnellement, situe dans le temps
Spiritu .fantastico, oil il essaye de concilier Augustin et Aristote (ca.
et dans l'espace (chap. 6).
1252-61). On mentionnera egalement la reponse aux «Quarante trois
questions» que lui adressa Jean de Verceuil, ainsi qu' a Albert le Grand
a
Deux anglais Paris et Thomas d'Aquin, et qui temoignent de sa place dans l'Ordre
Dorninicain.
II nous reste, dans cette introduction, a presenter les protagonistes
Mais ce sont les ecrits de la premiere periode qui nous occuperont
principaux de noire etude, Robert Kilwardby et Roger Bacon, et it dire
dans la presente 6tude. L'ensemble constitue par ceux-ci constitue le
un mot de taus les « autres », sans-identite, les anonymes.
temoignage le plus ancien et le plus complet de I' enseignement des Arts
Robert Kilwardby reste dans les annales comme un personnage a
Paris, realise par un meme rnaitre 4• Ses cornmentaires portent, pour
important et renornme tant «pour la saintete de sa vie» que pour son
la grammaire, sur Jes livres XVII-XVIII Institutiones Grammaticae de
savoir dans les disciplines profanes et sacrees. Sa carriere suit un
Priscien, I 'Ars maior /II de Donat, et le De Accentu du Pseudo-
Chemin assez traditionnel, et Conforme i} Ce qui peut etre jug6, selon les Priscien, et en logique, sur 1' ensemble de l' Organon aristotelicien et
criteres de l'epoque, un parcours reussi. Nevers 1215 en Angleterre,
traites qui s'y etaient agreges (lsagoge de Porphyre, Liber sex
a
Kilwardby etudia Jes Arts Paris, OU ii devint ma1tre vers 1237, y
Principiorum, Liber de divisione de Boece)5• 11 est !'auteur du pre-
enseignant juqu'en 1245. II joignit peu apres l'ordre Dominicain,
mier comrnentaire latin sur les trois premiers livres de l' Ethique ii
probablement en Angleterre, etudia puis enseigna la theologie it
Nicomaque d'Aristote. Un catalogue de ses ceuvres, realise en 1325,
Oxford, probablement de 1256 it 1261. Elu provincial des dorninicains a
mentionne des sophismes en logique et en grammaire, mais il reste
anglais en 1261 - ce qui constitue la premiere date certaine de sa
demontrer s' il est bien I' auteur des deux collections de sophismes, en
biographie, ii devint archeveque de Canterbury en 1272, poste le plus
cours d'6dition, qui peuvent y correspondre6• Le catalogue indique
eleve dans la hierarchie ecclesiastique du pays. Kilwardby promulga,
le 18 mars 1277, quelques jours apres Jes condarnnations parisiennes
3. Voir Judy 1976, p. xi-xvii; une bio-bibliographie tres complete est donnee
d'Etienne Templer, une liste de treize propositions en grarnmaire, par Lewry (1992).
logique et philosophie naturelle qui ne devaient pas etre enseignees 2• 4. Voir Lewry 1987, p. xiii, Lewry (1992, p. 258.
5. Voir Lewry 1978 et 198la.
6. Voir Grabmann 1940, p. 41-50; pour lcs sophismes !ogiques, contenu
dans un seul manuscrit, voir Braakhuis 1985; pour Jes sophismes grammaticaux,
2. Voir Lewry 1981b.
voir infra, bibliographic et n. 6.
18
La parole comme acte Introduction 19
6galernent des commentaires sur les libri naturales (Physique, Mita- rer;ues alors qu'ils devraient fonder leurs affirmations sur l'expirience
ete
physique, De anima, etc.); ces demiers n'ont pas retrouves, bien qui seule peut confirmer la raison.
que la connaissance de ces textes soit manifeste dans celles precedem- La biographie de Roger Bacon est marquee d'incertitudes. Les
ment mentionn6es ainsi que dans le De Ortu Scientiarum. conjectures sur sa date de naissance ant pour origine une indication
. Robert Kilwardby a sans aucun doute ete l'un des maitres Jes plus donnee dans son Opus tertium en 1267, selon laquelle il a beaucoup
influents de la fin de la premiere moitie du XIIre siecle, pour ce qui travaille dans le domaine des sciences et du langage et a consacre ac ette
concerne le trivium. Plusieurs de ses opinions, en grammaire comme etude plus de quarante ans depuis qu'il a appris !'alphabet. Si Bacon se
en logique restent celebres, jusqu'a la fin du siecle et meme au-defa. refere ici a l'enseignernent e1ementaire, qui se terminait vers sept ans,
Son commentaire sur Priscien Mineur est toujours cite. Roger Bacon cela indique qu'il a pu naitre vers 1220 10• Bacon etudia a Oxford, puis
lui-meme en reprend de longs extraits, dans sa Summa grammatica, ce devint rnaitre des Arts a Paris oil il enseigna une dizaine d'annees (ca.
qui indique peut-etre qu'il a ete son eleve a Paris'. Albert le Grand 1237-47). C'est de cette epoque que <latent ses premiers travaux de
emprunte de nombreux d6veloppernents a ses commentaires de grammaire (Summa grammatica) et de logique (Summa de sophisma-
logique, contribuant ainsi a la diffusion de ses idees en Allemagne. tibus et distinctionibus et Summulae dialectices 11 Il fut le premier a
).
Notre recherche se foncle sur les ecrits authentiques de Robert Kil- commenter a Paris les ceuvres d' Aristote, proscrites a la suite de
wardby, sur ceux qui lui ont ete attribues sans certitude absolue (c'est plusieurs condamnations, et laissa d'importants ensembles de questions
le cas des commentaires sur Donat, le De accentu, et des sophismes, sur celles-ci (sur la Metaphysique et la Physique, Jes libri naturales,
rnentionnes ci-dessus), et sur d'autres ecrits qui, dans les manuscrits, auxquels s'ajoute le Livre des causes). Si une partie de ses responsabi-
gravitent autour des premiers, tels le commentaire sur Priscien Majeur lit€s universitaires semble se terminer vers 1247, ii n'y a aucune
dit du «Pseudo-Kilwardby », inauthentique, les Quaestiones de (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) preuve formelle qu'il soir retourne a Oxford entre 1247 et 1250, et sa
iectione, accompagnant le commentaire sur Priscien mineur dans trois presence est attestee a Paris dans les annees 1250-56 .. Bacon y
manuscrits, ou d'autres collections de sophismes 8• poursuivit ses travaux de recherches, a l'Ccart du monde un1vers1taire,
La longue vie de Roger Bacon revele un parcours fort different: il pendant une vingtaine d'annees, cette pCriode etant marquee par son
ne passa pas de la Faculte des Arts a celle de Theologie, et ne rei;ut entree dans l'ordre franciscain en 1256. II pensait que ces travaux
jamais les responsabilites ecclesiastiques ou administratives qui devaient servir l'Eglise, I' aider a vaincre Jes perils dont ii la croyait
couronent une carriere accomplie, vouant toute sa vie a l' etude et la menacee, et y consacra une part importante de ses ressources person-
recherche, en rnarge des institutions savantes, dans les domaines les nelles. Et cependant, il subit, selon ses propres dires, des brimades
plus varies. Son esprit curieux et inventif a tant6t ete exhalte, dans repetees a l'interieur de son ordre, visant a l'empecher de poursu1vre
l'historiographie, cornme reprCsentatif des courants « scientifiques » ses recherches. La raison en est encore aujourd'hui discutee: est-ce
(sc. antiscolastiques) du XIJJe siecle, tant6t au contraire comrne pour son int6ret pour l'alchimie, la magie OU l'astronomie, qui font 8. la
a
anachronique dans son siecle, annonciateur de temps venir mains meme epoque l'objet de plusieurs condarnnations? Pour des sympa-
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) Comme le note bien Gilson 9, c'est en fait un personnage thies envers certains courants de l' ordre franciscain, comme celui de
« Inclassable », qui maintient 8. la fois que toute sagesse est r6vClee, Joachim de Fiore? Pour son caractere indCpendant et son refus de se
presente dans l' Ecriture sainte, et que celle-ci n' a pas encore atteint son plier aux regles de contr6le de toute production ecrite, institu6es par
terrne et doit Stre d€veloppee. 11 peut ainsi proclamer un necessaire Bonaventure, maitre general de l'Ordre? II est s-0.r en taus cas que ses
a
retour Ia lecture des textes, une fois Ccartees Ies erreurs de attaques virulentes contre les th€ologiens de son temps, de taus ordres
traductions et cormnentaires qui trop souvent en d€forment le contenu; d'ailleurs, ne pouvaient que susciter l'hostilite. Dans Jes annees 1260.-
mais en meme temps batailler contre ses conternporains qui citent 64, Bacon noue a Paris des relations avec Guy de Foulques ; celm-c1,
aveuglement les auteurs, s'irnitent les uns les autres, repetent Ies idCes
a
10. La date de 1214 a 6te egalement avancee partir de l'interpretation, qui
7. Voir Lewry 1992, p. 260, nous semble moins probable, selon laquelle cette reference a I' alphabet (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
8, Tous ces textes sont decrits de maniCre plus prCcise dans la bibliographic. drait a J'entree a l'universite, vers 13-14 ans.
9. Gilson t955, p. 308-312 et 675. 11. Pour une datation relative de ces ouvrages, voir infra chap. 5, n. 66.
20 La parole comme acte Introduction 21
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)Pape en 1265 sous le nom de Clement IV, Jui ordonne alors, en autres ecrits, cornmentaires, questions, sophismes, reuvres sans indica-
JUIIl 1266, de Im envoyer ses travaux philosophiques ainsi que son tion de date ou auteur. On mentionnera simplement un traite important
programme pour la renovation du savoir et la reforme de la et volurnineux, que 1' on a pris l'habitude de designer par son incipit:
Chretiente. C' est de cette demande que resultent la redaction ou le «Sicut dicit Remigius», et dont l'auteur semble s'appeler Johannes.
rassemblement (cid:0) (cid:0) (cid:0) plusieurs ecrits dans les annees 1267-70, ecrits qui Celui-ci fait preuve d'une grande erudition, citant, en plus des autorites
form_eront la n;attere de (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) Opus Maius, Opus Minus, et Opus grammaticales communes, des textes logiques et philosophiques aristo-
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) - presentations d un immense Scriptum generate jamais teliciens, mais aussi des auteurs de l' Antiquite, de I' Antiquit6 tardive et
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) De ces (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) <latent aussi d'autres ceuvres scientifiques, sur du Haut Mayen Age. L'utilisation des articles definis fran9ais, non
I optique, la physique, la medecine, ainsi qu'une grail1maire grecque et seulement le nominatif li, commun dans le latin philosophique, mais
a
des fragments d'une grammaire hebraique. La periode suivante est ma! aussi ses formes declinees (del, delle, alle) est remarquer, ainsi que
co!111;ie. mais I' on sait que Bacon fut a nouveau condamne par le maitre certaines references a la ville de Paris. L'on rencontrera aussi des
General de son Ordre, Jerome d' Ascoli, «pour certaines nouveautes «pseudo-», ainsi que l'on no1nme habituellement certains auteurs,
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)», et de Ce fait emprisonne. n resta a Paris jusqu'en 1278, pour la proximite que leurs reuvres entretiennent avec celles d'auteurs
pms ret?uma a Oxford. Il y redigea, en 1292, son dernier ouvrage, identifies, ou pour des attributions abusives post6rieures, Pseudo-
macheve, le Compendium Studii Theologiae 12. Kilwardby, Pseudo-Grosseteste, Pseudo-Johannes le Rus ...
.(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) mouvementee de cette vie, le fait qu'apres une carriere Comment est-il possible de se retrouver dans la masse de la pro-
ordmaire a la Faculte des Arts son activite scientifique se deroula a duction manuscrite artienne, en grande partie anonyme et inedite, et
a
I' 6cart du monde universitaire, de maniere plus ou mains secrete dans parvenir y reperer un courant de pensee? Ce soot bieo sfir Ies
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) plus que controverses, l'idee que la science devait etre considerations doctrinales qui nous ont d'abord guidee. Mais pas
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) au service de l'Eglise et l'ideal de renovation du savoir, procla- uniquement. Nous avons deja note que le fait de trouver certains textes,
a
mes dans (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) les ceuvres de la seconde periode, tous ces elements dans Jes manuscrits, cote d'ceuvres de Kilwardby constituait un
sont essentiels pour apprecier la teneur des positions de Bacon en element d'identification. Le mode d'argumentation «Scolastique» est
matiere d' analyse du langage, leur caractere eclectique et Ieur par ailleurs precieux pour l'historien. La forme «disputee» de la
originalite. plupart des textes fait appara1tre des batteries d'arguments, qui sont
Robert Kilwardby et Roger Bacon sont deux figures d'intellectuels repris, reelabores, et sans cesse augmentes, ce qui perrnet de deter-
fort diff6rents, (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)n'ont en commun que d'avoir enseigne a Ia Faculte miner I' existence d'un milieu de reflexion. Un maitre oe peut avancer
a
des Arts de Pans dans Jes annees 1240, probablement comme membres sa solution sans se situer par rapport ses predCcesseurs ou ses contem-
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) natio? anglaise. Ce sont principalernent pour Jes 6crits de cette porains. Les opinions marquantes soot toujours citees, meme pour etre
a
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) artienne, notamment en grammaire, qu'ils se rejoignent. Mais depassees. Ainsi Raoul le Breton, la fin du XIll' siecle, mentionne+il
(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0) ne soot pas les deux seuls auteurs a s' interesser aux deux themes systematiquement les positions de Pierre Helie et de Robert Kilwardby,
1mportants que sont, d'un cote, !'elaboration d'un modele de comple- qui sont manifestemeot les deux commentateurs les plus marquants des
tude dynaIIllque fa1sant 1nterven1r locuteur et auditeur oU la notion Institutiones, pour le XI!' et le XIII' siecle respectivement. Et ii
d'intention de signifier joue un r6le central, de l'autre Ia distinction 6tonnant de constater que la prise en compte de ces opinions de quidam
entre _r affectif et le rationnel, qui permet de (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) une double permet d'organiser les textes anonymes, d'en proposer, dans le
opposlt1on, entre !'interjection et les autres parties du discours d'une meilleur des cas, une chronologie relative. Enfin, l'Uoiversite a exerce
part, en:re les (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) servant a « exercer » des actes et ceux qui uoe pression institutionnelle par l'intermediaire des programmes
serve.nt a les « s1gn1f1er » de I' autre. Des d6veloppements sernblables imposes aux 6tudiants, laquelle s' est traduite par une concentration et
a
ou rmeux argumentes sur ces themes se rencontrent dans de nornbreux une homogeneisatioo des genres litteraires. Cette donn6e facilite
nouveau le parcours dans la foule des manuscrits inedits. De meme que
. , 12. Voir Lindberg 1983, (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) Maloney 1988, p. 2-13, et la bibliographic celui qui s'int6resse aux noms divins ou a la definition du sacremeot
c1lee p. 2 n. 2-3 ; Hackett (sous presse 2); la bio-bibliographie la plus recente est comme sigoe peut se reporter aux commentaires sur les Sentences de
celle de Hackett 1992a.
22
la parole comme acte
Pierre Lombard, aux chapitres concernes (I, 22 et IV, !), de meme Jes
questions grammaticales pertinentes pour notre etude sont reperables
dans des lieux textuels bien definis. C'est ainsi que !'on retrouvera des
discussions sur les figures dans les commentaires sur tel ou tel passage
des textes faisant autorite, des developpements sur les « actes exerc6s »
dans tel ou tel sophisme grammatical, etc.
Les representants de ce que nous avons appele !' approche grarnma-
ticale « intentionaliste » soot done, sauf exception, non pas de «grands Chapitre I
auteurs » mais des maitres inconnus qui, tout en ayant laisse des reuvres
a Completude et acceptabilite
anonymes ( ce qui est sou vent le sort des « artiens », la difference des
th6ologiens), m6ritent de retenir un moment notre attention.
a
Nous avons voulu, propos des differentes questions que nous
avons brievement pr6sent6es plus haut, realiser un travail qui soit une Les arts du Iangage ou trivium se partagent, au M?yen (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
synthf:se tout en offrant des mat6riaux nouveaux et in6dits. Le resultat l(cid:0) (cid:0) (cid:0)se du langage: la grammaire s'occupe de la correction des en(cid:0)o(cid:0)n(cid:0)c(cid:0)e(cid:0)s(cid:0), (cid:0)
en est une sorte de livre a « deux vitesses ». II nous fallait, pour le logique de Jeur verite, la rhetorique de leur elegance. Le
sp6cialiste, donner en note des precisions sur les sources, les paralleles, au XIIIe siecle est sans conteste la rhetorique, du mo1ns a
pauvre, ' . d I I · e ar
etc., details dont le non-specialiste se serait bien passe, et, de fait, il !'Universite. Les prerogatives de la grammarre et, e _a ?g1qu , ,?
peut se dispenser de s 'y reporter. II etait d' autre part necessaire, pour contre sont clairement hi6rarchisees : un enonce dott d abord etre
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
le non-sp6cialiste, de rappeler et d'expliciter certaines notions ou correct et acheve avant d'Stre susceptible d'un jugement de
doctrines, deja bien exposees dans la litterature recente, et de chercher
verite. . ( · ) t de
a les int6grer, par Ia-meme, dans le travail en cours. Que recouvrent les notions de correction congruztas .e.
Enfin, nous avons voulu faire Ia part belle aux textes originaux sur completude (pelfectio)? Elles dependent d'un ensemble de cond1t10ns
lesquels se fonde nos d6veloppements, textes tres souvent in6dits, et de nature variee. D' abord de conditions formelles, adm1ses tant par
jarnais traduits. IIs accompagnent !'expose selon trois modes distincts. Aristote que par Priscien, et qui constituent le (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) _de toute
Certains, sous forme de citation, y sont inseres, et sont toujours analyse: un enonce doit comporter un nom, (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) du (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)un
traduits. L'original latin a ete dans la mesure du possible place en note, verbe expression du pr6dicat. Puis des cond1t1ons (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) un
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
et surtout Iorsqu'il n·'existe que manuscrit. D'autres, en latin, figurent enonde doit produire du sens. Or c'est sur ce plan Jes
seulement en note, sans traduction : tires de traites in6dits, ils ont pour epoques voient se ctevelopper des modeles de descnpt10n fort d1ffe-
ri\le de confirrner !'expose, de montrer la proximite des formulations rents selon que les grammairiens prennent pour obJet les (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
d'un traite a l'autre, de contribuer ainsi ii justifier que nous parlions, cons;ructions canoniques ou 6largissent leur champ aux constructions
pour !es grarnmairiens, d'un veritable courant de pensee. Enfin, un « deviantes » et cependant admises et attestees.
choix de neuf textes plus longs, que nous traduisons et accompagnons Certains points forts des analyses anciennes v?n.t marquer (cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)11 es
d'une introduction et d'un commentaire, constituent Ia seconde partie d es au te urs d u XIII' siecle , qu'il importe de ment1onner "!br esf fb ne'v eI -
du present volume. L 'original latin, pour Ies textes in6dits, paraitra ment Le premier est emprunte a Donat: par une phrase s1 y ine a a
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
dans des publications independantes. II s' agit ici le plus sou vent d'unites fin chapitre sur le solecisme de son Ars Maior, il dit «le
textuelles originales et non plus d'extraits: une question, un sophisme, sol6cisme dans la prose est appele (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) le (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)» t. (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)(cid:0) (cid:0) (cid:0)la
un chapitre. Ces traductions forment le complement de !'expose de constitution de 1'6nonce, le fait qu'il appart1enne (cid:0) (cid:0)un re?1stre ou a un
notre premiere partie. Elles illustrent !es differents themes que nous y autre modifie done le jugement qui peut etre porte sur lu1, et done son
abordons, et permettent de suivre l' argumentation, non pas telle que accep t a b1"l 1"te' . Une autre indication, concerna.n t les (cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)t(cid:0)ro(cid:0)(cid:0)pde' s, seenrsa
nous la reconstruisons, mais telle que la d6veloppaient nos auteurs, egalement retenue: «le trope est un mot qui se vo1t trans ere un s
dans le style propre de I' argumentation dialectique medievale.
l. Ars Maior m, ed. Holtz, p. 358: 3 (GLK IV, p. 393: 10-14).