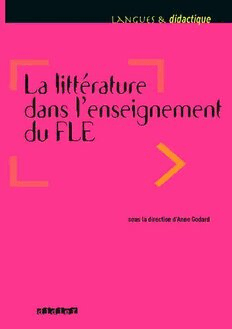Table Of Content2
Ce livre collectif n’aurait pu se faire sans le soutien et la participation de nombreuses
personnes. Nous souhaitons tout d’abord remercier Jean-Louis Chiss, Véronique Castellotti
et Jean-Claude Beacco pour leur patience et leurs conseils. Nous remercions aussi
Emmanuel Fraisse pour sa confiance, ainsi que Francine Cicurel et Corinne Weber pour
leurs encouragements.
Enfin, nous devons beaucoup à ceux – qu’ils soient experts, acteurs institutionnels,
enseignants ou praticiens de la littérature en FLE – qui ont accepté de partager leur savoir
et leurs expériences de terrain, en France et à l’étranger : spécialement Fabienne Jacob et
Jean Portante qui nous ont ouvert leurs ateliers d’écriture, ainsi que Laurent Attal
(Bulgarie), Marie-Laure Basuyaux (lycée Montaigne, Paris), Gérard Enjolras (Tchéquie),
Sophia Giero (Allemagne), Sol Inglada (CIEP), Mickaël Lardenois (Espagne), Bruno
Laurent (Italie), Gayle Levy (États-Unis), Florent Masse (États-Unis), Emilia Munteanu
(Roumanie), Marjorie Nadal (Allemagne), Michel Plat (Laos), Anne-Garance Primel
(Fondation AF), Sylvain Tanquerel (EHESS, Paris) et Frédérique Willaume (IF, Paris).
Nous les remercions tous chaleureusement pour leurs éclairages et leur disponibilité.
Graphisme intérieur et couverture : A.-M. Roederer
Mise en pages : Text’oh! (Dole)
© Les Éditions Didier, Paris 2015
ISBN : 978-2-278-07616-1
Dépôt légal : 7613 / 01
3
INTRODUCTION
par Anne Godard
Alors que la didactique de la littérature en français langue maternelle a connu de
grandes évolutions depuis une dizaine d’années (Daunay, 2007), les travaux en didactique
du français langue étrangère, depuis la parution en 2001 du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL), ont réservé une place réduite à la littérature, et peu
(1)
d’ouvrages d’ampleur ont été consacrés à son enseignement . Pourtant, au-delà des
descriptions des niveaux de compétences, les lignes de force du CECRL ont renouvelé la
réflexion didactique. En effet, l’importance accordée aux dimensions pragmatiques de la
communication mettant en jeu non seulement des savoirs linguistiques, mais des savoir-
faire et des savoir-être socioculturels ; l’adoption d’une perspective actionnelle permettant
d’organiser les apprentissages autour de projets nécessitant l’accomplissement de tâches ;
ainsi que la promotion d’approches plurielles en faveur de l’éducation interculturelle et du
plurilinguisme peuvent contribuer à transformer les pratiques d’enseignement de la
littérature en français langue étrangère. Dans le même temps, plusieurs transformations
ont affecté la littérature comme objet et comme discipline. D’une part, de plus en plus la
littérature s’appréhende dans un continuum de pratiques culturelles. D’autre part, la
reconnaissance des littératures francophones a modifié la notion même de canon
littéraire qui avait jusque-là valeur patrimoniale et nationale, changeant aussi, dans le
même mouvement, la représentation des relations entre langue et littérature françaises.
Dans ce contexte, la valeur formative attribuée à la littérature dans le cadre scolaire met
désormais l’accent sur le caractère pluriel des compétences qui se développent au contact
des textes littéraires : si elle n’est plus le modèle dominant dans la formation individuelle,
scolaire et collective, la littérature reste ainsi un enjeu fort des politiques éducatives
françaises et européennes, à l’articulation du linguistique et du culturel, orienté vers
l’expérience de l’altérité.
Qu’en est-il, cependant, dans l’enseignement du FLE ? La littérature est-elle réservée à
certains publics ? À certains niveaux ? Peut-elle être pensée d’emblée dans une
progression linguistique ou sa spécificité en classe se situe-t-elle dans un à-côté récréatif ?
Comment peut-elle être didactisée tout en ménageant le plaisir comme moyen
d’apprentissage ? Comment permet-elle un enrichissement linguistique et culturel et
conduit-elle à une modification du regard sur la langue et la culture ?
Avant de répondre à ces questions, et pour préciser le rôle spécifique et irremplaçable
que la littérature peut jouer dans l’enseignement du français langue étrangère, nous
souhaitons indiquer d’emblée qu’à l’encontre d’une tendance à vouloir défendre une
didactique de la littérature pour elle-même, nous considérons légitime – spécialement en
langue/culture étrangère – d’utiliser la littérature pour « autre chose » qu’elle : à travers
elle, en effet, la matière de la langue autant que des formes de la culture sont données à
sentir, à goûter et à comprendre, ce qui est, dès les premiers niveaux, non seulement
motivant, mais formateur. Qu’elle soit « prétexte » à parler et à écrire n’est pas contraire
au rôle qu’elle joue dans les pratiques authentiques, et qu’elle permette ainsi de progresser
à la fois dans la maîtrise de la langue et dans la connaissance de la culture, de soi et
4
d’autrui tient justement au fait qu’elle transmet autre chose qu’elle-même. En effet, les
mots renvoient à une expérience, qui peut susciter l’émotion, l’imagination ou la
réflexion : ce sont toutes ces dimensions qui donnent sens à l’apprentissage. Pour ces
raisons mêmes, il importe de ne réduire le texte littéraire ni à servir d’exemplier pour une
fiche de grammaire ni à constituer une simple source d’information culturelle comme
n’importe quel document fonctionnel : la musique de la langue, l’imaginaire que déploie
une fiction, la sensibilité d’une personnalité que l’on perçoit et devine à travers le texte
engagent également le lecteur, de manière existentielle. Encore faut-il, dans
l’enseignement, parvenir à préserver ces résonances.
L’ouvrage est conçu de manière à donner des clés de compréhension de ce que
représente la littérature en FLE – historiquement, théoriquement et pratiquement, dans
les institutions à l’étranger et dans le matériel pédagogique – ainsi que des pistes de
réflexion et des propositions circonstanciées qui répondent aux enjeux linguistiques,
communicatifs et éducatifs des enseignements de français langue étrangère.
Les chapitres 1 et 2, rédigés par Anne Godard, présentent un cadrage général sur la
place de la littérature dans la didactique du français et des langues en cherchant à cerner
l’objet « littérature » dans le discours didactique et ses différents enjeux formatifs et
éducatifs.
Le parti pris historique du chapitre 1 permet de mettre en évidence les nombreuses
continuités entre les enseignements de langue maternelle et étrangère, y compris dans les
moments de contestation de la place du littéraire dans la formation linguistique. Les
spécificités de la réflexion didactique des trente dernières années dans le domaine du
FLE font apparaître trois grands axes de renouvellement de l’abord de la littérature en
classe de langue autour des compétences de lecture, de la créativité langagière et de
l’éducation interculturelle.
En relation avec ces trois domaines pour lesquels le rôle de la littérature a été réévalué
en FLE, le chapitre 2 analyse au présent les enjeux de la formation littéraire dans
l’enseignement scolaire français et européen à travers les positions institutionnelles sur les
différentes finalités assignées à la littérature et sur l’ouverture des corpus étudiés. La
dimension interprétative de la relation aux textes littéraires constitue une caractéristique
cardinale de la compétence littéraire et apparaît comme un enjeu important pour le FLE
dans la mesure où elle permet de dépasser l’opposition entre communicatif et culturel.
Ainsi, la construction d’une attitude interprétative, bien présente dans la formation
scolaire en France, mériterait d’être développée également en FLE, à travers l’adaptation
des outils spécifiques qui existent et sont utilisés dans les formations de langue
maternelle.
Par contraste avec ce cadrage général, qui met en évidence les constantes historiques et
les enjeux actuels de la formation littéraire en FLE, les chapitres 3 et 4 s’attachent à
analyser la réalité d’une part des situations d’enseignement et de diffusion du français à
5
l’étranger, d’autre part des ressources pédagogiques que constituent, notamment, les
méthodes de langue et les manuels de littérature conçus pour le FLE.
Le chapitre 3, rédigé par Anne-Marie Havard, avec une contribution de
Mathieu Weeger, propose ainsi un panorama des pratiques institutionnelles à l’étranger
dans les trois « lieux » de diffusion du français où la littérature joue un rôle notable : le
réseau culturel français à l’étranger (instituts français et alliances françaises), les
départements universitaires et les filières bilingues du secondaire. Statut du littéraire dans
la culture, démarches innovantes et dispositifs d’encouragement aux pratiques littéraires y
sont décrits et analysés. Dans un contexte qui est plutôt celui d’un reflux du français
comme de la culture littéraire, le parti pris a été de mettre en valeur les points positifs et
les initiatives contribuant à rapprocher la littérature de ses lecteurs en langue étrangère.
Ensuite, le chapitre 4, rédigé par Donatienne Woerly, repère et évalue les principes qui
orientent l’approche didactique de la littérature dans l’enseignement du FLE,
principalement dans les discours institutionnels et le matériel pédagogique paru depuis le
CECRL. Ses analyses permettent de mettre au jour les conceptions du littéraire qui
dominent et les pratiques d’accompagnement que les textes suscitent. Elles mettent en
évidence la difficulté d’intégrer, dans les manuels, une véritable progression autour de la
littérature qui assure une transition entre les enseignements langagiers et les enjeux
interprétatifs, culturels et interculturels de la littérature.
Le panorama dressé aux chapitres 1 à 4 met en évidence les éléments suivants :
parallélismes entre les didactiques du FLE et du FLM ; spécificités didactiques des
enseignements langagiers et de l’éducation interculturelle ; enjeux de la dimension
interprétative de la formation littéraire ; hétérogénéité des pratiques et des corpus dans
les différents lieux de diffusion du français à l’étranger ; tendances et limites du matériel
pédagogique et des conceptions qui sous-tendent leur présentation des textes. Tous ces
éléments permettent de dégager les lignes de force d’un renouvellement des pratiques
d’enseignement de la littérature en FLE : intégrer une perspective interprétative aux
objectifs communicatifs ; créer des synergies avec les initiatives de médiation culturelle ;
mettre en place une progression donnant une large place aux dimensions sensorielles et à
la matérialité de la langue.
Tenant compte de ces lignes directrices, les approches retenues dans les chapitres
finaux approfondissent trois dimensions dans lesquelles la littérature peut transformer le
rapport à la langue en situation d’enseignement apprentissage : écriture créative et
personnelle pour une appropriation progressive des codes dans le chapitre 5 ;
interprétation comme mise en acte à travers la pédagogie de projet dans le chapitre 6 ;
décentrement et développement d’une attitude réflexive sur l’expérience plurilingue dans
le chapitre 7. Plutôt qu’une série de fiches sommaires et déconnectées de tout contexte,
nous avons tenu à associer dans ces chapitres réflexions et propositions pédagogiques en
nous appuyant sur un corpus diversifié d’œuvres et de genres littéraires. Les démarches
proposées peuvent être adaptées à différents publics, tandis que des exemples
6
contextualisés permettent aux enseignants et futurs enseignants de mieux percevoir les
différents paramètres qui orientent les choix pédagogiques.
Ainsi, le chapitre 5, rédigé par Auréliane Baptiste, avec des contributions de
Donatienne Woerly et Olivier Lumbroso, se focalise sur l’articulation entre langue et
littérature à partir de l’analyse comparée de situations d’écriture créative en FLM et en
FLE, puis de deux ateliers d’écriture en FLE animés par des écrivains. Sont ensuite
présentés les principes d’une progression dans l’enseignement de la langue qui s’appuie
sur la richesse linguistique et discursive qu’offre la littérature. En effet, il nous a semblé
qu’il était d’abord nécessaire de reprendre à neuf la question de ce qu’apporte la littérature
dans les enseignements langagiers auxquels elle a été traditionnellement liée. Cela nous
semble d’autant plus pertinent que les acquisitions en langue sont aujourd’hui des
priorités y compris au niveau universitaire dans nombre de départements de français à
l’étranger, confrontés à la baisse de niveau de leurs étudiants. L’atelier d’écriture permet
justement de conjoindre le travail linguistique avec la nécessité de promouvoir un autre
rapport à la langue – qui laisse place à la créativité et à la subjectivité, y compris lorsque
les acquis linguistiques sont encore fragiles.
Dans le même esprit, nous avons voulu consacrer un chapitre entier à ce que peut
apporter la perspective actionnelle qui permet, avec la pédagogie de projet, de
décloisonner les apprentissages et de mettre l’accent sur une relation active à la langue
comme à la culture étrangère. Le chapitre 6, rédigé par Ève-Marie Rollinat-Levasseur,
avec une contribution de Véronique Kuhn, présente ainsi le parti que l’on peut tirer de la
multimodalité, qui fait entrer dans la littérature à travers le cinéma et les arts, mais aussi
comment, en considérant l’interprétation comme une performance, on peut développer
des compétences communicatives à travers un travail vocal, dramatique et théâtral en
classe de langue. Les bénéfices langagiers, culturels et personnels d’une approche « en
acte » des textes littéraires sont notamment d’associer étroitement les dimensions
corporelles à l’acquisition linguistique et culturelle.
Les chapitres 5 et 6 invitent ainsi à un rapport différent à la langue à travers la
littérature. C’est aussi le pari du dernier chapitre, rédigé par Anne Godard avec une
contribution de Myriam Suchet, qui propose, dans une démarche réflexive et
interprétative propre à l’éducation interculturelle, de donner aux enseignants eux-mêmes
une occasion de faire l’expérience de « l’étrangéité » de la langue française. C’est d’abord
la littérature québécoise qui est envisagée, pour sa mise en jeu exemplaire de
l’hétérogénéité linguistique et de ses dimensions identitaires et politiques. Ce sont ensuite
des textes autobiographiques ou introspectifs d’écrivains francophones plurilingues qui
sont analysés, pour l’entrée qu’ils permettent dans « la fabrique de la langue » (Gauvin,
2004) et dans l’apprentissage du français. L’enjeu, au-delà de leur faire connaître une
partie du corpus francophone qui peut renouveler leur représentation de ce qu’est la
littérature en français aujourd’hui, est, à travers l’expérience d’un décentrement, d’initier
les enseignants et professionnels du FLE aux problématiques plurilingues, essentielles
dans ce domaine, et de les sensibiliser à la nécessité d’introduire une dimension
interprétative dans leur approche des textes.
7
À travers ce large éventail d’analyses, de propositions pédagogiques et d’exemples
situés et contextualisés, notre objectif est de donner aux enseignants, futurs enseignants,
formateurs, acteurs de la coopération linguistique et culturelle ou auteurs de manuels, la
matière et les outils de réflexion et de conception pour faire de la littérature le levier
d’une approche renouvelée de la langue, afin de développer des compétences à la fois
communicatives et interprétatives en associant l’apprentissage langagier avec la sensibilité,
l’imaginaire et la pensée.
Note
(1) On peut signaler, en 2014, la très brève synthèse de Defays et al. publiée par
Hachette FLE.
8
C
HAPITRE 1
La littérature dans la didactique du français et des langues : histoire et théories
par Anne Godard
Le rôle dévolu à la littérature dans les enseignements de langue – maternelle et
étrangère – a connu des évolutions très contrastées au cours du temps. Le propos de ce
chapitre est d’en retracer les grandes lignes, en adoptant une double perspective,
historique et théorique, qui nous semble la plus à même d’en saisir les ressorts et les
enjeux. Tout en ayant comme objet privilégié le français langue étrangère, nous adoptons
ici délibérément une perspective plus large : les débats sur les méthodologies
e
d’enseignement des langues, de la fin du XIX siècle jusqu’aux approches communicatives
actuelles, sont en permanence traversés par la question des relations entre langue et
littérature et se trouvent éclairés par la connaissance des évolutions parallèles en langue
maternelle. En présentant ces méthodologies, nous espérons mettre au jour les
conceptions sous-jacentes et les attitudes face à la langue, à l’apprentissage et à la
littérature sur lesquelles elles reposent.
Celles-ci, qui comportent de nombreux traits communs en langue maternelle, seconde
e
et étrangère, donnent jusqu’à la deuxième moitié du XX siècle un rôle central à la
littérature – Isabelle Gruca parle de « couronnement » du texte littéraire (1994). Dans les
années 1960, au moment où les didactiques du français, langue maternelle et langue
étrangère, se constituent comme disciplines en se distinguant les unes des autres, l’étude
de la littérature se trouve dissociée de l’apprentissage de la langue et de la culture. Après
les années 1980, dans le sillage du renouveau linguistique des études littéraires, se
développe de nouveau une didactique de la littérature en classe de langue, dont la
spécificité est saisie d’abord en tant que discours, puis dans la perspective de la lecture et
de l’écriture littéraires ainsi que dans les approches anthropologiques.
Si le terme de méthodologie traditionnelle est souvent utilisé aujourd’hui pour désigner
– et quelquefois dénigrer – un type d’enseignement dans lequel un texte sert de base à des
questions de vocabulaire, de syntaxe et de compréhension puis à des exercices de
réemploi plus ou moins imitatifs, il est en fait hérité de méthodologies qui diffèrent à la
fois par leurs méthodes et par leurs objectifs : objectif pratique de communication ;
objectif formatif, intellectuel ou moral ; objectif culturel. En cherchant à comprendre
pourquoi ces méthodologies se sont succédé et ont été abandonnées au moment où se
sont imposées des approches issues de la linguistique appliquée, nous sommes conduits à
expliciter les différentes conceptions sur lesquelles elles reposent et les valeurs qui
déterminent les finalités des enseignements et de la formation scolaires. Ce faisant, c’est
le lien entre langue, littérature et culture qui est précisé, et les raisons qui peuvent
justifier, hier et aujourd’hui, que la littérature occupe une place importante dans les
enseignements de langue.
1.1. Évolution de la place de la littérature dans l’enseignement scolaire des langues
e e
étrangères et du français (du XIX au milieu du xx siècle)
Selon Christian Puren (1988/2012) et Isabelle Gruca (1993, 1994), les principales
9
e
méthodologies scolaires, qui se sont succédé jusqu’au milieu du XX siècle, sont fondées
sur une conception assez proche des relations entre langue, littérature et culture et
utilisent le texte littéraire comme support principal des leçons en considérant qu’il est à la
fois un réservoir de formes, un modèle de langue et un concentré de culture étrangère.
Pourquoi ? D’abord, parce que la littérature est assimilée à la culture, dont elle est
considérée comme l’accomplissement artistique dans le domaine langagier et qu’on
s’intéresse peu, alors, aux formes anthropologiques de la culture, qui se donnent à voir
dans des pratiques sociales. Ensuite, la littérature, en tant qu’art de langage, est placée au
sommet d’une hiérarchie établie dans la langue entre d’un côté les formes populaires et le
langage courant, jugés moins dignes d’être enseignés, et de l’autre, les formes savantes
valorisées par la culture scolaire centrée sur l’écrit. Cependant, les raisons de cette
valorisation et le rapport entretenu avec la littérature ne sont pas identiques dans les trois
méthodologies successivement adoptées dans l’enseignement scolaire des langues –
grammaire/traduction, méthodologie directe et méthodologie active – qui ont, en
revanche, de nombreux points communs avec les enseignements de langue maternelle
correspondant aux mêmes périodes.
1.1.1. Grammaire/traduction et « colinguisme » jusqu’aux années 1880
La méthodologie dite grammaire/traduction, qui vient des langues anciennes, se
développe au moment de la scolarisation de l’enseignement des langues vivantes, dans la
e
seconde moitié du XIX siècle. Elle ne concerne que les élèves admis dans le cycle long,
qui sont également ceux qui faisaient du latin (voire du grec). Elle considère le texte
comme la seule réalité linguistique et culturelle. L’apprentissage se fait par la traduction
du texte littéraire, c’est un travail minutieux sur les textes comme matériau qu’il faut
analyser pas à pas de manière exhaustive et détaillée pour arriver à la traduction la plus
précise et la plus fidèle possible. Le contenu culturel est, d’une certaine manière, au
second plan ; de même, la langue étrangère n’est pas véritablement l’objet d’une
appropriation puisque l’objectif est la traduction dans la langue maternelle. Cette
méthodologie se trouvait particulièrement légitime pour le latin – langue « morte »,
accessible uniquement par l’écrit – qui était considéré comme la « langue mère » du
français, par laquelle il semblait nécessaire de passer, de manière indirecte, pour décrire
et comprendre à la fois la grammaire et le vocabulaire français. Transposée aux langues
vivantes, elle révèle ses limites, à commencer par l’absence d’apprentissage de l’oral.
Dans la grammaire/traduction, l’élève travaille de manière silencieuse et solitaire, dans
un tête-à-tête avec le texte. L’objectif est celui du transfert : être capable de faire passer le
texte étranger dans la langue maternelle dont la maîtrise conditionne la réussite de
l’exercice de traduction, et qui est perfectionnée par cet exercice. L’exercice de version
apparaît ainsi comme une manière de traquer les contresens plus que comme une
exploration de la polysémie dont la traduction chercherait à préserver les potentialités. On
est ainsi loin des démarches actuelles, inspirées des recherches en traductologie (Plassard,
2009), qui font de la traduction l’aboutissement d’une lecture interprétative approfondie
et peuvent, à travers des exercices de double traduction, amener à une réflexion sur la
singularité de toute interprétation.
10