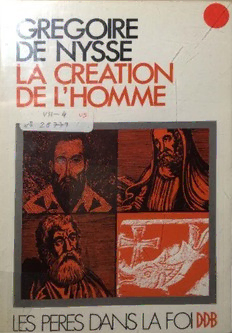Table Of Content,
1
us
\
1
\
Grégoire l i e N y s s e
•
1
•
La création
1
de l'homme
\
•
,
Introduction par
/
,
J.-Y. Guillaumin el A.-G. Hamman
/
Traduction par
J.-Y. Guillaumin,
agrégé de l'Université
,
,
1 •
\
•
1
(r /
,
,(
>
Collection cc Pères dans la fol»
1
-
-
• DESCLÉE DE BROUWER
-
-
1
\
puhliée la respomabililé
l'''ft' COl/l'OIOlI (.'.\1 SO/H
dt> /' nodalion ... P \fI gne
~
/7 rue cl' Par,n4"
,tI~'mhl!rl
"
Sommaire
,
,
1
ItllrodUClion
Grégoire de Nysse,.et la culture
L'anthropologie grecque
•
Grégoire de Nysse et l'Ecriture
Grégoire de Nysse et le livre de la Genèse
,
Analyse du traité
/
Principaux thèmes "
1
Contenu du traité
Saint Grégoire de Nysse:
•
La Création de I"homme
,
•
Idées-forces de la «Création de l'bo. .m e,.
\
1
Grégoire de Nysse et la Bible
Dieu et la création
• La création
L"homme
() Desdée De Brouwer /nd. .x des citations bibliques
ISB),j ; 2-220'{)2382-6
,
ISSN; 0180-7439
Bibliographie sommail'fl
•
_.--
-
•
1
1
-
\
INTRODUCTION
,
,
Il Y a mille six cents a ns, Grégoire de N ysse, dans la
force de l'âge - il a 4 5 ans - et la plénitude de son génie.
publie le t rai té sur la Créal;oll de l'homme. Modestement.
il prétend simplement achever l'œuvre de son frère. Basile.
qui vient de mourir et qui avait commenté l'œuvre des
cinq premi ers jo urs de la création , dans l'Hexaemeron. en
neuf homélies, sans traiter de la c réation de l'homme, Gré
goire envo ie son traité à son frère Pierre. le cadet de tous
deux, évêque de Sébaste, Sivas. aujourd'hui en Turqll ie.
Dans son traité de la Créal;oll de l'homme )!ans
comm~
sa Catéchèse de la Jo;, Grégoire est soucieux de pénétrer le
donné de la foi avec toutes les ressources de .;on intelli
gence et de sa culture, Loin d'opposer la raiso'l à la rêvé
latio'h il l'utilise pour mieux l'interpréter et cerner la
C1I
nouveauté.
1
1
, /
,
Grégoire de Nysse et la culture \
Homme de son temps, Grégoire récapitule en lui toute
la culture de l'Antiquité: il a passé de longues années à
acquérir une fOOlilation philosophique dont les pilieB sont
les œuvres des grands penseurs grecs: il a étudié la rhéto
1
rique en cette époque très marquée par la "seconde sophis
till,ue», et l'on voit revenir dans son œuvre des
thèoliKI
au
constamment développés par les rhéteuB. Il est
OlhOt
-
•
/
,
-
10
1 1 1N TRODUCTION.
INTROOUCTION
connaissances scientifiques de son tem ps: les ciens est une pàrtie de cet univers soumis au Des1-in, et
mat~émati
ques euclidiennes, avec tout ce leur a apporte la \Dh dont 'toutes les composantes sont solidaires. A l'intérieur
qu~
1
dition (cf. chapitre 22, vers la fin), 1 astronomie (ch. 2 1), la , de l'être humain lui-même , tout est dans une harmonieuse
musique (à laquelle il emprunte très fréquémment des solidarité: au "poste de contrôle" de re emble, l'âme,
images); la médeci ne enfin, qui semble le paksionner (elle «comme une araignée au centre de sa t lie» disaient les
est partout le chap!lre 30 lUi sera consa stoïciens, veil le au bon fonctionnement énéral, grâce aux
présent~t...\9ut
cré). Ses maîtres en ces domaines semblent être surto ut le 1r amifications que constituen t les sens.
grand stoïcien Poséidon ios et le grand médecin stoïcisant On sent bien tout ce que doit Grégoire il cette anthropo
1
logie assez répandue parmi les esprits d~ son temps -
Galien '. '
La lecture du traité sur la Création de "'homme mani encôre que sa sérénité fût âprement discutée par certaines
feste avec clarté la lucidité avec laquelle Grégoire utilise écoles, comme celle des Sceptiques. Il accepte en efTet cette
l'héritage culturel de son époque. S'agit-i l d'être un concepti on qui fait de l'être h.umain le résJltat d'une orga
homme moderne, ouvert aux dernières découvertes scien nisation supérieure, caractéri sé d'abord par./a puissance de
tifiques, il l'est, et avec enthousiasme: la foi de Grégoire son intelligence, et découvreur de penseurs nouveaux.
n'est pas celle du charbonnier; il aime l'expérimentation L'espèce -humaine domine autant le règne animal que
scientifique. En revanche, là où les réponses de la doctrine celui-ci est au-dessus du règne végetal et des minéraux .
stoïcienne donnent prise à la discussion et à la contesta D'ailleurs, l'homme est remarquablement organisé par le
tion , là où le cbristianisme va plus loin que toute philoso finalisme de la nature. Toute une morale pratique, de plus,
phie, Grégoire s'envole aux ailes de la mystique : la foi de . est véhiculée par ce stoïcisme vulgarisé, morale que Gré
Grégoire, véritable explication du monde, se rit de la phi goire n'a cure de rejeter, puisqu 'e lle manifeste souvent des
losophie, et parfois de façon sarcastique: en témoigne le lanalogies assez sensibles avec celle du christianisme.
traitement qu'il réserve aux tenants de la métempsychose Seulement, pour l'école stoïcienne, l'homme est si bien 1
dans le chapitre 28. Ca r on pourrait dire, paraphrasant
partie prenante du monde que, volontairement ou non, il
.f
Pascal, que ,<la vraie sagesse se moque de la sagesse ».
ne peut que s'y fondre totalement. La vie humaine est
comme une pièce de théâtre donC nous sommes les
,
acteurs: la seule chose qui dépende de nouspt de
L'anthropologie grecque bi~n
Ji ,jouer le rôle qui nous a été imparti par le, Destin. Dès lors,
Héraclite d'Ephèse, Socrate, Platon, Aristote, les pre
quelle liberté reste-t-il à l'homme, puisq\le, à bien regar
y
1
,?iers stoïciens, Poséidonios, puis tous les syncrétismes de
der, ,des choses qui ne dépendent pas de nous», pour
l:epoque tardive, telle est la chaîne de tous ces hommes
reprendre les expressions d'Epictète, SO!)t bien plus nom
qÛl, ~u si~c1e avant J.-C. jusqu'au de notre ère, ont
VI' IV' breuses que «les choses qui dépendent de nous»,je~el-
de repondre à la question: «qu'est-cI! que
t~nte les, au fond, se ramènent à la simple acceptation ~ re
1 homme ?» La tendance profonde de l'esprit grec est de
destinée. / \
situer l'homme, "microcosme» (" petit monde»), par rap
port au monde, «macrocosme». L'homme, pour les stoï-
1-
~ ~ ~màer
siecle avanl J. . .('.
t
O!bu. ..
.pra J.oC.
1.. • "
-
- ,
INTRU 'UCTION 2
J 13
INTRODUCTION
Grégo, ' e de Nysse et l'&riture
J
l'homme, préface) . U e lectu re bibl ique sans effort ph ilo
, Gré soph ique et théologique semble im possible à G régoi re.
'oire nous a laissé des commenta ires de la Genèse,
de l'E~ode, des Psaumes, de l' Ecclésiaste et du Ca nt ique Les ressources de l'i ntell igence et de la phliosoph le ser
vent de levier mais l'objet - o u plutôt le sujet - de leur
des call tiques. Son exégèse du Nouveau Testament est
~'est
in vestigation pas de leur o rdre, mais est donné préei.
moins abondante. Nous avons déjà p ublié ses comm entai
.'
res des Béatill/des et de l'Oraison dominicale. sément par l'Ecriture le message que son Auteur no u.s
.
,
, . .
~
transmet. L'herméneutique gregon enne s evertue a inte-
Les divers thèmes bibiiques - Exode, Ca ntique, Béati
grer « sens li ttéral et sens théologique, histo ire et contem-
tudes - tracent toujours pour G régoire l' itinéraire spiri
plation ». ,
tuel la marche vers D ieu. Grégoire cherche dans l'Ecritu re
Grégoire revient avec prédi lection ce . thème: I<La
le fdndeme nt et le modèle de l'ascension, à travers les p uri su~
J
pauvreté de notre nature est Im p Uissante a le prlnè,pe
fications intérieures, vers le m ystère inaccessible de Di eu, VOI~
dévoilé dans le Christ. de la sagesse qui sémani feste dans chacun des etres ; conSI
' dérer cependant un certain enchaînement des
Com me Jean Chrysostome, Grégoire part du sens littéral fa'ts~ sUI.va~t
l'ord re fi xé par le Créateur, telle est la contemplation lOte:
et de l'histoire, ma is il n'en est pas prisonn ier. Il cherche
-
riorisée accessible avec quelques conjectures, a ceux qUI
les liens entre les réa lités de l'histoire et l'économi<;- du ,
,
save nt obse rver co mm e il faut l'enchamement>>
sal ut. Seul le dessein de Dieu pe rmet d 'attei ndre le sens
(Hexaem eron).
théologique du texte et de découvrir sa cohérence. Il lui
Da ns la Création de l'homme, l'évêque de Nysse est
importe de découvrir les articulations qui constituent
préoccupé de ce rner d'abord le sens littéral du rédacteur
l'akolOl/thia du dessein de Dieu. « Le mot akolouthia
h umain et l'enchaînement des événements. Il remanque
désigne à la foi s Ja suite matérielle du texte de la Bible, la
que le sens littéral peut avoir une signification
liaison nécessaire des réalités de l'histoire du salut et la lui-m~rpe-
méta phorique, qui n pas .Je sens spmtuel , ce ql\1 avall
correspondance analogique, q ui existe entre les deux '~st
échappé à l'école d'A I,exandne e.t lUi per'!'et de prendre ses
plans » dit Jean Daniélou .
d istances par rappo rt ,à son mallre O,:,gene. .
Il lui faut donc eXami ner le sens littéral pour dégager
1
«On trOuve chez et chez GregOIre de Nysse, d!t
l'enseignement spiri tllel. Cet effort d ' interprétation , Gré ~asile
J. Daniélou , un type d'exégèse A' ii 9'est ni l'exégese alle
goire l'appelle Ihéôria , recherche d'interprétation spiri
gorique d'Alexa{ldrie'ni l'exégèsé lit!érale d:AntJoche mais
tuelle. La Ihéôria n'est pas d 'abord une . contemplation
un effort pour concilier les ~o~nées1Ik.I~glqu~s et,la ~~
parce que « les ascensions ne donnent pas à l'âme la vision
sée scientifique. Or cette exegese c.nc.rdlste nad antece-
et la saisie immédiate de la réalité», mais elle progresse
dent que chez Acade de "
vers la vision de l'Invisible. César~e.»
Cette quête d'infini chez GregOIre de Nysse n est tnbu
Il s'agit aussi pour Grégoire de confronter l'Ecriture avec
taire ni de Platon ni d'Aristote, elle est mscnte dans la
la réflex10n afin de résoudre les apparentes contradictions
révélation divine elle se trouve dans <da parole fime du
qUI peuvent se rencontrer, en discernant l'enchaînement
Dieu infini» pa;ole qui polarise toute I~ marche vers le
en profondeur qui conduit en réalité «vers un seul et
co~p
Dieu de la béatitude et la béatitude de DIeu. .. La
même but , grâ~e à la puissance divine» (Création de
tion grégorienne de. l'infini divin - comme celle ~''!!.~
de Poitiers - est Impensable en dehors de la réiL
lOI!
3. Pour chaque texle de la coll~IOO noûs nous interT'OlCrons, dans les notes biblique». • .....
dt: tra ... all. a la fin du h ... re, 5ur la maniere dont l'auteur utilise "Ecriture. Le rôle de l',xégèse est de mener le croyant à la
1
ANAL YSE 0 T RAITE'
14 15 ,
1 RODL(TlON
-
-------------------~
1
maux, ceux-ci ne venir de D ieu, qui agit toujours
p~uvent
d, 'exégèse, au silence de la contemplation. G régoire
,,:,,1
avec Le ne peut proveni r q ue de J'ho mme: de
bo~té.
l'"'prime dans un admirable, le jour de son ordina
t~xte
sa Iiberte, qUI agft contre sa natu re profo nde, ce lle qUI lUI
'on . • Supposons quelqu'un, dans la chaleur de midi , che
a été donnée, lors de la créat ion .
!T'10er la tête brûlée par le soleil, qui aspire toute l'humi
dité du corps. Rude est le sol que foulent les pieds, la route
est pénible. ardue. Soudain voici une fontaine. Les ea ux
\
Analyse du traité
coulent, limpides et transparentes. En abondance les nots
s'olTrent doucement pour étancher la soif. Va-t-il s'asseoir
Le traité se en trois grandes pa rties :
di vi~e
pres de cette source et se mettre à philosopher sur sa
nature, en scruter l'origine, le comment , le pourquoi, et le - la thèse - , phil osophique ( 1- 15 ): La vision de
reste ... ou plutôt, ne ·"a-t-il pas « ba lancer » tout cela, se l' homme dans sa qouble pa renté avec Dieu et avec l'uni
pencher pour approcher ses lèvres des eaux vives el vers. Vision d'abord idéale, hors de l'expérience histo rique.
remer~
cier Celui qui lu i en a fai t le don ? Im ite donc cet assoiffé. » Grégoire a 'est pas un naïf, un o pt imiste inconllitionnel.
Il con naît le "pessimi sme des tragiques grecs mais ne s'y
l
attarde pas. Il préfère s'en prendre aux stoïciens, qui font
Grégoire de ysse et le liHe de la Genèse ,
de l' ho m me un m icroco me, une image no n de Dieu mais
Pour G régoire comme pour Basile la Genèse fournit 1 d u cosmos, ce qui finit pa r absorber J'homme dans un pan
une doctrine sur le monde et sur l'ho'';me dans leurs ra p théisme matérialiste.
,
ports avec Dieu. Elle met à la portée du pl~s grand nombre
- l'amitllése - biblique ( 16-20). Face aux philosophies.
la magnifique ordon nance de J'univers ; elle permet à ceux
la Révélation décrit J'ho mme « créé à l'image et à la res
qUi a?ordem. ces par l'intermédia ire de sa pen
problè~es
se mblance de Dieu». Lo in d'opposer comme Philon et
see d acquenr .Ia connaissance du monde, tel qu 'il a été
O rigène les deux réc;ls de la création, Grégoire s'e!Torce de
cree par la sagesse, qui est celle de Dieu (Préface de
vraIe
de r
les ha rmoniser.
la CréaI/on l'homme).
Le premier récit présente la préexistence de l'homme
, Grégoire ne cherche pas le sens de la créati on et de
dans l' intention de Dieu: l'homme comme DÎeu le voit le
1 homme dans, quelqu~ cosmologie mais dans le livre du
.
'
projette dans son intention et dans son terme et son achè-
. Commencem,nt». La Dieu nous fait découvrir que la
vement hi stori~ue. Nous sommes ici hors de J'histoire et
est mOins .œuvre de puissa nce que d'amour.
c~eatlon
du temps du n:tystère de Dieu.
L ho:;,me surtout lUi apparaît comme « la merveille du dan~ l 'intemE?:I!~
Le second reclt, au plan dO"'I hIstOIre et du devenir, selon
mon e, qui dépasse en grandeur tout ce que nous connais
-
sons~. le thème de la progression cf,c.'r à Irénée, est le temps de
Il ne sera pas sa . , - d
J'expérience historique. )
G ' . ns IOteret e comparer l'enseignement de
de
c~~:(o),:~e d;~slala CréQ/i~n
l'homme et celui de sa
, :-Ia sJ'nthèse - (2 1- 30). Le devenir du temps est donné
10/,
années et posteneure sans doute de quelques
a 1 homme pour atteindre et réaliser le dessein que Dieu
dam 1~/ol.qUI a paru , en 1979, dans la collection Pères
aval! conçu. Ce sera l'achèvement, l'accomplissement
mots)
Dans la Catéchèse 1 " l 'ac~ession à la perfection (Grégoire emploie tous ces
lUI paraI! bonne e ' ' . a ~reatlOnen tant qu'œuvre de Dieu
de , 1 ~omme: aussi bien de l'Humanité, parvenue enfin a u
,
•
semble plus ~I, é~s:'1. , e pal ~dls dont parle la Genèse lui Plerome (c'est-à-dire, en grec, à la Plénitude), que de cha
qu un leu. Si l'homme connaît des
que Individu humain, de la mort, Comment cela
-
/
\
,
16 17 PRINC IPAUX THEMES
PRJNCIPAUX TH EMES
,
s·ac(·om pli ra. c'esC un mystère: il s'e,,; re,mettre à Di eu traité de la Créa/ion!.e l'homme, Grégoire étudie le t~ème
r~ ut
et à sa toute-pui ssance. Conformement a 1 ense Ignement sur le terrain ontol9Sique, avec une ouverture sur le derou
de Pa ul la résurrection marquera pour G régoire l'achève- lement du temps et du devenir. La différence entre créé et
- <RCJ1t d~ la création universelle , et la fin du temps, désor incréé a comme conséquence de situer l'homme dans le
mais inutile au perfectionnemen t de l'hom me. Tout sera temps et le changel11ent, Dieu est immuable et n'est pas
accompli, tout sera rétabli (c'est le sens du mot « apo soumis au temps.
1 .
catasta, e», «rétablissement ») dans sa dignité première , La mutabilité de l' homme , qui constitue sa nature hIs
qui prendra une forme nouvelle. Déba rrassé des contin torique, s'expri me d'l'bord:
gences de la matière, l'U ni vers s'ouvrira à la liberté du - dans sa création même , qui est passage du non-être
Christ. On voit ce que la pensée de Grégoire peut avoir, à l'être modification pour celui que Dieu fait exister..
,
pour ainsi dire, de teilha rdien o u plus justement ce que - dans la prévisi«>n divine. En créant l'homme hbre,
,
,
Teil hard a de grégorien . Dieu se doit d'en mesurer les conséquences, de prévoir le
mauvais usage , t les infidélités.
- la division en sexes s'inscrit dans cette éeon6mie du
,
Principaux thèmes
devenir, du changement et du temps. Elle caractérise l'éco
nomie de la mutabilité et du temps mais s'achèvera avec
L'archétype e/ l'image .
elle.
Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître 1", place
La sexualité n'est pas la conséquence d',lÎne faute ou
centrale que la doctrine de l'image occupe dans le traité
d'une chute mais d'une condition, d'une nature temporai
sur la Créa/ion de l'homme et dans toute l'anthropologie
rement muable et fragile, soumise au conditionnement du
grégorienne. Elle est, dit Leys, «la clef de sa doctrine spi
temps (avec la procréation). Ce caractère surajouté et pro
rituelle, la p(èce maîtresse de sa spéculation théologique,
visoire de la sexualité dans l'ordre providentiel pour
~ntre
l'argument dé.isif de sa polém'que contre Eunome». Elle
le développement de être.
n~
es. t «point de départ et but de toute l'hi stoire humaine» ,
D'où une certaine ambiguïté, connaturelle ail devenir
ajoute W. Vôlker.
humain, où la et la passion sont à la fois consé
sex~alité
Le paradoxe cl,e la transcendance divine est qu'elle
quence d'une défiFience de la liberté (péché), et bienfait
puISse se communiquer. Dieu donnant ne peut que tout
indéniable pour l'/lomme.
donner s',1 fait participer l'homme <<à tous ses biens» .
La pensée de G.régoire s'e«f.tt,e en deux phrases capi
D,eu. se donne lui·même, ce pourquoi l'image comient
tales: « Nouil sommes image dans la pres
~s puis~nce
nudealfement tous les attributs de Dieù, sa nature comme
ciente de Dieu qui, dès l'originé, •e l'humanité comlDe
se~ energ,es, y compris son caractère d'incompréhensibi
un seul corps.» En même temps n us ne devenons
hte .. Le mystère insondable de l'â me humaine est le renet
que peu à peu, par le choix de la liberté, rendu
de 1 lnc?mpréhensibilité de Dieu.
par notre condition temporelle (ch. 22). Chaque individu
Archetype et ima d' .
. ge ne se Istlnguent donc pas par leur
participe à sa manière pelliOnnelle «à toutes la açtiYiMs
«l' nature» ,n., leurs qualités mais par leur mode d'existence
un est cree l'aut . , . . , par lesquelles la nature divine est chez celui qui_
l'u l" re Incree. La dIfférence essentielle est que
n est. autre a. à son image. L'Esprit habite III .....
(ch. 16).
pe!=~lance l'a~chétyp~
et différence entre et 1
Grégoire insiste sur l'unité des
1
19 PRI NCIPAUX nu.M lS
~----------------------------
hommes aux derniers est une image unique de Celui qui tion (ch. 12). Die u n'est /as la ca use du mal , pas plus que
esC" (<;h. 16). L'image est donc la collecti,vi té ne l'est quelque principe ma nic héen du mal. Certe;,
hu":,ain~
dans son achèvement, le Chnst total, tel qu 11 sera rea hse l'homme a été victime de Sata n et de ses ruses (ch. 20):
à la fin du temps, tel que l'artiste-créateur le VOit dès le mais le res ponsab le du mal est l' homme lui-même, qui a
premIer I• nstant. succombé à la tentatio n .
Grégoire de Nysse tire du double réci t de la création
Le temps
deux conclusions essentielles:
- un seul homme, appelé Adam c'est-à-dire <de ter La longue reconquête par l'ho mme de sa dignité pre
reux », désigne l'ensemble de l'humanité. Il s'agi t donc mière rend compte du rô le du temps dans l'anthro pologie
d'une appellation collective. L'évêque de Nysse rejoin t ici de Grégoire (ch. 22). Si Dieu, de to ute éte rnité, a conçL le
l'exégèse la plus moderne. «plérôme» huma in , le te mps est nécessaire à l'homme
- l'humanité est à comprendre comme un tout. dans sa progressio n vers l'achèvement de son espéce. Cer
Comme telle, elle est l'i mage unique de Dieu . En D ieu tçs, il est en un ce rfa in sens la marque de la déc héance
l'image équivaut à la totalité concrète de l'huma nité, au humai ne: l' homme, tourna nt le dos à Dieu, glisse aussi
corps mystique en son entier tel que le déroule ment du hors de l'éternité da ns le do ma ine du temps. Il n 'en reste
temps le mènera à sa pleine stature et à son plerôme. pas moins qu 'i l a son rôle à jo uer dans l'économie du
salut : comme le temps est nécessa ire au mûrissement de la
La chute et le mal (ch. 20)
moisson (fin du c h. 22), il est également indispénsable à
Alors que dans un passage, G régoire semblai t sacrifier à l'épano uissement de l'humanité et de la création tout
la thèse platonisante de Plotin sur la responsabilité de la entière, dé livrée des douleurs de l'enfantement ; cet épa
matière (ch. 12), il place la matière hors d 'accusatio n dans no ui ssement une foi s atleint, le temps, désormais inutile,
le désordre du monde: elle est en soi indifférente, elle disparaîtra au moment de l';H'OCatastase, c'est-à-dire dans
prend beauté ou laideur selon la détorminatio n de la la resta u ration universelle ét finale .
liberté humaine.
La théologie de l'h istoire, chez Grégoire de Nysse dont
La pensée de G régo"i(e sur l'origine du mal tient en deux les modernes ont releve! l'actualité, se ramène à trois carac
1
proposIt ions:
téristiques essentielles:
- le péché est l'œ uvre de la liberté. - e lle est théologale. Elle dans le mystère du
s'el)l1'~me
- l'ho.mme a péché « pa r ma nque d 'expérience », man- Dieu de la révélation. C'est là qut tl/omme surtout trouve
que de discernement, égarement, igno rance. Ce qui rap l'explication de son origine, de sa sl\"U;;ture et de sa desti-
,
pr~he cu ne usement Grégoire des thèses d'Irénée (cf. nee.
~
~redicallon apo~toliqlle). Le péché s'introduit dans - elle est chris/alogique. Grégoire montre dans ses étu
1 homme par la seduction du plaisir. Le plaisir s'insinue des le rapport entre le Christ et le temps, entre sa structure
mSldleusement comme le serpent de la Genèse, et devient ontologique d'Homme-Dieu, sa condition historique,
amSI «la ra~me de tous les maux» (ch . 20). «l'immixtion du divin dans l'humain », modèle et prémi
. La hberte humaine permet à Grégoire d'apporter sa ces de la transformation et de la ressemblance du corps
~~se au c1ass,que problème du mal. Si le mal existe total, ce qui éclaire le sens et la fin de l'histoire et du
ns e ?londe, si l'bumme est soumis au pe' ché c'est qu'il temps,
a tourne le d ' l" 1 . '
os a ec ar-de..la l umière du Bien ' le miroir - elle est escha/ologique (tendue vers la fin), En
que nous sommes d ' l'bé ' ,
a e rement refusé de remplir sa fanc- guant nettement les deux plans de l'éternité et du tenelmifll,
1
1
20 ,
,
ce qui est cn Dieu ct ce q.Ji est soumis au devenir, Grégoire
e;,qu,sse une théolog:e de l'homme et de l'histoire jusqu'à
l'achèvement. Anthropologie qui est en même temps une
;\.:le,chatologie: réalisat,on d travers le temps du Christ to ta l,
dans l'Image parfa'te, unique et universelle',
J,-Y, Guillaumin et A,-G, Ha mman
,
Contenu du
trait~
'_m.
Préambule: uttn de Grigo;rr G .If/tin lIommage a BaJI/r,
Bien qu",d,gne, Gréf.(OIre \'U completer lA' dr
~(Jn aU'Vff!. pa,ad().l~
l'homme.
,
CA."itn 1 - (( La na/Url! parlf(:ulr"'e du nron~e: u qUI a pricbJi
l'apparition de l'homme }}
~'
c.rl.
Pe5unteur el légèrrté. Fixilé el mouW-rPWnI. Te,re el CIUtlCU"
intermédiaIre de l'a" el de l'eau. lA le"e esl fixe. mais SOUMLW à
/'ë\'olmion . le fiel. qlll 11 'ém/ue pal. "'Q pin de fixaI : a.ilui. "i l'lUI Il;
l'azure ne saurall être O,ru La le"' aWJ1I1 l'appaff"OIt fk 1'1tomfft# Ky
r
beauté sans Maitre
CluJpitrr 2 - «PourquoI C '('SI ap"} 10. ,,:talion ft lfIOIfM. ft II
dernier. que àéé l'homme. "
fUI
1
Les men'elllej {je /'umwr.\ {,","haux.
\ pOlir l 'homme qlr,' dOll lel J( miner: il donc
~j,
pri!âde l'appan IOn de l'ho,,,,"-... Ln dnL'C .r;' ;,
dam la crNuon' de
l'homme .Y'I,.~yill ~, I~ 'e"~strr.
hu:na~ ~J'
• Ci"';',. l - «La na'u,e plus ptkiftl# qw Il
IOIIM'
création visible. »
SI Dieu «imp,ov;s~» la c,la,ioll.l'"ni~,s~' • .ses l'ItIIIf'WiIItsll
n 'enlreprmd ce/I. d. l'homm. allOir dljini jillGlilh "
qu'apm
:In
"ut •
prépare sa malièrt, qui monl" qw Dwu auocM phu •
ft
n"'''.
l'homme qu 'au tk s,s
"s/~
CItqIm 4 - «La crftUiolt • /'itotfurtt .ipj/It _ ".",.
domina/jOlI su, l'uniulS.. " -
La nobI.SM • l''- . . . . . "" •
n..-. """"
Ilmoi.,", ./0., JJIIipnh'i*o"r l•II . ,......,.,
promu' G /0