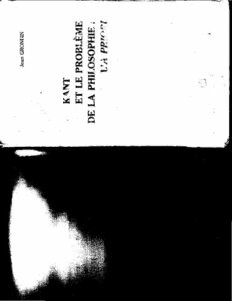Table Of Content_;;: , Ji '.1' ;-/. ."\, ,
C... I!~';i. ..
L./J-c.::". _.1
BIBLIOTHÈQUE D'HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE\--
Fondateur: Henri GOUHIER Directeur: Jean-François COURTINE
KANT ET LE PROBLEME
DE LA PHILOSOPHIE ·
L'A PRIORI
par
JEAN GRONDIN
PARIS
LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE 1. VRIN
6, Place de la Sorbonne, Ve
1989
,
A mes parents
La loi du Il mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article
41, d'une part, que les «copies ou reproductions strictement réservées à l'usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective» et, d'autre part, que
les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, «toute
représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, fait~ sans le consentement
de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite» (Alinéa 1er de
l'article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit
constituerait donc une contrefaçOb sanctionnée par les Articles 425 et suivants du
Code pénal.
© Librairie Philosophique J. VRIN, 1989
Printed in France
ISBN 2-7116-0979-0
AVANT-PROPOS
Sans détour: l'intention de ce livre est de comprendre le sens de la
Critique de la raison pure. Il entend montrer jusqu'à quel point et en
vertu de quelle rigueur le problème essentiel de la Critique est celui de
la possibilité d'un savoir a priori. La question cardinale de Kant est
olen-:
'corruÎlent des jugements synthéiiquesa priori sont-ils possibles?
Cela n'est que trop connu. Mais la réponse de Kant l'est beaucoup
moins. Où Kant répond-il, de manière claire et distincte, à la question
de la justification du jugement synthétique a priori et de la méta
physique comme science?
Ce qui nous a incité à revenir sur cette question, c'est l'absence
presque totale dans la littérature kantienne d'une étude qui réponde
adéquatement aux réquisits du problème soulevé par Kant, celui de la
crédibilité d'une connaissance a priori. La solution la plus couramment
apportée au problème de l'a priori consiste à dire, assez vaguement,
que l'a priori i~uJJ .. d~~~_e_x~JJ~i!~objectiv~ quand il ne s'app~i911e
gu 'aux d0l!~~~l Q.e .1~~~p§ri._~~~~ ou parce qu'il rend l' exp~rience
P9.~~~~ïe.-La difficulté de cette thèse, c'est qu'elÎe explique tout au plus
la possibilité de la connaissance scientifique empirique (ou de
l "expérience'), laissant entière la question de la viabilité d'une
connaissance par raison pure, celle d'un savoir synthétique a priori,
que veut être la philosophie. Nous soutiepdrons que le problème de
l'objectivité de la connaissance empirique (qu'est censé résoudre
l'intervention d'éléments a priori, les catégories, dans l'expérience)
n'est pas du tout celui qui préoccupe l'interrogation critique de Kant.
Bien au contraire, c'est l'évidence incontestée et jamais problématique
du savoir empirique qui rend urgente aux yeux de Kant la question de
la place de la philosophie, la question d'une connaissance qui soit
rigoureusement synthétiqu'e' et a priori. Voilà le problème de la
Critique de la raison pure.
En tâchant de découvrir une réponse à cette question dans la
Critique, on ne doit jamais oublier que Kant ignorait en 1781 qu'il
allait publier quelques années plus tard une Critique de la raison
pratique et une Critique du jugement. Cela signifie que dans la
~.".
8 AVANT-PROPOS AVANT-PROPOS 9
perspective de 1781, la Critique de la raison pure à elle seule doit être jusqu'à Kant, est la philosophie. Chez Kant, cet idéal sera rendu
en mesure de répondre de manière satisfaisante et complète au envisageable en raison d'un intérêt objectif de la raison pure pratique.
dilemme d'une connaissance a priori. Ce qui doit être possible depuis Il ne faut pas attendre la Critique de 1788 pour connaître la méta
cette Critique, c'est l'édification d'une métaphysique. Suivant la physique des postulats de la raison pratique. Elle forme déjà
division qu'on estime essentiellement tripartite de l'œuvre, l'aboutissement de la première Critique, la seule que Kant jugeât
l'Esthétique doit traiter de la possibilité des mathématiques, indispensable à l'essor de la métaphysique en 1781. Il est donc possible,
l'Analytique de la physique pure et la Dialectique de la métaphysique. à partir de la Critique de la raison pure, de répondre au problème de la
Or la Dialectique se présente comme logique de l'illusion. Est-ce à dire possibilité de la métaphysique et de ses jugements synthétiques a priori.
que la métaphysique soit condamnée à l'erreur? On sait que telle La compréhension de la philosophie kantienne et de sa postérité en
n'était pas l'intention de Kant, même si ce fut son efficace historique. dépend.
Mais où se cache alors la solution kantienne au défi de la possibilité de Notre parcours de la philosophie kantienne se bornera donc ici à la
la métaphysique comme science respectable? Peut-être faut-il réap seule Critique de la raison pure, clairement introduite en 1781 comme
prendre à voir que la division de base de la Critique n'est pas seulement l'unique propédeutique nécessaire à la construction d'une méta
tripartite. Il y a bien une 'quatrième' partie après la Dialectique: la physique qui soit déploiement d'une connaissance a priori ou par
~_~~~~~~.~()_gie (Discipline, Canon, Architectonique, Histoire de la raison pure. Ce pari méthodologique ne signifie pas que doivent être
raison pure), à laquelle Kant avait réservé la dignité d'être la seconde ignorées les deux autres Critiques, mais que leur statut et leur possibi
grande section de la Critique, après la Théorie transcendantale des lité sont fonction de la révolution métaphysique mise en œuvre dans la
éléments. Ce n'est pas rien. Cette section passe souvent pour un simple première Critique, celle qu'il faut d'abord maîtriser. Ceci apparaîtra
appendice à la Critique. Cela vaut dans une large mesure pour tout particulièrement évident pour la Critique de la raison pratique.
l'Architectonique et l'Histoire de la raison pure, chapitres parfai C'est que la prise en considération de l'usage pratique de la raison pure
tement schématiques où l'on ne sent pas toujours le pouls d'un fait déjà l'objet d'une critique complète de la raison pure, dont Kant
questionnement proprement critique (si bien que la tâche première de n'a jamais dit en 1781 qu'elle se limitât à la raison spéculative (ce qu'il
l'idéalisme postkantien sera de réécrire les deux derniers chapitres de sera conduit à affirmer après avoir conçu une Critique de la raison
la Critique de la raison pure). Restent la Discipline et le Canon de la pratique, mais dont la nécessité n'a jamais été perceptible dans la
raison pure. Le premier chapitre est quant à l'essentiel un rappel de la philosophie kantienne avant 1787). Nous montrerons, au chapitre IV,
Dialectique, dont tout l'exercice aura été finalement de discipliner les comment l'idée d'une métaphysique de la raison pratique représentait
excès métaphysiques de la raison spéculative. Et si la conclusion de la déjà l'issue, voire la conclusion de la Critique de la raison pure. A ce
Critique se trouvait dans le Canon de la raison pure? Un canon se titre, on pourra soutenir que toute la métaphysique de la seconde
définit comme« l'ensemble des principes a priori du légitime usage de Critique est déjà renfermée, en germe, dans la première, tout spécia
certains pouvoirs de connaître en général ». Le Canon de la raison lement dans la Méthodologie de la raison pure, dont F. Marty a raison
pure sera donc l'ensemble des principes a priori de l'usage légitime de d'écrire qu'elle a été trop souvent négligée dans les études kantiennesl
.
la raison. Ne s'agit-il pas très exactement des principes a priori que C'est dans le projet de la Critique de 1781 qu'il faut commencer par
cherche à établir la philosophie critique avant et afin de déployer le entrer de manière convenable, c'est-à-dire selon sa rigueur propre, si
système de la métaphysique? Il Y sera en effet question, selon l'intitulé l'on veut élaborer, ce qui ne sera pas encore tenté ici, une juste
de la première section du Canon, de la fin ultime de l'usage pur de la compréhension de l'ensemble de la pensée critique et métaphysique de
raison. C'est dans ce cadre que trouveront place, et réponse, les trois
célèbres questions de la raison pure: que puis-je savoir? que dois-je
faire? que m'est-il permis d'espérer? Autant de questions qui seront
suspendues à l'idéal du souverain bien, dont la doctrine, des Grecs 1. Cf. F. Marty, La naissance de la métaphysique chez Kant. Une étude sur la
notion kantienne d'analogie, Paris, Beauchesne, 1980, 523.
.
~ l '
~ -~
,
10 AVANT-PROPOS
Kant. Dans cet esprit, on suivra Gadamerl en appliquant à la Critique
de la raison pure le mot célèbre prononcé par Goethe lors de la
canonnade de Valmy: «d'aujourd'hui et de ce lieu s'élève une
nouvelle époque de l'histoire du monde».
INTRODUCTION
*
* * « C'est donc pour le moins une question qui a
encore besoin d'une recherche plus poussée, et que l'on
Au plan typographique, on a tâché de respecter les conventions
ne peut régler sur la première apparence, que celle de
actuelles. On emploie la majuscule pour des termes comme Déduction savoir s'il y a une telle connaissance indépendante de
ou Dialectique transcendantale quand on fait référence à des textes ou l'expérience et même de toutes les impressions des
des titres de section, mais la minuscule quand on pense surtout à la sens. »1
chose dont il y est question (la déduction transcendantale des concepts
Bien que ses racines plongent dans la philosophie grecque la plus
purs de l'entendement n'a donc pas le même sens que la Déduction du
matinale et qu'elle ait été un bastion du rationalisme précritique, la
mOême nom). Des guillemets «typographiques» ont été employés pour
notion d'a priori est immanquablement associée à la pensée de Kant et à
les citations (de passages ou de mots) et des guillemets 'allemands' pour
ses plus exactes caricatures. L'idée d'une connaissance a priori incarne
la mise en 'perspective' de certaines formulations. En principe, tous les
la pierre de touche de l'édifice du transcendantalisme. Si la méditation
mots étrangers ont été soulignés, comme le veut l'usage français, sauf
kantienne peut se définir comme une philosophie de et pour la raison,
pour la bibliographie où les italiques n'ont été utilisés que pour les
la raison dans sa pureté étant la faculté de connaître a priori ou par
titres de livres et de revues.
principes (C.F.J., Ak., V, 167; O., II, 917), il semble que l'ensemble
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à la Fondation
de l'effort philosophique de Kant doive être voué à l'a priori. L'a
Alexander von Humboldt qui a subventionné nos recherches à
priori en son universalité la plus stricte impose en effet sa loi aux deux
l'Université de Bonn, siège du Kant-Archiv.
grands versants du kantisme: la philosophie théorique accomplit une
révolution copernicienne en fondant la connaissance sur les concepts
purs de notre esprit, tandis que la philosophie pratique veut découvrir
la norme suprême de l'agir moral dans un commandement a priori,
. l'impératif catégorique. La périphérie du kantisme ne résiste pas non
plus à l'appel de l'a priori: la troisième Critique s'emploiera à définir
a priori les principes du jugement de goût, la Religion défendra la
légitimité d'une «reine Religionslehre» et d'un «reiner Religions
g laube» et le concept du droit sera déduit a priori dans la Méta
physique des moeurs. L'Opus postumum tentera certes de jeter un pont
entre l'expérience et les principes métaphysiques ou a priori de la
nature, mais ce passage de l'a priori à l'empirique devra s'opérer selon
1. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 2; tr. fr. Oeuvres philosophiques,
Paris, Pléiade, t. I, 1980, 758. Les références à la K.d.r.V. se feront suivant la
1. Cf. H.-G. Gadamer, «Kants 'Kritik der reinen Vernunft' nach 200 Jahren. pagination originale des éditions de 1781 (A) et de 1787 (B). Toutes les autres
'Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus' » (1981), in références aux oeuvres de Kant donneront la pagination de l'édition de l'académie
H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke, Bd. 4, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul (Ak., tome, page). La traduction citée est le plus souvent celle des Oeuvres
Siebeck), 1987, 336-348. philosophiques dans la Bibliothèque de la Pléiade (O., tome, page).
12 INTRODUCTION INTRODUCTION 13
des principes qui sont eux-mêmes a priori 1. L'a priori paraît bel e~ > dogmatisme, selon l'intelligence courante, ou du sommeil 'passager,1
l
bien être la porte d'entrée de tout le système de Kant. où était tombé le dogmatisme selon Kant et auquel sa philosophie
Cependant, deux siècles plus tard, l'a priori représente peut-être transcendantale aurait pour fonction de remédier - en lui découvrant
aussi l'obstacle qui nous en bloque l'accès. Devant le succès des l'abîme de l'a priori.
sciences expérimentales, l'idée d'un savoir a priori apparaît au Depuis Parménide et Platon, la réflexion qu'on appelle philosophie
jourd'hui largement suspecte, sinon insensée. Quoique nous puissions, a toujours aspiré à une connaissance a priori, c'est-à-dire à un savoir
à la limite, concéder un statut a priori à certains principes de la qui ne dépende pas de l'expérience et qui soit, par conséquent,
logique, et peut-être aussi aux mathématiques, force est de reconnaître nécessaire et universel. De Pannép.ide à Wolff, le domaine de l'a priori '
que nous avons perdu le sens de l'a priori. A quelques exceptions près, est celui des vérités immuables et éternelles que peut atteincire le YOÜe;,
la notion d'a priori est tombée en désuétude, ayant cessé d'être une la raison, l'organe divin en flOUS. Le philosophe Kant, comme on sait, a
préoccupation majeure de ceux qui s'adonnent à la philosophie. L'oeil fait ses classes à l'école du rationalisme, dont les vérités essentielles
de l'âme, dont parlait Platon pour décrire l'organe d'une connaissance sont entièrement a priori (le principe de contradiction, celui de raison
\ purement rationnelle, nous fait défaut. Une cécité métaphysique nous déterminante, d'identité, les preuves de l'existence de Dieu et de
empêche d'intuitionner quelque a priori que ce soit. Invisible, l'a l'immortalité de l'âme, etc.). Les controverses internes de la
priori est devenu incrédible, donc obsolète. Peut-être sommes-nous Schulmetaphysik, par exemple la question de savoir si le principe de
plus kantiens que Kant en n'acceptant plus la possibilité d'une intuition raison se laisse dériver du principe de contradiction, présuppose
intellectuelle a priori ou de l'a priori, scepticisme qui emporte bien sûr comme allant de soi la possibilité d'une connaissance a priori. En
l'apriorisme dont Kant se faisait encore le porte-étendard. Notre termes modernes, ou postmodernes, le paradigme de l'a priori
époque est celle du rejet ou de l'oubli de l'a priori. circonscrit l'horizon du rationalisme de Parménide à Wolff,
Ce que cette étude aimerait montrer, c'est que la notion d'a priori! paradigme qui rend impraticable un échange fécond avec la tradition
est moins la porte d'entrée que le problème fondamental du kantisme,! empiriste qui refuse de reconnaître des vérités a priori, même si, tente
celui qui donne naissance au projet inédit d'une critique de la raison d'argumenter le rationalisme, l'empirisme doit les présupposer dès
pure. L'enquête de la première Critique au sujet de la possibilité de la qu'il se met à penser, à faire travailler ses idées. Le paradigme de l'a
métaphysique pose en vérité la question de l'a priori, celle de sa priori est le coussin qui permet au rationalisme de dormir en paix et de
crédibilité. Dans l'oeuvre de 1781, l'a priori se trouve d'une façon ne s'intéresser à l'empirisme que pour le réfuter.
décisive, et pour la première fois sur le terrain de la métaphysique, Dans l'histoire de la pensée occidentale, Kant est le rationaliste qui
reconduit à sa propre problématicité. Avec Kant, l'a priori cherche à dort mal, troublé qu'il est par un cauchemar: et si l'empirisme avait
prendre la mesure de ses capacités dont il soit possible de rendre raison? Avant d'aller plus loin en métaphysique, dit-il, tâchons, au
raison, situation de crise qui suppose qu'avant Kant la réalité de l'a . nom de l' Aufkliirung que veut être le rationalisme, de tirer au clair les
priori, et cela signifie la possibilité d'un savoir purement rationnel, ait 1 fondements et les possibilités réelles de la connaissance a priori. C'est
été radicalement révoquée en doute. Cette étape de la réflexion pour répondre à cette question et relever le défi de Hume que Kant
correspond à l'empirisme, celui de David Hume qui tira Kant d'un institue une propédeutique à la métaphysique et, comme nous le
«sommeil dogmatique» - qu'il s'agisse du sommeil qu'est le verrons, à la philosophie transcendantale, la Critique de la raison pure.
Son seul et unique propos est de soup~.ser les cliances d'un savoir a
priori. Avant de se bercer de connaissances soi-disant métaphysiques,
voyons si, où et quand la connaissance a priori est possible, c'est-à-dire
1. Ak., XXI, 15; XXII, 244,468 et passim; tr. fr. Opus postumum, Paris, légitime et légitimable.
P.U.F., coll. Epiméthée, 1986, respectivement 201, 41, 95. On ne se surprendra
pas d'y lire que l'existence de l'éther doive être elle-même «reconnue et postulée a
priori», «comme une pièce appartenant nécessairement au passage des principes 1. Pour cette lecture, cf. M. Clavel, Critique de Kant, Paris, Flammarion,
métaphysiques de la science de la nature à la physique» (XXI, 218; tr. fr. 56). 1980, 39.
14 INIRODUCI10N INIRODUCI10N 15
Amenée à s'interroger sur les ressources de l'a priori, la Nous pensons, au contraire, que l'attitude à la fois critique et
philosophie kantienne a, historiquement et, en un sens, contre son gré, sympathique de Kant face à l'a priori est et doit encore être la nôtre.
contri bué, après Hume, à dévaloriser et destituer l'a priori à titre de C'est que la question de l'a priori, telle qu'elle s'est posée à Kant et telle
qucstion philosophique. En posant ouvertement)a question de la qu'elle nous a été léguée par Kant, demeure d'un intérêt vital pour
possibilité de connaissances synthétiques a-priori(za question c~~nale toute réflexion philosophique. Si la notion d'a priori est constitutive de
dc la philosophie critique) afin d'évaluer les perspectives d'un savoir l'entreprise philosophique, c'est parce qu'elle en désigne tantôt l'objet,
autre qu'empirique, Kant a comme mis un tenne, bien malgré hli, à la tantôt la méthode ou la source. Quelle que soit la forme qu'elle
carrière de l'a priori, qui n'a pas su résister à l'irruption de la science emprunte, la recherche a priori détennine en son essence l'inter
purement expérimentale. Il n'est pas douteux que la mise en question rogation philosophique. Il ne sera à coup sûr jamais possible, ni même
de la connaissance a priori s'accompagne déjà chez Kant d'une souhaitable, de trouver une caractérisation du travail philosophique
réhabilitation philosophique de l'expérience comme source de qui satisfasse tous les philosophes et toutes les tendances. Mais si un
connaissance. C'est pourquoi il peut apparaître étrange de voir une consensus très général peut être établi, il gravitera sans doute autour de
philosophie aussi sympathique aux ressources de l'expérience l'idée de la philosophie comprise comme réflexion fondamentale. Pour
(rappelons le mot célèbre des Prolégomènes: «ma place est le fertile la pensée classique, cette conception désignait automatiquement l'objet
hathos de l'expérience»; Ak., IV, 373; O., II, 161), s'encombrer de de la recherche philosophique: la philosophie doit porter sur les
considérations a priori dans à peu près toutes les sphères où elle fondements (du réel, de la connaissance, de l'agir, etc.), les principes,
s'exerce. Kant est-il l'ami ou l'ennemi de l'a priori? Le champion ou les causes premières, en un mot, l'a priori, ce qui est premier,
la némesis de la connaissance par raison pure et, partant, de la antérieur et fondateur de tout le reste. Pour nous, cette idée de la
métaphysique? N'est-il que le point de rencontre de deux tendances philosophie caractérise peut-être moins l'objet que l'élan ou
contradictoires, à la fois partisan et détracteur de l'a priori, un l'accomplissement, existentiellement enraciné, de l'activité philo
métaphysicien doublé d'un positiviste? Il ne serait pas difficile de sophante: la philosophie se comprend aujourd'hui comme la
réunir des textes confirmant l'une et l'autre de ces orientations discipline des questions fondamentales ou réflexion sur les problèmes
fondamentales, platonicienne et humienne. Peut-être n'est-il pas fondamentaux (le langage, la vérité, la praxis, l'epistèmè qui nous
contre-indiqué d'apercevoir dans un autre passage illustre où Kant détennine, etc.). L'approche et le thème de la réflexion varient selon
avoue qu' «on reviendra toujours à la métaphysique comme à la bien les écoles, mais chaque philosophie élève la prétention d'être une
aimée avec laquelle on s'était brouillé» 1 une espèce de confession, le méditation fondamentale. La réflexion sur le langage, l'être social ou
témoignage d'une scission (le texte parle~bien d'une «mit uns la volonté de puissancel par exemple, devien!-p-hilosophique dès
,
entzweiten Geliebten») dans la pensée de Kant lui-même. Nos l'instant où elle s'impose comme incontournable\k,'interrogation sur,l
réflexions auront à étudier et à éclairer l'ambiguïté qui subsiste sur l'être social peut paisiblement relever de la sociologie comme celle sur'
cette question, essentielle entre toutes. le langage de la linguistique si ces dimensions ne sont envisagées que
Mais, demandera-t-on enfin, pourquoi revenir sur cette ambiguïté, comme des aspects de la réalité qui cohabitent avec d'autres, sans se
surtravaillée sans doute et très certainement inactuelle? La relation déclarer plus fondamentales. Mais dès que le sociologue entreprend de
d'amour-haine que semble entretenir Kant avec l'a priori, la
métaphysique et la raison pure en général ne se situe-t-elle pas à mille
lieues des problèmes et du discours de la philosophie contemporaine?
1. Même Nietzsche dit posséder, au début de l'un de ses traités les plus
systématiques, «s'on 'a priori'» (La généalogie de la morale, préface, § 3). Son 'a
priori', il le localise, fort adéquatement, dans sa Bedenklichkeit vis-à-vis de tout ce
1. A 850 = B 878; O., l, 1397. Cf. aussi le passage des Rêves d'un qui est moral. Mais le concept d'a priori, qu'il déconstruit partout ailleurs, est, non
visionnaire où il est question de «la métaphysique, dont le destin fait que je suis moins rigoureusement, mis entre guillemets. C'est que Nietzsche ne croit plus tout
amoureux bien que je puisse rarement me vanter de ses faveurs» (Ak., II,367; O., à fait à la réflexion fondamentale, lors même qu'il la pratique. Ce paradoxe est
l, 585). . essentiel à sa philosophie, comme à plusieurs autres.
/'
l
16 INIRODUCTION INIRODUCTION 17
démontrer que l'homme n'est dans son essence (dôoç, a priori) rien naguère synonyme de philosophie (et c'est pourquoi le titre de
d'autre qu'un rouage de sa classe sociale ou de la lutte des classesl et philosophiae doctor est encore le titre suprême qui soit décerné aux
que cette détermination sociale fonde tout le reste (l'idéologie, l'agir, scientifiques), en transformant la philosophie en (méta-)réflexion sur
la connaissance, la religion), il s'aventure sur le terrain de la réflexion le savoir scientifique. Or la philosophie doit-elle se contenter d'être
philosophique, d'une théorie a priori. Si au vingtième siècle le langage ancilla scientiae, simple Wissenschaftstheorie? On voit bien qu'une
est devenu un objet privilégié de la philosophie, c'est simplement parce telle métathéorie continue à sa façon d'élever une prétention a priori
qu'il a été perçu comme l'élément fondamental de notre expérience, en ce qu'elle réfléchit sur ce qu'il y a de 'fondamental' ou d'essentiel en
celui qui ouvre et conditionne tous les autres. La définition minimale science. Est-ce la seule forme d'apriorité qui reste à la disposition de la
de la philosophie comme interrogation fondamentale, bien que son philosophie?
questionnement puisse et doive aujourd'hui s'armer de modestie et . Le lecteur pourra être agacé de trouver dans cette introduction
d'incertitude, devrait convenir à toute démarche philosophique. autant de questions sans réponse immédiate. Le-but de cette paranèse
C'est ce champ de la réflexion que délimite depuis toujours l'idée était seulement de reconquérir l'enjeu que recèle la question, d'autant
de l'a priori. La prétention qu'élève la philosophie - qu'il s'agisse plus pressante qu'ignorée, de ra priori. La question est ouverte et
d'une prétention à l'universalité, à l'objectivité, à l'absolu ou au impérieuse depuis Kant. Si notre époque peut se dire postkantienne,
fondamental au sens large - n'est pas une prétention empirique, c'est dans la mesure où elle demeure toujours confrontée au statut
même si ses souches ne peuvent être qu'empiriques, la philosophie problématique de ra priori, statut qui a depuis peu gagné le domaine
étant pratiquée par des hommes immergés dans l'expérience et qui ne des croyances et des certitudes du monde vécu, de plus en plus
se hissent dans la tour d'ivoire de la réflexion que pour mieux dédivinisé, donc 'désapriorisé', si on nous passe le barbarisme. La
\ comprendre, ou maîtriser, cette expérience à partir de ce qui à travers désapriorisation du réel ne fait que se refléter en philosophie.
l elle se fait valoir comme fondamental. La philosophie aspire à une Comment et sous quelles conditions un savoir fondamental, a priori,
"ëonnaissance qui doit pouvoir se distinguer d'une quelconque manière est-il encore défendable? Il y va de la légitimité et de l'auto
du savoir particulier qui se déploie dans les sciences spéciales et le compréhension de l'activité philosophique. Il s'agit d'une question que
monde vécu. Si la philosophie cesse d'entretenir une telle prétention - toute philosophie doit affronter, fût-ce pour la déconstruire, mais cela
prétention, du reste, que la philosophie a toujours eu à redéfinir depuis n'est bien sûr possible qu'au nom d'un horizon 'plus fondamental', ce
Parménide -, elle devient un savoir particulier, comme n'importe qui nous ramène encore au point de départ.
quel autre, simple doxa. Mais comment la doxa peut-elle espérer se La prétention au fondamental est non seulement devenue
faire passer pour epistèmè? En vue d'accéder aux 'principes' du problématique, mais aussi plurielle. Les accès qu'offrent les
savoir, de l'action ou de l'être, la quête philosophique doit, tout en philosophies et les idéologies au fondamental sont aujourd'hui
restant consciente de la relativité de ses motivations, revendiquer un multiples, plus que jamais auparavant. Peut-il encore y avoir une
statut non relatif, a priori justement. Seulement, les philosophes sont conception du monde plus élémentaire que les autres? Et si une
loin de s'entendre sur un tel statut, d'aucuns préférant tout bonnement philosophie ou une vision du monde prétend mettre le doigt sur l'a
laisser tomber la question ou n'y voir qu'un problème mal posé. Fort priori par excellence, encore doit-elle nous en convaincre. Comment
bien, mais s'il en est ainsi, qu'est-ce qui permet à la philosophie de est-il possible de fonder une prétention a priori, c'est-à-dire un
s'affirmer toujours comme philosophie? Si toute connaissance est a argument philosophique? Une assurance en vaut n'importe quelle
posteriori, et l'essor de la science moderne pourrait bien le laisser autre, soupire Hegel dans la Phénoménologie. Nul ne peut me disputer
croire, que reste-t-il à la philosophie? Inutile de redire ici que mon sentiment, écrivait quant à lui Kant dans son pamphlet Sur un ton
plusieurs penseurs ont cru pouvoir résister à l'assaut de la science, supérieur nouvellement pris en philosophie. Une théorie de l'a priori
doit donc rendre compte de la question d'un accès possible à de l'a
1. Cf. K. Marx, Das Kapital, Erster Band, Berlin, Dietz, 1962, 16; tr. fr. Le priori. S'il existe, l'a priori est-il connaissable et peut-il justifier ses
capital, Livre premier, Paris, éd. sociales, 1975,20.
18 INIRODUCTION INIRODUCTION 19
propres prétentions? La réponse à cette question doit se trouver, on le bien un procès qu'il instituera afm de tirer au clair la question de l'a
montrera, en quelque 'déduction transcendantale', chargée de priori. Travaillée par cette question fondamentale, la méditation
légitimer l'apriorité effective de l'a priori. Depuis Kant, aucune kantienne en viendra à redéfinir les tâches et les horizons essentiels de
philosophie n'est pensable sans pareille 'déduction'. Toute philosophie la philosophie. L'inquiétude de Kant devant les capacités de l'a priori
doit pouvoir montrer qu'elle a raison. et, ce qui revient au même, de la philosophie devrait nous aider à
L'esprit du temps s'est peut-être résigné au scepticisme et à comprendre la nôtre, le dilemme qu'est aujourd'hui - pour tout le
l'indifférence. Toutes les prétentions a priori sont-elles autant monde, la société, les gouvernements et les philosophes eux-mêmes
d'illusions ou d'idéologies qui se valent? En ce chapitre, la pensée philosophique. Elle nous permettra aussi d'en éclairer l'issue.
l'avertissement de Kant reste actuel: «il est vain, en effet, de vouloir
affecter de l'indifférence à l'égard de telles recherches, dont l'objet ne
peut être indifférent à la nature humaine» (A X; O., 1, 727). La
question de savoir si certaines formes de connaissance et certaines
pratiques sont plus justifiables ou plus fondamentales ne peut nous être
indifférente. La distinction qui sépare le savoir fiable, disons la
science, et le charlatanisme, le juste et l'injuste, nous concerne trop
directement pour faire l'objet d'un simple soupir sceptique.
Si ce livre se penche sur Kant, c'est avant tout parce qu'il a
vraisemblablement été le premier à s'inquiéter de la possibilité de l'a
priori dans un contexte qui connaissait déjà l'indifférentisme
métaphysique et la résorption du savoir rationnel oU' a priori au profit
des savoirs historiques. Kant a donc bien vu ce que la question de l'a
priori avait de crucial pour le destin de la philosophie et sa place dans
l'univers des savoirs. Comme l'a excellemment noté Michel Foucault,
c'est en s'interrogeant sur le droit de l'a priori, ou de la représentation,
. que Kant nous a fait franchir le seuil de la modernitt. Kant a mis un
point d'arrêt à ce que l'on peut appeler avec Foucault l'Age classique,
c'est-à-dire au rationalisme de Descartes à Wolff, en posant la question
des limites de notre représentation, donc en demandant à l'a priori de
quel droit il prétend pouvoir décliner la matrice intellectuelle d'un réel
trop commodément identifié au rationnel. L'événement décisif de la
modernité kantienne réside dans la mise à jour des limites de l'a priori,
imposées par la découverte de la finitude. De cette découverte
dépendent les autres traits de la modernité (dont certains étaient peut
être apparus avant Kant) et parmi lesquels on se contentera de nommer
la mort de Dieu, l'effritement du sens, l'émancipation de l'homme, de
sa science et la démocratie. Mais s'il ne se trouve qu'au seuil de la
modernité, c'est que Kant n'y est pas tout à fait entré. Il mesure trop
l'enjeu de l'a priori pour y renoncer sans autre forme de procès. C'est
1. M. Foucault, Les mots et les cJwses, Paris, Gallimard, 1966,255-6.