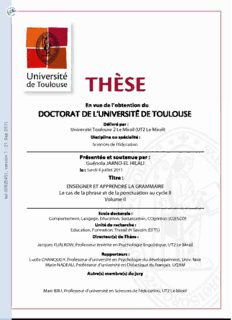Table Of Content1
1
0 ¸†•“»fi›•‹7(cid:204)–«·–«›»(cid:238)(cid:212)»(cid:211)•fi¿•·ł¸(cid:204)(cid:238)(cid:212)»(cid:211)•fi¿•·(cid:247)
2
p
e
S
1 ˝‰•»†‰»›…»·ø(cid:219)…«‰¿‹•–†
2
-
1
n
o
si (cid:217)«7†–·¿ (cid:214)(cid:223)˛(cid:210)(cid:209)(cid:243)(cid:219)(cid:212) (cid:216)(cid:215)(cid:212)(cid:223)(cid:212)(cid:215)
r
e
v ·«†…•(cid:236)¶«•··»‹(cid:238)(cid:240)(cid:239)(cid:239)
,
1
5
4
5
2
6 (cid:219)(cid:210)˝(cid:219)(cid:215)(cid:217)(cid:210)(cid:219)˛(cid:219)(cid:204)(cid:223)——˛(cid:219)(cid:210)(cid:220)˛(cid:219) (cid:212)(cid:223)(cid:217)˛(cid:223)(cid:211)(cid:211)(cid:223)(cid:215)˛(cid:219)
0
0 (cid:212)»‰¿›…»·¿ (cid:176)‚fi¿›»»‹…»·¿ (cid:176)–†‰‹«¿‹•–† ¿«‰§‰·»(cid:215)(cid:215)
-
el
t ˚–·«‡» (cid:215)(cid:215)
(cid:221)–‡(cid:176)–fi‹»‡»†‹(cid:244)(cid:212)¿†„¿„»(cid:244)(cid:219)…«‰¿‹•–†(cid:244)˝–‰•¿·•›¿‹•–†(cid:244)(cid:221)(cid:209)„†•‹•–†ł(cid:221)(cid:212)(cid:219)˝(cid:221)(cid:209)(cid:247)
(cid:219)…«‰¿‹•–†(cid:244)(cid:218)–fi‡¿‹•–†(cid:244)(cid:204)fi¿“¿•·»‹˝¿“–•fi›ł(cid:219)(cid:218)(cid:204)˝(cid:247)
(cid:214)¿‰fl«»›(cid:218)(cid:215)(cid:214)(cid:223)(cid:212)(cid:213)(cid:209)(cid:201)(cid:244)—fi–”»››»«fi7‡7fi•‹»»†—›§‰‚–·–„•»·•†„«•›‹•fl«»(cid:244)¸(cid:204)(cid:238)(cid:212)»(cid:211)•fi¿•·
(cid:212)«‰•·»(cid:221)(cid:216)(cid:223)(cid:210)ˇ¸(cid:209)˙(cid:244)—fi–”»››»«fi…ø«†•“»fi›•‹7»†—›§‰‚–·–„•»…«…7“»·–(cid:176)(cid:176)»‡»†‹(cid:244)¸†•“(cid:242)(cid:210)•‰»
(cid:211)¿fi•»(cid:210)(cid:223)(cid:220)(cid:219)(cid:223)¸(cid:244)—fi–”»››»«fi…ø«†•“»fi›•‹7»†(cid:220)•…¿‰‹•fl«»…«”fi¿†9¿•›(cid:244)¸ˇ(cid:223)(cid:211)
(cid:211)¿fi‰(cid:222)˛¸(cid:244)—fi–”»››»«fi…ø«†•“»fi›•‹7»†˝‰•»†‰»›…»·ø7…«‰¿‹•–†(cid:244)¸(cid:204)(cid:238)(cid:212)»(cid:211)•fi¿•·
TABLE DES MATIERES
ANNEXESI–LESPROGRAMMESOFFICIELS(2002,2007,2008)
Annexe1.1:Hors-sérien°1du14Février2002 .......................................................... 295
1.1.1 Maîtrisedulangageoral..................................................................................... 295
1.1.2 Lecture................................................................................................................ 298
1.1.3 Écriredestextes.................................................................................................. 306
1.1.4 Évaluerlescompétencesacquises ..................................................................... 309
Compétencesdevantêtreacquisesenfindecycle .......................................................... 310
Annexe1.2:B.O.hors-sérieN°5du12Avril2007....................................................... 312
1.2.1 Maîtrisedulangageoral .................................................................................... 312
1.2.2 Lecture ............................................................................................................... 314
1.2.3 Écriredestextes.................................................................................................. 321
1.2.4.Étudedelalangue(Grammaire) .........................................................................323
Connaissances,capacitésetattitudestravailléesetattenduesenfindecycle2............. 326
1
1 Annexe1.3:B.O.hors-sérieN°3du19JUIN2008....................................................... 329
0
2
1.3.1 Langageoral........................................................................................................ 329
p
e 1.3.2 Lecture,écriture.................................................................................................. 329
S
1.3.3 Vocabulaire......................................................................................................... 330
1
2 1.3.4 Grammaire ......................................................................................................... 330
- 1.3.5 Orthographe....................................................................................................... 330
1
Compétence1:Lamaîtrisedelalanguefrançaise ...................................................... 330
n
o
si
r ANNEXESII–L’ANALYSEDESEXERCICESSELECTIONNESPARLESENSEIGNANTS
e
v
1, Annexe2.1:Fichesexercices...................................................................................... 331
5
4
5 Annexe2.2:Entretiens .............................................................................................. 341
2
6
0 Annexe2.3:Grilled'analysedessélections................................................................ 465
0
-
el ANNEXESIII–L’ANALYSEDESMANUELSDELECTURE
t
Annexe3.1:Saisiedesdonnées .......................................................................... CD-Rom
3.1.1 Typedesignesdanslesexercices ................................................................CD-Rom
3.1.2 Typedesignesdanslestextes .....................................................................CD-Rom
3.1.3 Variétédessignesdanslestextes................................................................CD-Rom
Annexe3.2:Traitementsstatistiques ................................................................. CD-Rom
ANNEXESIV–L’ANALYSEDESTESTSD’EVALUATIONRELATIFSALAPHRASE
Annexe4.1:Textessources........................................................................................ 477
4.1.1 LaBrouille........................................................................................................... 477
4.1.2 LeLoupestrevenu!........................................................................................... 479
Annexe4.2:Testsd’évaluation .................................................................................. 481
4.2.1 Prétest................................................................................................................ 481
4.2.2 Post-test ............................................................................................................. 522
I
Tabledesmatières
Annexe4.3:Exercicesprototypes...............................................................................565
4.3.1 Exerciceprototype–Tâche1..............................................................................565
4.3.2 Exerciceprototype–Tâche2..............................................................................566
4.3.3 Exerciceprototype–Tâche3..............................................................................567
4.3.4 Exerciceprototype–Tâche4..............................................................................568
ANNEXESV–L’UTILISATIONDELAPONCTUATIONDANSLESPRODUCTIONS
Annexe5.1:Textessources ........................................................................................569
Annexe5.2:Productionsdesélèves ...........................................................................581
5.2.1 Testd’évaluation:prétest..................................................................................581
5.2.2 Testd’évaluation:post-test................................................................................622
Annexe5.3:Saisieetanalysesstatistiquesdesdonnées.......................................CD-Rom
5.3.1 Saisiedesdonnéesrelativesàlafréquenceettypedesignes.................... CD-Rom
5.3.1.1 Fréquenceettypedesignestest1...................................CD-Rom
5.3.1.2 Fréquenceettypedesignestest2...................................CD-Rom
5.3.1.3 Fréquenceettypedevirgules...........................................CD-Rom
1 5.3.2 Saisiedesdonnéesrelativesauxerreursdansl’utilisationdessignes........ CD-Rom
1
0 5.3.3 Analysesstatistiques .................................................................................. CD-Rom
2
5.3.3.1 Variable1-Fréquence......................................................CD-Rom
p
e 5.3.3.2 Variable2-Typedesignes...............................................CD-Rom
S
5.3.3.3 Variable3-Variation.......................................................CD-Rom
1
2 5.3.3.4 Variable4-Typed’erreurs.................................................CD-Rom
-
1 ANNEXESVI–L’ORTHOGRAPHIEDESMOTSVARIABLES
n
o
si Annexe6.1:Motsbienorthographiés..................................................................CD-Rom
r
e
v 6.1.1Saisiedesdonnées ...................................................................................... CD-Rom
,
1 6.1.1.1 Formesgrammaticalescorrectes:GE..............................CD-Rom
5
4 6.1.1.2 Formesgrammaticalescorrectes:GT..............................CD-Rom
5
2 6.1.1.3 Formesgrammaticalescorrectes:GC..............................CD-Rom
6
0 6.1.2Analysesstatistiques.................................................................................... CD-Rom
0
el- Annexe6.2:Motsmalorthographiés...................................................................CD-Rom
t
6.2.1Saisiedesdonnées....................................................................................... CD-Rom
6.2.1.1 Typesd’erreurs:GE..........................................................CD-Rom
6.2.1.2 Typesd’erreurs:GT..........................................................CD-Rom
6.2.1.3 Typesd’erreurs:GC..........................................................CD-Rom
6.2.2Analysesstatistiques.................................................................................... CD-Rom
6.2.2.1 Accordennombre............................................................CD-Rom
6.2.2.2 Accordsujet/verbe...........................................................CD-Rom
6.2.2.3 Participepasséetinfinitif.................................................CD-Rom
II
Annexes I
Les programmes officiels
Annexe1.1:Hors-sérien°1du14février2002.........................................................................295
Annexe1.2:Hors-sérien°5du12avril2007.............................................................................312
1
1 Annexe1.3:Hors-sérien°3du19juin2008..............................................................................329
0
2
p
e
S
1
2
-
1
n
o
si
r
e
v
,
1
5
4
5
2
6
0
0
-
el
t
AnnexesI–Programmesofficiels(2002,2007,2008)
Annexe 1.1 : B.O. hors-série n° 1 du 14 FEVRIER 2002
PROGRAMME
1.1.1-Maîtrisedulangageoral
La maîtrise du lange oral, principal domaine d'activités de l'école maternelle, doit
êtrel'objetd'autantd'attentiontoutaulongducycledesapprentissagesfondamen-
taux. Elle se renforce dans l'exercice des multiples situations de communication
qui structurent la vie de la classeet celle de l'école,mais aussidans des moments
visantexplicitementledéveloppementetlastructurationdulangagedechacun.
1.1.1.1 Prendre toute sa place dans le réseau des communications
quotidiennes
À l'école élémentaire, une demi-heure par semaine a été inscrite à l'emploi du
temps pour commencer à formaliser les moments de débats qui portent sur la vie
collective (voir "Vivre ensemble"). Il convient de les conduire de manière à ce
1 qu'aucun élève ne soit écarté des échanges, à ce que chacun apprenne à écouter
1 tant les adultes que ses camarades et accepte la conduite du débat qui, pour l'es-
0
2 sentiel, relève encore à cet âge de l'enseignant. Dans la mesure où la principale
p difficulté réside dans la capacité de tenir compte de l'échange en cours pour faire
e
S avancer la réflexion collective, c'est dans cette perspective que le maître doit être
1 particulièrement attentif à guider le groupe. Des débats moins formalisés peuvent
2
avoir lieu dans les séquences d'apprentissages. Ils doivent alors bénéficier du
-
1 mêmeaccompagnement.
n
o
si 1.1.1.2Entrerdansledialoguedidactique
r
e
v
Les dialogues instaurés entre le maître et l'élève tout au long des apprentissages
,
1 sont une autre face importante des communications qui se structurent durant ce
5
4 cycle. L'élève doit apprendre à s'appuyer sur ces échanges pour structurer une
5
2 connaissance incertaine, sortir d'une incompréhension, prendre conscience d'une
6
erreur et la corriger. L'élargissement de l'échange à quelques élèves peut être
0
0 profitable, à condition toutefois de ne jamais perdre de vue que l'essentiel reste de
-
el permettre à chaque élève de restructurer ses représentations et de rectifier les
t
manières de les formuler, grâce aux interactions de celui qui sait, c'est-à-dire du
maître.
1.1.1.3Continuerà apprendreàparlerlalanguefrançaiseet àla com-
prendre
En entrant à l'école élémentaire, les élèves éprouvent encore de nombreuses diffi-
cultés lorsqu'ils tentent d'évoquer un événement que leur interlocuteur ne connaît
pas ou quand ils veulent expliquer un phénomène un peu complexe. D'une ma-
nière générale, dès qu'ils s'aventurent dans une formulation enchaînant plusieurs
énoncés et lorsqu'ils ne sont pas relancés par la parole d'un interlocuteur, ils res-
tentencoresouventmaladroits.Ilenestdemêmelorsqu'ils tententdecomprendre
des formulations orales de ce type. Lorsque ces situations se présentent, c'est en
recourant au dialogue que le maître construit progressivement une meilleure com-
préhensionouunemeilleureexpression.
Permettre des prises de parole plus longues, améliorer la compréhension en de-
horsdessituationsdedialogue
295
B.O.hors-sérien°1du14FEVRIER2002
Pour que chaque élève acquière progressivement une plus grande autonomie
dans ces usages du langage, pour qu'il puisse assumer une prise de parole plus
longue et plus structurée, il est nécessaire de programmer des activités spéci-
fiques prolongeant celles qui étaient mises en place à l'école maternelle. Là en-
core, le rappel d'un événement passé doit être considéré comme prioritaire. Il dé-
bouche sur un usage oral du récit qui s'articule avec la compréhension des textes
entendus.
Faciliter la compréhension des textes narratifs (en situation d'écoute et de "refor-
mulations"alternées)
La découverte d'albums ou d'histoires illustrées peut être, à l'école élémentaire
encore, un moyen privilégié pour y parvenir. L'alternance entre lecture de l'ensei-
gnant, rappel par un ou plusieurs élèves reformulant le texte dans leurs propres
mots, dialogue sur les difficultés, nouvelle lecture de l'enseignant, nouvelle formu-
lation par les élèves (sous la forme d'une dictée à l'adulte, par exemple) est sus-
ceptibled'aiderchacunàsedoterd'uneplusgrandefamiliaritéaveccestextes.On
exige progressivement que l'élève prenne une part plus grande dans cet échange,
de manière à ce qu'il structure mieux ce qu'il souhaite dire et comprenne des
textespluslongsetpluscomplexes.
1
1
0 Faciliter lacompréhension des textes explicatifs (ensituationdedécouvertecollec-
2 tive)
p
e
S Il en est de même pour des formes qui relèvent de l'explication et peuvent débou-
1 cher sur une meilleure compréhension des multiples aspects du documentaire
2
- (film, livre, revue, multimédia...). Au cycle des apprentissages fondamentaux, l'ac-
1 cèsoralàcessourcesd'information,parlesonouparlavoixdumaître,l'appuisur
n les images ou les schémas restent nécessaires. Là encore, production et compré-
o
si hension se complètent : parcours en commun d'un document, dialogue sur les
r
e aspects successifs des éléments d'information, synthèses partielles demandées
v
aux élèves et relancées par le maître, synthèse finale qui peut être là encore obte-
,
1
nueparunedictéeàl'adulte.
5
4
5
2 Articulermaîtrisedulangageoraletmaîtrisedulangageécrit
6
0
0
- D'unemanièregénérale,aucycledesapprentissagesfondamentaux,lesélèvesne
el maîtrisent pas encore suffisamment l'écrit pour pouvoir se poser de véritables
t
"problèmes" de compréhension sur les textes qu'ils lisent. Les manuels d'appren-
tissage de la lecture reflètent cette situation en évitant toute complexité narrative.
Sil'onsouhaitequeledéveloppementdesstratégiesdecompréhensiondestextes
longsetcomplexespuissesepoursuivre-etilestessentielqu'ilensoitainsi-,c'est
donc prioritairement sur des textes dits à haute voix par l'enseignant qu'elles doi-
ventêtreexercées.
1.1.1.4Parlersurdesimages
Les images, sous toutes leurs formes, fixes ou animées, sont fréquemment utili-
sées au moment de l'apprentissage de la lecture comme équivalent du message
écrit que l'enfant ne sait pas encore lire. Ainsi - une leçon de lecture commence
presque toujours par l'exploration d'une image. Cette utilisation repose sur l'idée
que l'imageserait immédiatementdécodablepar l'enfantet queson messagerelè-
veraitdel'évidence.Enfait,iln'enestrien.
Dans le cadre des activités artistiques, les élèves du cycle des apprentissages
fondamentaux commencentàutiliser les images defaçonplus réfléchie.Toutefois,
c'est quotidiennement que des images sont employées dans les différentes activi-
tés de la classe. Il importe que, chaque fois qu'il en est ainsi, ces documents fas-
296
AnnexesI–Programmesofficiels(2002,2007,2008)
sent l'objet d'une discussion patiente afin que le message qu'ils portent soit verba-
lement élaboré. Ce sera l'occasion de confirmer l'identification de nombreux élé-
ments du langage iconographique et, réciproquement, de préciser la signification
des mots qui les désignent, d'expliciter les actions suggérées par les rapproche-
ments des objets ou personnages représentés, de retrouver, chaque fois que cela
sera possible, les correspondances suggérées avec d'autres images déjà rencon-
trées, de s'engager dans une interprétation simple du point de vue adopté par le
photographe,ledessinateuroulecinéaste.
Toutefois, on ne s'enfermera jamais dans un décodage formel des images. Il s'agit
simplementdes'assurer queles élèves parviennentà construireunsoclecommun
decompréhensionetqu'ils sontsusceptibles de passer sans difficulté de l'élabora-
tiondecettesignificationàsaverbalisation.
1.1.1.5Structureretaugmenterlevocabulairedisponible
À partir de six ans, les enfants deviennent de plus en plus attentifs aux mots nou-
veaux qu'ils découvrent dans les discours d'autrui ou à l'occasion des lectures
qu'ils écoutent. Grâce à leurs interventions, les adultes permettent d'ajouter préci-
sion et rigueur au réemploi plus ou moins spontané des mots ainsi rencontrés.
1 Dans cette perspective, les discussions sur la compréhension des textes jouent
1
0 encoreunrôleessentiel.
2
p
e L'attention à la construction des mots permet d'accroître plus rapidement le voca-
S bulaire disponible dans la mesure où chaque élément nouvellement acquis ouvre
1 la possibilité de comprendre et de produire ceux que l'on peut dériver à partir de
2
- lui. La manipulation ludique des nombreux préfixes et suffixes de la langue ouvre
1 la voie à des "inventions" de mots dont il appartient au maître de dire ensuite si
n elles sont licites ou non.Là encore, ilnes'agit pas de s'engager dans une descrip-
o
si tionformelledulexiquemaisdejoueravecluietdedévelopperainsileplaisirdela
r
e langue.
v
,
1
5 1.1.1.6Diredestextes
4
5
2 Parmi les nombreux textes, en prose ou en vers, que l'élève de cycle 2 découvre
6
0 par la voix de son enseignant, il s'en trouve souvent qui, du fait de l'intérêt qu'ils
0
- ont suscité et de leurs qualités littéraires, méritent d'être appris par cœur. Cette
el mémorisation intervient au terme d'un travail qui a permis de comprendre le texte
t
et d'en discuter les significations possibles. L'apprentissage se fait en classe,
comme à l'école maternelle, c'est-à-dire collectivement. La préparation de l'inter-
prétation suppose un débat, des essais, des jugements, des prises de décisions...
Ilest préférableà cetâge deprivilégier les interprétations collectives plutôt queles
interprétations individuelles (voir "Éducation musicale"). Le théâtre peut offrir l'oc-
casion d'un projet plus élaboré.Ilpeut en être demêmeavec des assemblages de
textes en prose ou en vers. La poésie doit toutefois garder au cycle 2 une place
aussicentralequ'àl'écolematernelle.
La lecture à haute voix est un autre aspect de la diction des textes. Elle intervient,
dèsquelalectureestsuffisammentassuréeetsupposeuntravailtrèssemblableà
celui qui est fait avec des textes appris par cœur. Dans ce cas, le texte doit aussi
être en partie mémorisé et la lecture n'intervient que comme support de la mé-
moire.
Il est important de ne pas confondre ce travail d'interprétation d'un texte à l'inten-
tion d'un auditoire avec la lecture à voix haute qui accompagne la plupart des acti-
vités d'alphabétisation du cycle des apprentissages fondamentaux. Dans ce der-
nier cas, l'objectif est seulement de parvenir à rétablir l'accentuation des groupes
297
B.O.hors-sérien°1du14FEVRIER2002
de mots (en français, l'accent porte sur la dernière syllabe du groupe) ainsi que la
courbeintonativenormaledelaphrasepourenretrouverlasignification.
1.1.2–Lecture
Apprendre à lire, c'est apprendre à mettre en jeu en même temps deux activités
très différentes :cellequiconduit à identifier des mots écrits,celle quiconduità en
comprendrelasignification dans lecontexte verbal (textes) etnon verbal(supports
des textes, situation de communication) qui est le leur. La première activité, seule,
est spécifique de la lecture. La seconde n'est pas très dissemblable de celle qui
porte sur le langage oral, même si les conditions de communication à l'écrit diffè-
rent (absence d'interlocuteur, permanence du message) et si la langue écrite com-
porte des spécificités de syntaxe, de lexique ou textuelles, assez rarement pré-
sentesàl'oral.
Chez le lecteur confirmé, les deux activités sont presque simultanées. La première
s'estautomatisée, libéranttoutes les ressources intellectuelles pour laseconde qui
peut alors bénéficier d'une attention soutenue. Chez le lecteur débutant, l'identifi-
cation des mots est encore peu efficace, elle est souvent trop lente pour que la
mémoire conserve tous les mots reconnus jusqu'à la fin de l'énoncé. La compré-
1 hension reste difficile et doit être fortement soutenue, en particulier lorsqu'on
1
aborde des textes longs ou complexes. Toutefois, ce n'est qu'en rendant plus effi-
0
2 cace l'identification des mots que l'apprenti lecteur parvient en fin de cycle à une
p premièreautonomie.
e
S
1 L'un et l'autre aspect de la lecture doit être enseigné. Cela suppose une program-
2
mation précise des activités tout au long du cycle. La plupart des "méthodes" de
-
1 lecture proposent aujourd'hui des programmes de travail équilibrés. L'appui sur un
n manuel scolaire de qualité se révèle un gage de succès important dans cet ensei-
o
si gnementdélicat,enparticulierpourlesenseignantsdébutantdanscecycle.Toute-
r
e fois, ce manuel ne peut, en aucun cas, être le seul livre rencontré par les élèves.
v
Lafréquentationparallèledelalittératuredejeunesse,facilitéepardenombreuses
,
1 lecturesàhautevoixdesenseignants,esttoutaussinécessaireetdemeureleseul
5
4 moyendetravaillerlacompréhensiondestextescomplexes.
5
2
6
0 1.1.2.1 Avoircomprisleprincipequigouvernelecodagealphabétique
0 desmots
-
el
t
Pour identifier des mots, l'apprenti lecteur doit avoir compris le principe qui gou-
verne le codage de la langue écrite en français : les lettres ou groupes de lettres
(graphèmes)représententleplussouventdesunitésdistinctivesdelalangueorale
(phonèmes) assemblées en syllabes. L'enfant construit progressivement ce savoir
dès l'école maternelle (voir le chapitre "Le langage au cœur des apprentissages"
dans le programme de l'école maternelle) mais n'a pas encore pleinement compris
lacomplexitédeceprincipeàl'entréedel'écoleélémentaire.
Il importe donc que l'enseignant évalue ses élèves dans ce domaine avant même
de commencer l'enseignement de la lecture. On peut, par exemple, poser
un"problème" d'écriture (si l'on souhaite écrire tel mot, comment fait-on ?) en com-
plexifiant progressivement la tâche et en observant la manière dont travaillent les
élèves : capacité ou non d'entendre les éléments phonologiques qui constituent le
mot, capacité de proposer un signe graphique pour une unité phonologique, con-
naissancedunomdeslettresetdeleur(s)valeur(s)...
D'une manière générale pour tous les élèves et d'une manière différenciée pour
tous ceux qui sont encore loin d'avoir compris le principe alphabétique, un pro-
grammedetravaildoitêtremisenplacepour:
298
AnnexesI–Programmesofficiels(2002,2007,2008)
- améliorer la reconnaissance des unités distinctives composant les mots : syllabe,
attaque du mot (consonne(s) précédant la voyelle), rime (voyelle et consonne(s)
suivantlavoyelle),progressivementphonème
- renforcer le répertoire des mots orthographiquement connus permettant de cons-
truire l'écriture phonétiquement correcte d'un mot nouveau ; savoir en analyser les
composantes sonores (syllabes et, en partie, phonèmes), les écrire et les épeler ;
pouvoirrapprocherdesmotsnouveauxdecesmotsrepères;
- multiplier les exercices de "résolution de problèmes orthographiques" (comment
pourrait-on écrire tel ou tel mot ?) conduisant à utiliser efficacement les deux pre-
mièrescompétences.
1.1.2.2 Savoir segmenter les énoncés écrits et oraux jusqu'à leurs
constituantslesplussimples
Parallèlementautravailportantsur leprincipeducodagealphabétiquedes mots,il
est décisif que les élèves bénéficient d'un enseignement ordonné et structuré leur
permettantdeprogresserrapidementdansl'identificationdesmots.
1
1
0 Segmentationdutexteenmots
2
p
e Àl'écolematernelle,lapremièreapprocheducodeécritporteplussouventsur des
S
mots que sur des textes. À l'école élémentaire, ce sont des textes qui très vite de-
1
2 viennent les supports privilégiés du travail de lecture, et l'élève doit apprendre à
- identifier les mots qui les composent. Or le mot n'est pas une réalité évidente du
1
langage oral, elle ne s'impose qu'à celui qui sait lire et écrire. Il importe donc, dès
n
o les premières semaines d'enseignement de la lecture, de renforcer l'articulation
si entre mots écrits (unités graphiques séparées par des blancs) et unités corres-
r
e
pondantes de la chaîne orale. Par exemple, l'enseignant peut montrer de la main
v
, les mots d'un texte qu'il lit à haute voix. C'est la première étape du travail de seg-
1
5 mentation,phaseimportantedel'apprentissagedelalecture.
4
5
2
Segmentationdesmotsensyllabesetphonèmes
6
0
0
- La segmentation des énoncés se poursuit au niveau du mot lui-même en accen-
el
t tuant le travail d'analyse des unités distinctives. À l'école maternelle et en début
d'école élémentaire, il relève pour l'essentiel de jeux. Il faut que, à l'école élémen-
taire, la capacité d'analyse devienne plus sûre et plus précise. C'est dans cette
perspective qu'il convient de multiplier les exercices permettant de catégoriser les
unités sonores de différents niveaux, par l'élaboration de règles de tri, la mise en
œuvredeclassements,larecherched'éléments nouveaux pouvant entrer dans les
classesproposées...Demême,ilestimportantd'entraînerlesélèvesàtransformer
des mots en jouant sur leurs composants : segmentation, dénombrement des uni-
tés, modification du mot par raccourcissement, allongement, inversion (des syl-
labes, puis des phonèmes). L'analyse phonologique stricte semble être au moins
autant la conséquence que la cause de l'apprentissage de la lecture. Elle ne peut
doncêtreunpréalableexigible.
299
B.O.hors-sérien°1du14FEVRIER2002
1.1.2.3Deuxmanièresd'identifierlesmots
Pour identifier un mot, le lecteur doit relier une information visuelle (le mot écrit) à
unsavoirdéjàacquisdufaitdel'apprentissagedelaparole:l'imageacoustiquede
cemot(lareprésentationdes phonèmes quileconstituent) etsa(ouses) significa-
tion(s).Deuxmanières de parvenir àcerésultatsont disponibles :lavoiedirecteet
la voie indirecte. L'apprenti lecteur doit apprendre à se servir efficacement de l'une
etdel'autre.Ellesseconsolidentmutuellementparleurutilisationfréquenteetsont
renforcéespartouteslesactivitésd'écriture.
Identificationdesmotsparlavoiedirecte(lecturecourante)
Ce type d'identification est possible si le lecteur dispose déjà, dans sa mémoire,
d'une image orthographique du mot. Dans ce cas,le mot estquasi instantanément
reconnu, à la fois visuellement, auditivement et sémantiquement. On sait aujour-
d'hui que le lecteur ne s'appuie pas sur la silhouette du mot pour l'identifier, mais
surlaperceptiontrèsrapidedeslettresquilecomposent.
Identificationdesmotsparlavoieindirecte(déchiffrage)
1 On peut aussi retrouver un mot dont on n'a pas mémorisé l'image orthographique
1
0 en recourant à la voie indirecte, c'est-à-dire à son déchiffrage. Dans ce cas, les
2 lettres sont assemblées pour constituer des syllabes prononçables, le mot est pro-
p
e noncé et comparé aux mots proches dont on a déjà l'image auditive dans la mé-
S moire. Les écarts importants qui exigent en français entre syllabe écrite et syllabe
1 oralerendentsouventcetteidentificationdélicate.
2
-
1 1.1.2.4Apprendreàidentifierlesmotsparlavoieindirecte(déchiffrer)
n
o
si Pour pouvoir identifier les mots par la voie indirecte, les élèves de l'école élémen-
r
e taire, qui ont commencé à comprendre la manière dont fonctionne le code alpha-
v
bétique, doivent aussi mémoriser les relations entre graphèmes et phonèmes et
,
1
5 apprendreàlesutiliser.
4
5
2 Laplupartdes méthodes proposentdeux types d'abordcomplémentaires ;analyse
6
0 de mots entiers en unités plus petites référées à des connaissances déjà acquises
0
- ;synthèse,àpartir deleurs constituants,desyllabes oudemots réels ouinventés.
el Lesdeuxtypesd'activitéssonttravaillésenrelationavecdenombreusessituations
t
d'écriturepermettantderenforcerlamiseenmémoiredecesrelations.
Analysedumatérielgraphiqueetsynthèsedesunitésidentifiées
Dans le premier cas, chaque mot présenté est analysé par analogie avec les mots
repères(dans"manteau",jevoisle"man"de"maman",le"t"de"table",le"eau"de
"beau"). Chaque unité graphique repérée, quelle que soit sa taille, peut être écrite
ouépeléeetaunevaleurphonétiquenonambiguë(jeprononce[mã],[tø]ou[o]).
Dans un deuxième temps, le matériel sonore ainsi retrouvé doit être rassemblé,
syllabe après syllabe, pour constituer un mot renvoyant à une image acoustique
disponible dans la mémoire de l'élève. La principale difficulté réside dans l'assem-
blage de la syllabe à partir des phonèmes qui la constituent : le passage de [tø] et
[o] à [to] est difficile à découvrir sans guidage et nécessite le plus souvent que
l'équivalencesoitapprise.
D'oùlanécessitéd'exercer lesélèvesàladémarchedesynthèsepar lamémorisa-
tion des principaux assemblages syllabiques entre voyelles et consonnes dans les
différentes combinaisons possibles. C'est par l'écriture, plus encore que par la
300
Description:ENSEIGNER ET APPRENDRE LA GRAMMAIRE. Le cas de la phrase et de la ponctuation au cycle II. Wolume II lundi 4 juillet 2011. GuÎnola JARNO.