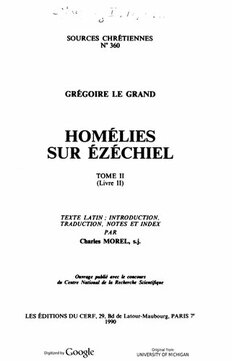Table Of ContentSOURCES CHRÉTIENNES
N* 360
GRÉGOIRE LE GRAND
HOMÉLIES
SUR ÉZÉCHIEL
TOME II
(Livre II)
TEXTE LATIN ; INTRODUCTION,
TRADUCTION, NOTES ET INDEX
PAR
Charles MOREL, s.j.
Ouvrage publié avec le concours
du Centre National de la Recherche Scientifique
LES ÉDITIONS DU CERF, 29, Bd de Latour-Maubourg, PARIS T
1990
La publication 4c cet ouvrage a été préparée arec le concours
de Vlnstitut des a Sources Chrétiennes »
(U.R.A. 993 du Centre National de la Recherche Scientifique)
IMPRIMI POTEST IMPRIMATUR
Paris, 3 novembre 1989 Lyon, 10 novembre 1989
Jacques Gellard, s.j. Jean Alberti, p.s.s.
Provincial de France par délég. du Card. A. Decourtray
© Les Éditions du Cerf, 1990
ISBN : 0-204-04116-5
ISSN : 0750-1978
1. Œuvres de Grégoire
Dial, Dialogi (Mil = SC 260 ; IV = SC 265).
Ep. Registrum Epistolarum (CCL 140-140 A).
H Eu, Homiliae in Euangelia (PL 76, 1075-1322).
Hom, Homiliae in Hiezechielem prophetam (CCL 142).
Hom. I renvoie aux Homélies du Livre I (SC 327).
Hom. II (ou Hom. quand il n'y a pas d'ambiguïté) renvoie
aux Homélies du Livre II (SC 360).
Mor. Moralia in Job (I-XXXV = PL 75, 509-1162 ; 76,
9-782 = CCL 143 ; 143 A ; 143 B. I-II = SC 32 bis ;
XI-XIV = SC 212 ; XV-XVI = SC 221).
Past. Regula pastoralis (PL 77, 13-128).
2. Autres ouvrages
BA Bibliothèque Augustinienne, Desclée de Brouwer.
BJ La Bible de Jérusalem, Paris 1973.
CCL Corpus Christianorum, Series Latina, Tumhout.
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum,
Vienne.
CUF Collection des Universités de France, Paris.
DACL Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Litur
gie, Paris.
Dagens Cl. Dagens, Saint Grégoire le Grand. Culture et
expérience chrétiennes, Paris 1977.
DBS Dictionnaire de la Bible, Supplément, Paris.
DS Dictionnaire de Spiritualité, Paris.
Gillet R. Gillet, art. « Grégoire le Grand », DS 6, 1967,
c. 872-910.
MD La Maison-Dieu, Paris.
PL Patrologia Latina, Paris.
RAC Reallexikon für Antike und Christentum, Stuttgart.
RAM Revue d’Ascétique et de Mystique, Toulouse-Paris.
RHSp Revue d’Histoire de la Spiritualité, Paris.
RSR Recherches de Science Religieuse, Paris.
SC Sources Chrétiennes, Paris.
TLL Thesaurus Linguae Latinae, Leipzig.
Traductions :
Les Homélies de S. Grégoire Pape, sur Ézéchiel, trad. par Pierre
Le Clerc, Paris 1747, Livre I (seul paru).
Gregorio Magno, Omette su Ezechiele, trad. E. Gandolfo,
t. 1-2, Rome 1979-1980.
Obras de San Gregorio Magno, trad. Gallardo, Madrid 1958.
Consulter en premier lieu :
Cl. Dagens, Saint Grégoire le Grand. Culture et expérience
chrétiennes, Paris 1977. (Sur ce livre, voir J. Fontaine,
« L'expérience spirituelle chez Grégoire le Grand. Réflexions
sur une thèse récente », RHSp 52, 1976, p. 141-153).
R. Gillet, art. «Grégoire le Grand », DS 6, 1967, c. 872-910.
Ces deux travaux comportent une abondante bibliographie.
En outre, chaque année, les livres et articles concernant Gré
goire sont signalés dans VAnnée philologique.
Voir aussi :
C. Butler, Western mysticism. The teaching of SS Augustine,
Gregory and Bernard on the contemplation and the contem
plative life, Londres 19272.
P. Catry, « Désir et amour de Dieu chez S. Grégoire le
Grand », Recherches Augustiniennes 10, 1975, p. 269-303.
—, « L’amour du prochain chez S. Grégoire le Grand », Studia
Monastica 20, 1978, p. 287-344.
—, Parole de Dieu, Amour et Esprit-Saint chez Grégoire le
Grand, Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges 1984.
Coll. Grégoire le Grand = Grégoire le Grand. Actes du Colloque
de Chantilly ( 15-19 septembre 1982) publiés par J. Fontaine,
R. Gillet et S. Pellistrandi, Paris 1986.
J. Leclercq, L'amour des lettres et le désir de Dieu, Paris 1957
(en particulier p. 30-39 : Grégoire docteur du désir).
H. de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l'Écriture,
t. 1-4, Paris 1959-1964 (en particulier, t. 1, p. 187-197 : Gré
goire, Cassien, Eucher ; t. 2, p. 537-549 : le Moyen Age gré
gorien ; t. 3, p. 328-339 : Hugues de S. Victor et Grégoire).
H.-I. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique, I-
II, Paris 1938 (+ Retractatio, Paris 1949).
—, « S. Grégoire le Grand », La Vie spirituelle 69, 1943, p. 442-
455.
W. Neuss, Dos Buch Ezechiel in Théologie und Kunst bis zum
Ende des XII Jahrhunderts, Münster 1912.
V. Paronetto, Gregorio Magno. Un maestro aile origini cris-
tiane d'Europa, Rome 1985.
V. Recchia, Le Omelie di Gregorio Magno su Ezechiele (I-V),
Bari 1974 (Bibliographie).
P. Richê, Éducation et culture dans l'Occident barbare ( VF-
Vlir siècles), Paris 1962, p. 187-200.
Voir encore les Introductions aux volumes de la collection
SC consacrés à Grégoire :
A. Bocognano, Introduction aux Morales sur Job XI-XIV (SC
212), Paris 1974, p. 7-32.
R. Gillet, Introduction aux Morales sur Job LII (SC 32 bis),
Paris 1975, p. 7-109.
A. de Vogüé, Introduction aux Dialogues, t. 1 (SC 251), Paris
1978, p. 25-191.
—, Introduction au Commentaire sur le premier livre des Rois
(SC 351), Paris 1989, p. 17-136.
R. Bélanger, Introduction au Commentaire sur le Cantique
des cantiques (SC 314), Paris 1984, p. 11-62.
Sur la langue, voir parmi les travaux récents :
A. Bastiaensen, « Déclin et essor des lettres latines : le latin
de l’Antiquité au Moyen Age (en néerlandais avec un résumé
en français) », Lampas 10, 1977, p. 194-234.
Thesaurus Sancti Gregorii Magni, curante Cetedoc, Tumhout
1986.
Les œuvres de Jean de la Croix et de Thérèse d’Avila sont
citées d’après :
Jean de la Croix, Œuvres spirituelles. Traduction du
R.P. Grégoire de Saint Joseph, carme déchaussé, Paris 1954.
Thérèse D’Avila, Œuvres complètes. Traduction du
R.P. Grégoire de Saint Joseph, carme déchaussé, Paris 1954.
INTRODUCTION
1. Choix du sujet
Renonçant à faire un commentaire suivi du Livre
d’Ézéchiel, dont il avait tout juste abordé le chapitre 4,
Grégoire passe ici brusquement au chapitre 40, celui où
le prophète, navré comme ses compagnons d’exil de
savoir détruit le temple de Jérusalem, commence à décrire
un nouveau temple, beaucoup plus beau, que l’Esprit de
Dieu lui fait contempler dans un avenir glorieux. La
préface de Grégoire nous dit pourquoi il change ainsi
son plan : les soucis que lui cause l’invasion lombarde1
le contraignent d’abréger, mais ses auditeurs, après l’avoir
entendu expliquer la vision initiale d’Ézéchiel, le pressent
de leur expliquer encore la dernière. Il devra leur déclarer
dans l’émouvante page finale de ce Livre II qu’avant
même d’avoir achevé le commentaire d’un chapitre, il est
obligé de s’arrêter définitivement, les circonstances exté
rieures s’étant aggravées.
On comprend le désir des auditeurs, et l’on comprend
que Grégoire se soit laissé persuader, malgré les obscu
rités du texte. Le thème du Temple, lieu de la rencontre
de Dieu avec son peuple, est un des thèmes majeurs de
1. Voir Introd. I, p. 8. Les faits sont clairement et brièvement pré
sentés par V. Paronetto, Gregorio Magno, p. 109-118. Voir aussi
J. Fontaine, « Un fondateur de l'Europe. Grégoire le Grand (590-
604) », Helmantica 34, 1983, p. 171-189.
l’Ancien Testament et du Nouveau. L’Apocalypse re
prendra certaines des expressions d’Ézéchiel en décrivant
la Jérusalem céleste dans ses pages finales, qui sont aussi
les pages finales de toute l’Écriture, et comme la conclu
sion de la longue histoire commencée au premier chapitre
de la Genèse '.
2. Difficultés du sujet
La vision du Temple est grandiose ; reste qu’elle est
difficile. La description est faite du point de vue du
visiteur, qui découvre peu à peu les diverses parties de
la construction, mais a peine à s’en faire une idée d’en
semble avant d’avoir pu synthétiser ses observations. Le
guide, géomètre et arpenteur, multiplie les mesures
chiffrées de longueurs, de largeurs, d’épaisseurs, et il faut
un effort pour imaginer les éléments mesurés et apprécier
les proportions. Surtout Grégoire lisait une traduction
latine parfois ambiguë, faite sur un texte original hé
braïque souvent altéré, sans avoir les moyens d’y appor
ter les corrections souhaitables. Il faut l’avouer : lorsqu’il
s’efforce d’élucider le sens littéral du texte tel qu’il le lit,
il s’embarrasse parfois, complique inutilement, et devient
franchement ennuyeux. On aurait tort de s’attarder à ces
pages. On trouvera plus loin (p. 28-32), si on le désire,1
1. Voir Y. Congar, Le mystère du Temple, Paris 1958. Dans le
Temple habite la gloire de Dieu. La vision initiale d’Ézéchiel montrait
que cette gloire n’était pas attachée au temple matériel édifié par
Salomon et qui venait d’être détruit : mobile, elle était capable de
rejoindre les exilés en Babylonie, elle peut aller partout sur la terre.
C’est parce que le Temple avait été souillé (Éz. 8, 3) que cette gloire
avait dû le quitter (Éz. 10, 18-19; 11, 22-23). Au ch. 43, le prophète
contemplera, pour la consolation des déportés, la gloire revenant dans
le Temple nouveau. Ce thème avait été abordé dans Hom.l, 11, 26
(cf. 1.1, p. 484, n. 2).
un plan du Temple et des explications visant à donner
une idée plus précise, encore qu’approximative, de sa
configuration. Mais ces explications ne sont pas indis
pensables.
3. Importance des images
Il suffit, semble-t-il, de lire le texte avec Grégoire verset
par verset, et de voir ce qui se présente successivement
à son regard, sous la conduite du prophète et de son
guide : cette image, il prend d’abord le temps de la
contempler, de l’admirer, et c’est alors qu’elle exerce son
pouvoir de suggestion, éveille en lui le sens de l’invisible.
Une haute montagne, les horizons du Midi, de l’Aquilon,
de l’Orient un vestibule débouchant sur un vaste parvis,
tout cela est évocateur. Des pierres carrées exactement
taillées et ajustées, une porte qui, ouverte dans une
enceinte infranchissable, accueille, contrôle, invite à pas
ser vers un dedans inconnu, une voûte avec sa clef, un
dallage régulier, des palmes sculptées sur de hauts pi
lastres, tout cela est soigné, tout cela est beau et mérite
l’attention, tout cela parle à qui sait voir. Un rayon de
lumière filtrant obliquement par la fente d’une étroite
fenêtre et s’irradiant dans l’embrasure, l’entrée close de
secrètes « chambres à trésors », attirent vers un au-delà
mystérieux. Il n’est pas jusqu’aux nombres qui n’aient
leur langage, lorsqu’on en dispose les unités de façon à
former une figure dont l’œil saisit d’emblée l’harmonie et
1. Orient, Midi et Aquilon : nous écrivons avec une majuscule,
comme dans le texte latin du CCL, parce que ce ne sont pas pour
Grégoire de simples points cardinaux. L'Orient évoque la lumière du
Christ se levant sur un monde enténébré ; le Midi, la chaleur vivifiante
de l’Esprit-Saint ; nous gardons « Aquilon » plutôt que « Nord », car il
s'agit du pays balayé par le vent glacial, symbole de l'esprit du mal.
le pouvoir évocateur ; respectueux des moindres détails
du texte sacré, Grégoire s’applique à en déchiffrer le
sens *.
L’image présentée par le texte est un point de départ
pour une échappée vers le monde spirituel. Grégoire
découvre ou établit entre la donnée visible et la réalité
invisible une correspondance telle qu’il suffira d’un regard
sur l’une pour que soit évoquée l’autre ; le spirituel sera
lu dans le sensible. Au cours du développement, l’image
du début en appelle d’autres par association de ressem
blance. Il arrive que les perspectives s’élargissent, comme
nous l’avons constaté au Livre 11 2. Plus humblement, ce
sont des images d’objets familiers qui souvent viennent
à l’esprit de l’orateur au fil du discours : il est heureux
de s’en servir pour reposer l’attention de ses auditeurs,
les détendre, en tirer un enseignement qui sera retenu de
ce fait plus aisément. Il évoquera ainsi l’étincelle qui
jaillit du silex (10, 1), les fleurs et les pommes du Can
tique (3, 9), la robe mouchetée du léopard (4, 3), le roseau
et le jonc(l, 11), la boue et la cire (5, 10), la main qui
mesure par l’écart de ses doigts (9, 13), l’agneau et le
loup (4,3), l’écarlate deux fois teinte (4,3), l’éme
raude (6, 3) et l’hyacinthe (7, 4), les mille boucliers de la
tour de David (3,25), l’onguent qu’applique le méde
cin (6, 13)... Il aime aussi reprendre au hasard des rémi
1. Par exemple, dans ce Livre II, pour les nombres 5 et 25 : Hom.,
5, 5-7 ; 8, 11 (avec les notes) ; pour 6, 60 et 100 : Hom., 5, 12 ; pour
10 et 30 : Hom., 6, 5 ; pour 10 et 100 : Hom., 6, 16 ; pour 13 : Hom.,
4, 9 ; pour 50 : Hom., 7, 4 ; pour 100 : Hom., 7, 11. On pourra consulter
sur ce sujet G. Cremascoli, « Le symbolisme des nombres dans les
œuvres de Grégoire le Grand », dans Coll. Grégoire le Grand, p. 445-
454.
2. Introd. I, p. 21-22. Exemple dans ce Livre II : Hom., 1, 14-17 ; 4,
14-16 (avec les notes).