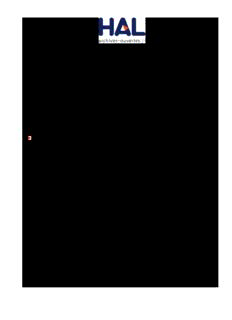Table Of ContentÉtude des neutrinos de réacteur: mise en place et
caractérisation du détecteur Nucifer
Jonathan Gaffiot
To cite this version:
Jonathan Gaffiot. Étude des neutrinos de réacteur: mise en place et caractérisation du détecteur Nu-
cifer. Autre[cond-mat.other]. UniversitéParisSud-ParisXI,2012. Français. NNT:2012PA112286.
tel-00770675
HAL Id: tel-00770675
https://theses.hal.science/tel-00770675
Submitted on 7 Jan 2013
HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents
entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de
teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires
abroad, or from public or private research centers. publics ou privés.
CEA / Irfu - Service de Physique Nucléaire
THÈSE de DOCTORAT
de l’université Paris-Sud
École Doctorale MIPEGE
Discipline : Physique des Neutrinos
présentée
par
Jonathan Gaffiot
Étude des neutrinos de réacteur : mise en place et
caractérisation du détecteur Nucifer
Soutenue le 20 novembre 2012 devant le jury composé de :
Pierre DESESQUELLES Président du Jury
Alessandra TONAZZO Rapporteur
Fabrice PIQUEMAL Rapporteur
Serge KOX Examinateur
Adam BERNSTEIN Examinateur
Alain LETOURNEAU Directeur de thèse
Michel CRIBIER Invité
À Flore
Remerciements
Je suis très heureux de terminer ma thèse par la rédaction des remerciements, tant le
travail en équipe est important, à la fois pour apprendre et avancer dans le projet et comme
source permanente d’épanouissement personnel.
Cette thèse a été extrêmement enrichissante, avec notamment la découverte de la Science
et de la recherche. Nucifer est un très beau projet, tout à fait adapté à une thèse par son
échelle de temps et de complexité. Je suis particulièrement heureux des résultats que nous
avons pu obtenir, même si les neutrinos ne sont pas (encore) au rendez-vous, car le détecteur
a parfaitement fonctionné et l’analyse de données a été d’une redoutable efficacité.
Jeremerciedoncd’abordl’IRFUetsondirecteurPhilippeChomazdem’avoirpermisd’ef-
fectuer cette thèse (avec la bourse de secours), ainsi que Michel Garçon et Héloise Goutte
de m’avoir accueilli au Service de Physique Nucléaire avec leur adjointe Françoise Auger.
Je suis très honoré qu’Alessandra Tonazzo et Fabrice Piquemal aient accepté d’être
mes rapporteurs, et également qu’Adam Bernstein, Serge Kox et Pierre Desesquelles
aient pu siéger dans mon jury de soutenance. Et je remercie spécialement Michel Cribier
d’avoir accepté d’être invité dans le jury.
Ces trois années ont été très intenses, au sein d’une super équipe où l’ambiance a toujours
été positive et tournée vers la manip’. Je tiens d’abord à remercier Alain Letourneau, mon
directeur de thèse, qui m’a soutenu et guidé dans la thèse tout en me laissant de l’autonomie
et de l’initiative. Je remercie ensuite David Lhuillier, la locomotive-fusée locale au sens
physique si solide, avec qui le travail quasi-quotidien m’a énormément appris.
JeremerciechaleureusementThomasMueller dem’avoirlaisséuneplacedanslebureau
et d’avoir partagé avec moi son expérience et ses connaissances, ainsi que pour tous les bons
moments extra-professionnels. Merci également à Antoine Collin qui m’a supporté pendant
la rédaction, et je souhaite une bonne thèse à Maxime Péquignot qui me succède.
Je tiens ensuite à remercier Stefano Panebianco pour le co-encadrement des TL et pour
les discussions toujours intéressantes. Merci également à Thomas Materna pour ses conseils
en instrumentation.
Mais l’équipe Nucifer s’élargit au SPP, petite particularité à l’IRFU. Mes remerciements
vont d’abord à Thierry Lasserre et Michel Cribier, à l’origine de Nucifer et donc de ma
thèse,etquim’ontapportétouteleurexpertise.MerciensuiteàmessenseïMaximilienFech-
ner (vice-dieu du C++, sans qui je serais un piètre programmeur) et Guillaume Mention
(vice-dieudelastat’,sansquijenecomprendraispasgrandchoseauxincertitudes).Jeremer-
cie enfin Rachel Quéval et Vincent Durand, tous deux en thèse exclusivement sur Double
Chooz et c’est bien dommage parce qu’on aura peu travaillé ensemble, ainsi que Matthieu
Vivier et Vincent Fischer, venus renforcer l’équipe à la fin de ma thèse.
La science expérimentale n’est rien sans ses ingénieurs et techniciens, experts et praticiens
de la haute technologie. Je veux ici exprimer toute ma reconnaissance aux services techniques
iii
Table des matières
de l’IRFU, de Nantes et d’Heildelberg, et je tiens à remercier particulièrement l’équipe tech-
nique locale : Rémi Granelli, notre chef de projet, Pierre Starzynski et Gilles Prono,
qui ont apporté un savoir-faire irremplaçable dans la réalisation du détecteur, Yves Piret,
qui a réalisé le logiciel d’acquisition et assuré le support sans ménager son temps, et Natha-
lie Pedrol Margaley, qui a intégré le système de mesures environnementales. Et merci
également à tous les experts que nous avons pu consulter et qui nous ont accordé un peu de
leur temps, tels Loris Scola et Gilles Coulloux à la conception, Eric Delagnes, Philippe
Legou et Jean-marc Reymond sur l’électronique et notamment nos fameux « splitters »,
et Pierre-François Honoré sur l’informatique. Remerciements spéciaux à Lise Bouvet et
Lionel Latron pour leurs efforts dans la réalisation des dossiers de sûreté et de sécurité.
Je veux également remercier tous les stagiaires avec qui j’ai travaillé et grâce à qui le
projet a avancé : Joaquin Arancibia Nuesch, Nicolas Boisset et Romain Rebouleau lors
de la mise en place de l’électronique et des premiers codes, avec la radonisation du liquide;
Corentin Josse lors de la caractérisation finale à l’ALS; et la « team analyse » de cet été
avec Johan Pelzer (qui nous revient un jour par semaine pendant quelques mois de plus),
Vincent Fischer (qui a rejoint l’équipe en thèse), Quentin Herbaut et Gaetan Boireau.
LeprojetNucifer estunecollaborationmaintenantinternationale.Mercià nospartenaires
français de Subatech, et en particulier à Andi Cucoanes, avec qui j’ai travaillé sur les PM
et leurs bases au début de ma thèse quand il était post-doc chez nous. Merci également au
groupe neutrino du MPIK Heildelberg, notamment à Christian Buck, pour nous avoir offert
si vite un bon liquide scintillant en remplacement de notre liquide catalogue inutilisable.
Merci toujours aux membres du SERMA venu nous apporter leur expérience de la simulation
réacteur, Éric Dumonteil, Cédric Jouanne, François-Xavier Hugot et Fausto Malvagi;
je retrouve ainsi quelques connaissances de mon stage de fin d’études. Enfin, un grand merci
aux équipes d’Osiris pour leur très bon accueil et le partage de leur expérience du réacteur.
Une thèse c’est aussi l’environnement de travail et son ambiance, et j’ai eu de la chance
au SPhN. Un grand merci donc à l’équipe de la salle café du bas et notamment à Étienne
Burtin, Nicole D’Hose, Pierre Guichon dit PAM, Valérie Poyeton, Andrea Ferrero,
Isabelle Pacquetet et Isabelle Richard pour toutes les discussions et la bonne humeur.
Plusprofessionnellement,merciaussiausupportadministratifdeDanielleCoret,ausupport
technique de Patrick Champion, au support informatique de Gilles Tricoche et re-merci à
Isabelle Richard que je suis allé embêter à chacune de mes missions.
Merci à tous les étudiants du laboratoire, stagiaires et thésards qui font vivre le labo
(voire la recherche), et en particulier Lucie Grente, Charlotte Amouroux, Jean-François
Lemaitre côté noyau et fission; Gabriel Charles, Vincent Andrieux et Marie Boer côté
hadronique; Fabien Dechery et Corinne Louchart pour les JRJC.
Je veux également remercier Stéphane Bourganel, mon directeur de stage, ainsi que
quelques professeurs tels que Jean-Paul Berland (physique en sup’), Clément Lemaignan
(matériaux pour le nucléaire), Hervé Lemonnier (thermohydraulique diphasique) et tous
les autres professeurs du Génie Énergétique et Nucléaire de l’ENSPG, pour m’avoir lancé
efficacement vers la physique.
Finalement,jeveuxterminerparunhommageàdeuxcommunautés:d’abordàlacommu-
nauté scientifique, qui a bâti le formidable assemblage de connaissances sur lequel j’apporte
quelques données supplémentaires; et ensuite à la communauté du logiciel libre, qui a écrit et
partagé cet autre formidable assemblage, de codes, de langages et d’outils qui sont à la base
d’une grande partie de mon travail de thèse, et même de notre vie quotidienne.
iv
Table des matières
Introduction 1
1 Neutrinos 5
1.1 Cadre théorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.1 Cadre théorique de la physique contemporaine . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Modèle Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.3 Interaction électrofaible et brisure de symétrie . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Neutrinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.1 Introduction au neutrino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.2 Découverte des oscillations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.3 Conséquences théoriques de l’oscillation des neutrinos . . . . . . . . . 14
1.3 Oscillation des neutrinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3.1 Principe de l’oscillation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3.2 État de l’art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3.3 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2 Réacteur, neutrino et garanties nucléaires 31
2.1 Physique des réacteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1.1 La fission et la réaction en chaîne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1.2 Criticité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1.3 Spectres en énergie des neutrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1.4 Réacteur nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1.5 Évolution du combustible nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2 Neutrinos de réacteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.1 Production des neutrinos de réacteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.2 Spectre électron, spectre neutrino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2.3 Conversion des spectres électrons en spectres neutrinos . . . . . . . . . 43
2.2.4 Effets hors équilibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.3 Garanties nucléaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3.1 Physique de la bombe nucléaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3.2 Fabrication du combustible militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.3.3 Non-prolifération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.3.4 Apport des neutrinos de réacteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
v
Table des matières
3 Description du projet Nucifer 59
3.1 Principe de l’expérience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.1.1 Objectifs du projet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.1.2 Réacteur Osiris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.1.3 Détection des antineutrinos électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.1.4 Bruits de fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.2 Détecteur Nucifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.2.1 Conception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.2.2 Description du détecteur Nucifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.2.3 Dispositifs de surveillance du détecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.2.4 Système de remplissage et mesure de pesée . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.2.5 Estimation des bruits de fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.3 Électronique et acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.3.1 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.3.2 Baie électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3.3.3 Bases des photomultiplicateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.3.4 Séparation des signaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.3.5 Numérisation des signaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.3.6 Logique de déclenchement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.3.7 Logiciel d’acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4 Schéma d’analyse 93
4.1 Stratégie d’analyse de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.1.1 Analyse de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.1.2 Suite logicielle d’analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.1.3 Format de données et décodage des données binaires . . . . . . . . . . 94
4.1.4 Analyse automatique et analyse finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.1.5 Transfert et traitement des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.1.6 Cahier d’expérience virtuel ELOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.2 Simulation de la propagation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2.1 Schéma de simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2.2 Taux de détection théorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2.3 Simulation MURE du réacteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.3 Simulation NuMC de la propagation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.3.1 Calcul du facteur géométrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.3.2 Simulation du spectre en énergie visible . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.4 Simulation GEANT4 du détecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.4.1 GEANT4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.4.2 Géométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.4.3 Cartes de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.4.4 Modèle physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.4.5 Observables et sorties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.5 Prédictions pour Nucifer à Osiris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.5.1 Facteur géométrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.5.2 Efficacité de détection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.5.3 Taux de détection attendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.5.4 Estimation de la sensibilité à une oscillation . . . . . . . . . . . . . . . 114
vi
Table des matières
5 Liquides scintillants 117
5.1 Scintillation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.1.1 Mécanisme de la scintillation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.1.2 Composition d’un liquide scintillant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5.1.3 Dopage au gadolinium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5.2 Discrimination par analyse de forme ou PSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.2.1 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.2.2 Caractérisation de la PSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.3 Liquides de Nucifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.4 Expérience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.4.1 Liquides scintillants mesurés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5.4.2 Sources radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
5.4.3 Montages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.4.4 Acquisition par carte Matacq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.5 Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.5.1 Analyse en temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.5.2 Calcul des FoM en fonction du décalage entre Q et Q . . . . . . . 130
tail tot
5.6 Résultats de la première série de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.6.1 Rendement lumineux avec source 60Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.6.2 PSD avec source 252Cf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.7 Résultats de la seconde série de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.7.1 Rendement lumineux avec source 60Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.7.2 PSD avec source 252Cf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6 Tests et caractérisation au laboratoire 139
6.1 Étalonnage en énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6.1.1 Piédestal et gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6.1.2 Modèle phénoménologique de collecte des charges . . . . . . . . . . . . 141
6.1.3 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
6.1.4 Linéarité en charges de l’acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
6.1.5 Sources radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
6.1.6 Droite d’étalonnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
6.2 Étalonnage en temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
6.2.1 Horloge NIMbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
6.2.2 Horloge TDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.2.3 Référence en temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.2.4 Calculs des temps morts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
6.2.5 Corrélations entre événements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
6.3 PSD dans Nucifer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
6.3.1 Source AmBe externe en coïncidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
6.3.2 Source bismuth-polonium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
7 Tests et mesures à Osiris 159
7.1 Échelle d’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
7.1.1 Données de DEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
7.1.2 Données de sources radioactives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
7.1.3 Comparaison avec la simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
vii
Description:circuit thermohydraulique génère des fuites et des effluents que le coût de l'eau lourde rend inacceptables. modules et d'options (voir en annexe G.2 la liste des Algos disponibles et le message renvoyé demander un nombre quelconque des Algo déjà programmés, et la plupart des analyses sont