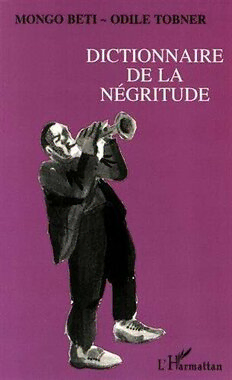Table Of ContentDICTIONNAIRE
DE LA
,
NEGRITUDE
OUVRAGES DE MONGO BETI
Ville Cruelle, roman, Présence Africaine, édit. 1954.
Le Pauvre Christ de Bomba, roman, Robert Laffont 1956, réédition Pré-
sence Africaine 1976.
Mission Terminée, roman, Buchet-Chastel édit. 1957.
Le roi miraculé, roman, Buchet-Chastel édit. 1958.
Main basse sur le Cameroun, essai, François Maspero édit. 1972, réédi-
tion Peuples noirs 1984.
Remember Ruben, roman, 10/18 édit. 1974 ; réédition L'Harmattan 1982.
Perpétue, et l'habitude du malheur, roman, Buchet-Chastel édit. 1974.
La ruine presque cocasse d'un polichinelle, roman, Peuples noirs édit. 1979.
Les deux mères de Guillaume Ismaël Dzewatama, roman, Buchet-Chastel
édit. 1983.
La revanche de Guillaume Ismaël Dzewatama, roman, Buchet-Chastel édit.
1984.
Lettre ouverte aux Camerounais, essai, Peuples noirs édit. 1986.
-
Mongo BETI Odile TOBNER
et la participation de collaborateurs
-
de la revue Peuples noirs Peuples africains
DICTIONNAIRE
DE LA
,
NEGRITUDE
Éditions L'Harmattan
5-7 rue de l'École-Polytechnique
75005 Paris
@
L'Harmattan, 1989
ISBN: 2-7384-0494-4
AVANT-PROPOS
Trente années durant, les peuples africains, libres et souverains mais
impuissants, ont dû entendre les éternels docteurs Pangloss leur prescrire
un destin à la fois injuste et insensé.
Qui sans cesse proclamait tantôt que les peuples pauvres se doivent de
sacrifier leur désir de démocratie sur l'autel du progrès économique, tan-
tôt que, la liberté d'expression étant incompatible avec l'organisation tri-
bale, le Continent noir doit se résigner à la malédiction du silence?
Qui a semé parmi les Africains l'épidémie de l'homme fort, du chef
charismatique, prétendument seul respectueux du legs des cultures
ancestrales?
Qui, pendant trente années, s'est appliqué à fourrer ces monstruosités
dans la pratique quotidienne en encourageant la censure, en justifiant les
partis uniques à coups d'éditoriaux savants, en noyant de préférence les
chefs d'État les plus despotiques sous des déluges d'or?
Qui a décrété sage de l'Afrique un tyran ivre de fétiches, mégalomane,
prévaricateur?
Pendant trente interminables années, les peuples africains durent donc
renoncer même à leurs rêves de liberté, sur l'ordre des grands pontifes
de l'orthodoxie internationale qui leur promettaient le bonheur à ce prix.
Mais au lieu du nirvana, voici la catastrophe sous toutes les fonnes, l'enfer
d'une crise inextricable. Voici la faillite d'une coopération sur fond de fan-
tasmes.
Ainsi démentis par l'événement, désavoués en quelque sorte par la jus-
tice immanente, les nouveaux mages allaient-ils se pendre en public, comme
jadis lorsque l'honneur régissait les sociétés humaines? Au moins serions-
nous satisfaits s'ils consentaient à abandonner la scène, laissant enfin les
Africains libres de débattre entre eux, libres de s'informer pour leur gou-
verne, libres de décider pour eux-mêmes, libres enfin de construire à leur
guise l'avenir de leurs rêves après tant de siècles d'asservissements divers.
Était-ce vraiment trop demander?
C'est un fait que déjà se chuchotent les' prémices d'une nouvelle pré-
dication des inévitables grands-prêtres, aussi péremptoire que la précédente.
Ils sont indispensables, déclarent-ils; que deviendrait le monde sans eux?
Pitoyables orphelins, les Africains ne retourneraient-ils pas définitivement
à leurs vieux démons, outre quelques autres calamités inoculées par l'islam
ou le marxisme? Ce serait cette fois l'apocalypse tribale.
Ainsi disent-ils déjà.
Victimes et boucs émissaires tour à tour, ou simultanément, tel est le
verdict concocté à jamais aux Africains par le tribunal des dogmatiques
du bon ordre international. Juges et parties, plus ils ont tort, plus ils ont
raison, exactement le contraire des peuples africains, figurants hébétés
depuis les temps immémoriaux. La traite, la déportation, l'esclavage,
5
n'était-ce déjà pas la faute des guerres tribales? Et la colonisation? les
guerres tribales, vous dit-on. Le désastre de la dette? les guerres tribales.
La preuve est cette fois faite, s'il en était encore besoin, que les peu-
ples africains n'ont rien à espérer de ce côté-là.
Rien de durablement heureux ne peut advenir aux Africains sans leur
initiative et leur enthousiasme, telle est la conviction des auteurs de ce
modeste ouvrage. Depuis des siècles sinon des millénaires, on ne cesse
d'imposer aux Africains, avec leur assentiment prétend-on chaque fois, tou-
tes sortes de systèmes: religieux, politiques, linguistiques, sociaux; cha-
que fois, cela se termine mal. Si jamais l'histoire a dispensé une leçon lumi-
neuse, c'est bien celle-là; elle brille précisément, croyons-nous, à chaque
page de ce Dictionnaire de la négritude.
En fondant il y a onze ans la revue Peuples noirs -peuples africains,
nous avions la prétention de contribuer à rendre aux Africains l'initiative
de la parole. Avec le Dictionnaire de la négritude, nous croyons contri-
buer à leur rendre l'initiative de l'interprétation du monde, indispensable
s'ils se préparent à agir eux-mêmes, ayant renvoyé sans appel les délirants
bonzes de la théogonie internationale à leurs chères études qu'ils n'auraient
jamais dû quitter.
Qu'est-ce que la négritude?
Inventé, dit-on, par Césaire, mais commercialisé en quelque sorte par
Senghor, le terme peut se définir somme toute comme la conscience que
prend le Noir de son statut dans le monde et la révolte dont cette prise
de conscience imprègne son expression artistique et ses aspirations
politiques.
La négritude, c'est l'image que le Noir se construit de lui-même en
réplique à l'image qui s'est édifiée de lui, sans lui donc contre lui, dans
l'esprit des peuples à peau claire - image de lui-même sans cesse recon-
quise, quotidiennement réhabilitée contre les souillures et les préjugés de
l'esclavage, de la domination coloniale et néo-coloniale.
Derrière le mot « négritude » s'ouvre tout un champ idéologique qui
est aussi un champ de bataille avec vainqueur et vaincu, orgueil et humi-
liation. L'analyse de ces antagonismes ne pouvait être esquivée. Le géno-
cide matériel et spirituel des Noirs est loin d'être interrompu. Il risque
de se poursuivre de toutes les façons, de la plus brutale à la plus insi-
dieuse, aussi longtemps que le mot «négritude» sera vidé de son contenu
de révolte et de scandale pour en faire l'enseigne d'une boutique de pro-
duits exotiques normalisés.
Les Grecs appelaient « Éthiopiens» (ceux dont l'aspect est brûlé) les
habitants de l'Afrique Centrale. Ils attachaient à cette appellation une cer-
taine considération, au point d'en faire un des attributs de Zeus. Ce res-
pect s'explique probablement parce que l'Afrique se fit connaître à eux
à travers le rayonnement de la prestigieuse civilisation égyptienne. Ils réser-
vaient le nom péjoratif de «barbares» aux habitants du nord de l'Europe.
Depuis cinq siècles maintenant, le sens s'est exactement inversé: les dieux
sont blancs et viennent du nord. L'idée du Noir, depuis le XVIe siècle,
est uniquement péjorative et se confond avec celle de « sauvage». Le sens
des mots est une girouette, il indique très clairement d'où souffle le vent
du pouvoir.
Procédant d'une parole libre, l'illustration que nous offrons de la négri-
tude est contrastée, contradictoire, sans doute passionnée. On ne s'éton-
nera pas que notre sympathie soit allée aux héros noirs, trop méconnus
6
auparavant, les plus grands ayant été intentionnellement dédaignés, les plus
puissants haïs. Nous avons dû tirer de l'oubli, arracher à la caricature de
saisissantes figures, qui ne relèvent pas du mythe, mais bien de l'histoire,
celle de I'homme qui pose sa marque sur la réalité, envers et contre tout.
e' est en politique, certes, que se lisent cruellement les signes de la
défaite historique des peuples noirs; en musique, par contre, on peut dire
sans triomphalisme qu'ils viennent d'imposer une autorité souveraine. Les
harmonies et les rythmes qui symboliseront à jamais la modernité ont été
inventées par des artistes issus d'un peuple interdit de parole. L'édifiant
destin de ces créateurs, qui ont donné le ton au XXe siècle, méritait d'être
au moins signalé, à travers chacun de ces génies, capables par leur force
individuelle, d'apporter le miracle de l'expression neuve, dans son impro-
bable évidence.
On ne rendra jamais assez hommage au vaillant éditeur de cet ouvrage.
Il a accepté le risque de publier un livre ayant toutes les chances de pren-
dre à rebrousse-poil l'idéologie dominante qui n'a pas craint d'ériger ses
mesquins tabous à tous les, recoins d'un domaine qu'elle a prétendu
confisquer.
Mongo BETI
Odile TOBNER
A
ABERNATHY, Ralph David nisme, animé principalement p~r les
(1926- ) Quakers, et d'autres sectes nordIstes,
telle la secte évangélique, à laquelle
appartenait la célèbre romancière
Pasteur baptiste à Montgomery,
Harriet Beecher-Stowe, l'auteur de
Alabama, en 1955, Ralph Aber-
La case de l'oncle Tom, va défier des
nathy devint le plus proche c?llabo-
intérêts puissants et déchaîner des
rateur de Martin Luther KIng au
instincts d'un rare fanatisme, qui ne
cours du boycott des autobus
trouveront point d'exutoire sinon
entraîné par l'affaire Rosa Parks.
dans la guerre, dite guerre de Séces-
Par la suite, il demeura constam-
sion. C'est d'ailleurs celle-ci qui, en
ment à ses côtés.
mettant fin à l'esclavage à la suite de
C'est Ie pasteur R. Abernathy la victoire des Nordistes, va aussi
qui, à la mort de Martin Luther
sonner le glas de l'abolitionnisme à
King, lui succéda à la tête de la Sou-
travers le monde, la traite des Noirs
thern christian leadership conference,
et leur esclavage ne survivant à la
qu'il a dirigé jusqu'en 1977, sans le guerre de Sécession américaine que
panache de son prédécesseur, n'~yant
comme des combats d'arrière-garde,
ni son ascendant sur les foules nI son
des pratiques désuètes qui soulèvent
enthousiasme ni sa vitalité. Installé à peu de passions.
Atlanta, R. Abernathy réserve désor-
Paradoxalenlent, c'est sur le sol
mais l'essentiel de son dévouement à
même de ]'Afrique que l'esclavage
sa nouvelle paroisse.
des Noirs en tant que tel (id est à
distinguer de l'apartheid, forme
d'esclavage qui ne dit pas son nom)
Abolitionnisme
a subsisté jusqu'à nos jours, mais à
l'insu du monde, sans être pour
Mouvement international qui se
autant clandestin: jusqu'à ce que
proposait comme but la suppression
leur gouvernement proclame en
de l'esclavage des Noirs. En Angle-
1982 l'abolition de l'esclavage, les
terre où il est né au XVIIIe siècle et
Harratines de Mauritanie, produits
ne tarda pas à faire irruption sur la
ou issus des razzias des communau-
place publique, il fut in~~é par ~n
tés berbères contre les Noirs des
leader indomptable, WIlham WIl-
régions voisines, avaient un statut
berforce, fondateur de la Society for
très proche de celui des Noirs dans
the extinction of the slave trade. En
le Sud des États-Unis à l'époque de
France, où il est surtout représenté
l'esclavage.
par l'abbé Grégoire et Vict~r
Schoelcher, le mouvement est reste,
comme trop souvent, mondain et
spéculatif. Aux États-Unis d'Amé~i- ABRAHAMS, Peter (1919)
que, où le nombre des :scla;es nOl~s
était immense et leur role economI- Fils d'une mère «métisse du
que apparemment vital, l'abolition- Cap» et d'un père éthiopien qui le
9
laisse orphelin à cinq ans, Peter l'Ouest. Envoyé ensuite à la Jamaï-
Abrahams fut élevé par sa famille que il y reste, dirigeant un journal
maternelle dans un village du et collaborant à la radio et la télé-
Transvaal. Il a raconté son enfance vision. De cette expérience sort un
en Afrique du Sud dans un roman roman: This island now (1966),
autobiographique: Tell freedom trade Cette île entre autres, tenta-
(1954), trade Je ne suis pas un tive pour expliquer la situation poli-
homme libre (1956). Quasi- tique dans les Caraïbes, qui reste au
autodidacte, n'ayant connu qu'une niveau de la dissertation politique
scolarisation tardive et sporadique, moralisatrice. Homme sensible et
durement gagnée sur la nécessité de déchiré, fortement marqué par les
travailler pour subsister, il est à humiliations de l'apartheid, Peter
seize ans, pendant quelques mois, le Abrahams a construit dans l'exil un
condisciple d'Ez'kia Mphahlele à St témoignage irremplaçable sur son
Peter school, près de Johannes- pays natal. Il n'évite pas cependant
bourg. Celui-ci le décrit, à ce le piège du sentimentalisme, qui
moment, fasciné par Marcus Gar- tend à réduire la portée des faits
vey et Langston Hughes, écrivant qu'il décrit dans ses premières
des vers «sur le thème: Je suis noir œuvres et devient franchement léni-
et j'en suis fier, voulant montrer à fiant quand il s'éloigne de son expé-
1'homme blanc qu'il était son égal» rience pour aborder le champ de la
et recherchant également son ami- théorie politique.
tié. En 1939, il s'engage comme
matelot pour gagner l'Angleterre où
il parvient en 1941.
Acculturation
Travaillant comme journaliste, il
inaugure, après quelques essais poé-
tiques et romanesques, avec Mine Le concept d~acculturation a été
boy (1946), trade Rouge est le sang défini par l'anthropologue américain
des Noirs, une série d'œuvres con- Melville J. Herskovits en 1938, dans
sacrées à la description de la situa- son article The study of culture con-
tion sociale de l'Afrique du Sud. tact. « L'acculturation comprend les
Son plus grand succès est The path phénomènes qui résultent du contact
of thunder, qui met en scène continu et direct de groupes d'indi-
l'amour condamné d'un couple vidus ayant différentes cultures,
mixte. Sa plus grande réussite, selon ainsi que les changements dans les
les connaisseurs, est lVild conquest cultures originales des deux groupes
(1951) qui retrace le grand Trek et ou de l'un d'eux. »
l'affrontement entre les Boers et les L'acculturation est un phéno-
Matabélés. L'imagination et le mène inéluctable. L'histoire des
lyrisme de Peter Abrahams se civilisations est l'histoire de la
déploient dans cette fresque histori- chaîne de l'acculturation. Pour ne
que. Il revient au réalisme contem- parler que de la civilisation occiden-
porain avec A wreath for udomo tale, elle ne surgit pas tout à coup
(1956) et A night of their own mais reçoit le rayonnement de
(1965), trade Une nuit sans pareille, l'Orient et de l'Égypte. L'accultu-
où il montre le combat de la résis- ration ne se fait pas forcément dans
tance en Afrique du Sud. le même sens que la domination. La
En 1952 et 1953, Peter Abra- Grèce hellénise Rome. Les barbares
hams accomplit une série de repor- vainqueurs sont romanisés. Aucune
tages pour The Observer, au culture ne disparaît sans laisser de
Kenya, en Afrique du Sud et de traces. Les Gallo-Romains ne sont
10