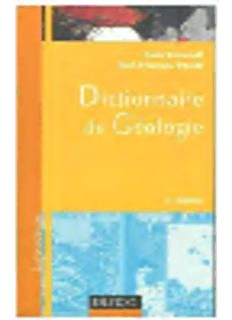Table Of ContentA
A - Ancien symbole chimique de l’argon. V. Ar. tabulaire et peut y être interprétée, souvent, comme
due à l’action du gel (gélifraction). V. modelé
a (axe -) - V. axe tectonique. périglaciaire.
A (horizon -) - V. sol (hor. éluvial). Horizon le plus absolu (âge -) - V. âge, et radiochronotogie.
élevé d’un sol, dont les substances solubles ont été,
au moins en partie, lessivées. Syn. horizon éluvial ou Abukuma (série métamophique de type -) [du
de lessivage. plateau d’Abukume au Japon] - V. métamorphisme.
aa n. m. [mot hawaiien] - Coulée de lave dont la abyssal, e, aux adj. [E. Haug. 1907, du gr. abussos,
surface, qui s’est solidifiée et brisée pendant sa sans fond] - Relatif aux milieux marins situés
descente, est déchiquetée et scoriacée. V. cheire, approximativement entre 3 000 et 7 000 m de
aussi relief volcanique. profondeur.
Aalénien n. m. [C. Mayer-Eymar, 1864, de Aalen, Abyssal (cône -) - V. cône sous-marin.
Allemagne] - Étage aujourd’hui généralement placé
au sommet du Jurassique inf. (ère secondaire), mais abyssales (plaines -) - Vastes zones océaniques à
parfois encore à la base du Jurassique moyen. Selon surface horizontale, situées à une profondeur de
les auteurs, il est réuni tantôt au Lias, tantôt au 4 000 à 5 000 m (en moyenne 4 800 m). V. aussi
Dogger. V. tabl. stratigraphie. adj. aalénien, nne. océan.
Ab - Abréviation usuelle pour albite, feldspath Ac - Symbole chimique de l’actinium.
plagioclase sodique.
Acadien n. m. [Dawson, 1867, de l’Acadie, ancien
abaissement axial (ou d’axe) - Torsion vers le bas nom de la Nouvelle Écosse, Canada] - Division
de l’axe d’un pli. Ant. relèvement axial. stratigraphique équivalant au Cambrien moyen.
V. tabl. stratigraphie. adj. acadien, nne.
Abbevillien n. m. [M. Breuil, 1932, d’Abbeville,
Somme, Fr.] (V. tabl. préhistoire) - Ensemble acadienne (phase -) - Phase tectonique
culturel préhistorique du Paléolithique inférieur, contemporaine de la phase bretonne, ou un peu plus
autrefois nommé Chelléen, caractérisé par des ancienne qu’elle. V. tabl. stratigraphie.
silex grossièrement taillés en bifaces aux arêtes
sinueuses. Parfois considéré comme un faciès ancien Acanthoceras [du gr. akantha, épine, et keras,
de l’Acheuléen (V. fig. A à ce mot). Connu de c o rne] - Genre d’Ammonite (V. fig. à ce mot) du
1 million d’années ou plus à 300 000 ans env. C rétacé sup. (Cénomanien).
adj. abbevillien, nne.
Acanthodiens n. m. [du gr. akantha, épine, et eidos,
aber n. m. [mot breton] - Syn. de ria. forme] - Groupe de Poissons primitifs uniquement
fossiles. Répart. stratigr. : Silurien sup. - Permien
ablation n. f. [du lat. ablatio, enlèvement] - Épisode inf.
d’un processus d’érosion qui correspond à
l’enlèvement de matériaux solides. Les termes
dérivés suivants sont admis par l’Académie des
Sciences. v. (s’) ablater, adj. ablatable.
ablation basale - V. rabotage basal.
accessoire adj. - S’applique à des minéraux présents
abrasion n. f. [du lat. abradere, enlever en grattant]
en faible pourcentage (p. ex. 1% ou moins) dans les
- Érosion causée par le frottement des matériaux
roches et n’intervenant pas dans leurs définitions.
transportés par les eaux ou les glaces. Ex : une
Ant. essentiel. Un minéral peut être accessoire dans
plate-forme d’abrasion marine.
une roche et essentiel dans une autre.
abri-sous-roche n. m. (Syn. baume) - Caverne peu
accident n. m. [du lat. accidens, qui survient
profonde dans un escarpement rocheux. Cette forme
fortuitement] - En tectonique, terme général
de relief est fréquente en pays calcaire à structure
désignant toute surface de contact anormal
http://fribok.blogspot.com/
(= mécanique = tectonique) comme les failles, les préhistoire) - Ensemble culturel préhistorique
décrochements, les charriages. En topographie, un caractérisé par des outils taillés en grands bifaces
accident de terrain est une dénivellation brutale. En épais, surtout ovales (limandes) ou en hachereaux
pétrographie, le terme est utilisé pour des accompagnés d’outils sur éclats, de grattoirs et de
concentrations localisées (ex. accident siliceux). burins. L’Abbevillien dont les bifaces ont des arêtes
plus sinueuses en est parfois considéré comme un
accordance n. f. [de l’allem. Akkordanz, H. Stille, faciès ancien, alors que le Micoquien, aux bifaces
1924] -1. Parallélisme entre deux couches pointus, en est une continuation. Connu de 600 000 à
initialement discordantes résultant de compressions 80 000 ans env. V. préhistoire. adj. acheuléen, nne.
tectoniques ; -2. Concordance locale entre deux
couches ou, plus généralement, deux ensembles
géologiques qui, régionalement, sont séparés par une
discordance stratigraphique. adj. accordant, e.
accore adj. [néerl. Schore, escarpé] - S’applique à
une côte escarpée bordée de fonds importants.
accore n. m. - Bord abrupt du plateau continental
(peu usité).
accrétion n. f. [du lat. accretio, accroissement]
- Augmentation de volume d’un corps par adjonction
de matière extérieure :
-1. accrétion terrestre : selon certaines hypothèses,
formation de la Terre à partir d’un noyau primitif par
l’agglomération, sous l’effet de l’attraction
newtonienne, de météorites, astéroïdes, etc. ; achondrite n. f. - Météorite composée presque
-2. accrétion continentale : mécanisme uniquement de cristaux d’olivine et de pyroxène.
hypothétique selon lequel les continents V. météorite.
s’accroîtraient sur leur pourtour par l’adjonction du
matériel des chaînes géosynclinales. ; aciculaire adj. [du lat. acicula, petite aiguille] - En
-3. accrétion océanique : création de nouvelles forme d’aiguille.
portions de croûte océanique à partir du rift d’une
dorsale océanique. ; acide adj. - S’applique aux roches magmatiques
-4. prisme d’accrétion : empilement d’écailles au contenant 66 % ou plus en poids de SiO d’où en
2
bord interne d’une fosse océanique et au-dessus de général présence de cristaux de quartz, et pauvres en
la croûte océanique causé par la subduction de Mg, Fe et Ca (15 % ou moins). V. aussi
celle-ci (cette notion est en partie conjecturale). i ntermédiaire, basique, ultrabasique.
V. expansion des océans, tectonique de plaques.
acidité n. f. - Pour un minéral, rapport de Si à la
accumulation n. f. (Syn. illuvation) - Pour un sol, somme des cations. Par ex., dans l’orthose
concentration, dans un certain niveau, de substances K[SiAlO], où il y a 3 Si, 1 Al et 1 K, l’acidité est,
3 8
entraînées vers le bas par les eaux d’infiltration. Ce
en pourcentage, 3/(3+1+1)×100 = 60%. Un minéral
niveau est appelé horizon d’accumulation ou horizon est neutre à 50 %, acide au-delà, basique en deçà.
illuvial ou encore horizon B. Ant. lessivage ou
éluviation (horizon A).
aclinal adj. [du gr. a, sans et klinein, s’incliner]
- S’applique à des structures de pendage nul ou très
accumulation (glacis -) - Glacis où la roche en faible.
place est recouverte par une forte épaisseur
d’alluvions. aclinal (escarpement -) - V. glint.
Acéphales n. m. [du gr. a, sans, kephalê, tête] a c l i nal (relief -) (Syn. relief tabulaire) - V. relief
- Ancien nom des Bivalves (Syn. Lamellibranches).
structural.
Aceraspis [du gr. a, sans, keras, corne, et aspis, acmé n. m. [du gr. akmê, pointe] - Biozone définie
bouclier] - Genre d’Agnathe (V. fig. à ce mot) du
par l’abondance particulière d’un organisme.
Dévonien inf. V. stratigraphie.
Acheuléen n. m. [G. de Mortillet, 1872, de St-
acmite n. m. [du gr. akmê, pointe] - variété fibreuse
Acheul, Somme, Fr. ; prononcé ach-] (V. tabl. d’ ægyrine. V. pyroxène (ægyrine).
http://fribok.blogspot.com/
Acritarches n. m. - Organismes microscopiques (5 à particuliers et souvent violents. L’actualisme a
200 µm), de classification incertaine (Protistes, aujaurd’hui triomphé même si l’existence
pontes d’animaux, ou spores de végétaux d’évènement catastrophiques ne peut être rejetée,
supérieurs?), conservés à l’état de matière organique n’oubliant pas que dans de nombreux domaines, il
surtout dans les roches siliceuses. Leur forme est rest à démontrer la triomphe de l’actualisme.
généralement celle d’une sphère hérissée d’épines
fourchues et parfois anastomosées. On les trouve actuel, e adj. - Qui se rapporte à l’époque
dans les sédiments marins et pélagiques, mais contemporaine. Il est à noter que cette référence est
certaines formes sont dulçaquicoles. Répart. mobile dans le temps ce qui n’est pas gênant
stratigr. : Précambrien - Actuel. Ce sont parmi les lorsqu’on se réfère à des périodes géologiques
plus anciens fossiles connus (vers 3 000 m.a.) et ils lointaines mais pose des problèmes pour l’étude des
furent abondants à l’Ordovicien et au Silurien. périodes récentes pour lesquelles il est nécessaire de
(V. Hystrichosphères). fixer plus précisément une origine des temps.
(V. B.P.). n. m. actuel.
acyclique (relief -) - Relief ou modelé, qui ne
s’explique pas par un cycle d’érosion.
adamantin, e adj. [du gr. adamos, diamant] - Qui a
un éclat ou une dureté rappelant le diamant.
adiabatique adj. [du gr. adiabatos, qu’on ne peut
traverser] - Relatif aux transformations des corps qui
s’effectuent sans échange de chaleur avec
actinium n. m. - Symbole chimique Ac. Élément
radioactif avec deux isotopes naturel 227Ac, 228Ac, l’extérieur. La compression adiabatique d’un gaz
issus de la désintégration de l’uranium 235U. produit son échauffement, sa décompression, son
refroidissement. Ce dernier phénomène explique la
formation des nuages par ascension des masses d’air
Actinocamax [du gr. aktis, rayon et camax, pointe]
humide. n. m. adiabatisme.
- Bélemnite du Crétacé sup, proche de Belemnitella.
adinole n. f. [du gr. adinos, compact] - Roche du
actinodonte adj. [du gr. aktis, rayon et odous,
métamorphisme de contact des roches magmatiques
odontos, dent] - V. Bivalves.
basiques (dolérite surtout), de type cornéenne à grain
très fin (aspect de silex), blanc jaunâtre, grise, verte,
Actinoptérygiens n. m. [du gr. aktis, rayon et
composée de quartz, chlorite et albite (apport
pterugion, nageoire] - Groupe de Poissons,
métasomatique de Na), dérivant d’argiles, de pélites
comprenant la plupart des espèces actuelles, dont les
ou de schistes.
os des nageoires ont une disposition rayonnante.
V. Poissons.
adsorption n. f. [du lat. ad, sur, et de absorption] -
Phénomène consistant en la fixation de molécules ou
actinote n. f. [du gr. aktis, rayon] - Amphibole
d’ions à la surface de corps solides. v. adsorber ;
calcique ferromagnésien. V. amphibole (calcique).
adj. adsorbé, e.
activation neutronique (analyse par -) -
adulaire n. f. [du massif de l’Adula, Suisse]
Détermination de la quantité d’un élément dans un
- Variété de feldspath (potassique) orthose
échantillon par mesure de la radioactivité induite par
transparent à éclat nacré.
un bombardement de neutrons.
advection n. f. [du lat. advehere, apporter]
active (marge -) - Marge continentale marquée par
- Déplacement d’une masse d’air atmosphérique
une zone de subduction. V. marge continentale.
dans le sens horizontal. V. convection.
actualisme n. m. (Syn. uniformitarisme) - Théorie
adventif (cône -, volcan -) - Petit volcan
postulant que les lois régissant les phénomènes
apparaissant sur le flanc d’un plus grand et alimenté
géologiques actuels étaient également valables dans
par la même cheminée. V. volcan.
le passé (principe dit des causes actuelles et des
causes anciennes). Cette théorie, soutenue
ægyrine n. f. [de Ægir, Dieu germanique de la mer]
notamment par J. Hutton (1726-1797) et Ch. Lyell
- V. pyroxène (clinopyroxène alcalin).
(1797-1875), s’est opposée à celle du
catastrophisme dont un champion a été G. Cuvier
ænigmatite n. f. [du lat. ænigma, énigme] (Syn.
(1769-1832), selon laquelle certains événements du
cossyrite) - V. amphiboloïde.
passé ne s’expliqueraient que par des phénomènes
http://fribok.blogspot.com/
aération (zone d’-) - Zone d’une nappe d’eau plus habituelle est le million d’années. Pour tenter de
souterraine située au-dessus de la zone de saturation fixer un âge absolu, on fait appel à des phénomènes
et où circulent les eaux vadoses. V. nappe d’eau qui sont fonction exclusivement du temps et dont on
souterraine. espère qu’ils n’ont pas sensiblement varié dans le
passé. C’est notamment le cas de la radioactivité. V.
aérobie adj. [du gr. aêr, aeros, air et bios, vie] - Se
radiochronologie.
dit d’un organisme qui, pour se développer, a besoin
d’oxygène libre. Ant. anaérobie. n. f. aérobiose. âge radiométrique - Âge évalué par
radiochronologie.
aérolite (ou aérolithe) n. m. - V. météorite.
âge relatif - Datation d’un événement par rapport à
aff. - Abréviation du mot latin affinis, voisin de. Ex.
un autre, plus ancien, contemporain, ou plus récent.
: Terebratula sp. aff. Gibbosa, désigne une espèce
C’est le cas de toutes les méthodes stratigraphiques,
du genre Terebratula proche de l’espèce Gibbosa.
paléontologiques, structurales.
affleurement n. m. - Partie d’un terrain visible à la
agglomérat n. m. [du lat. agglomerare, amasser]
surface de la Terre. Sur les cartes géologiques, les
- Terme général désignant un dépôt détritique peu ou
affleurements sont généralement limités par des
pas cimenté, composé d’éléments de taille > 2 mm
traits fins qui sont les contours géologiques. À noter
(classe des rudites). La roche consolidée
que pour ces cartes, on emploie souvent
correspondante est un conglomérat.
et abusivement le mot affleurement pour désigner
des terrains qui sont on réalité cachés par quelques agglutinant, e adj. - Qualifie le test de certains
décimètres de formations superficielles (sol, foraminifères, formé de particules liées par un
alluvions). Pour une couche d’épaisseur donnée, la ciment chitineux ou calcaire. V. arénacé.
largeur d’affleurement dépend des relations entre
aggradation n. f. [par opposition à progradation. cf.
l’attitude de cette couche et la ponte topographique
agradation] - Phénomène du déplacement vers
(V. aussi pendage). La largeur d’aflleurement d’une
l’intérieur des terres de la sédimentation de la marge
couche verticale est égale à l’épaisseur de celle-ci,
continentale consécutif à une montée du niveau
mais lorsque la largeur d’affleurement d’une couche
marin. V. « onlap ».
est égale à son épaisseur, cette couche n’est pas
forcément verticale. v. affleurer ; adj. affleurant, e. agitatian microsismique - Frémissement permanent
de l’écorce terrestre, attribuable en partie à l’activité
industrielle, au vent, aux vagues, en partie à des
causes inconnues.
agmatite n. f. - Migmatite composée d’un mobilisat
granitique emballant des fragments de roches
métamorphiques (gneiss, quartzites). V. migmatite.
Agnathes n. m. [du gr. a, sans, et gnathos,
mâchoire] (Syn. Cyclostomes) - Classe de Vertébrés
a aspect de poissons, la plupart fossiles, n’ayant pas
de mâchoiros. Les Agnathes fossiles, apparus à
l’Ordovicine, ont la partie antérieure du corps
recouverte d’une épaisse cuirasse osseuse, d’où leur
nom d’Ostracodermes. Cette caractéristique les a
Afton n. m. [de Afton, ville de l’Iowa, États-Unis] fait parfois improprement réunir aux Placodermes,
- Période interglaciaire du Quaternaire nord- qui leur ressemblent à ce point de vue mais sont des
américain, équivalent du Günz-Mindel alpin. V. tabl. poissons, dans le groupe des « poissons cuirassés ».
à glaciation. On ne connaît pas d’Agnathes entre le Carbonifère
et l’époque actuelle, peut-être parce qu’ils ont alors
Ag - Symbole chimique de argent.
perdu ce squelette externe. Tous les Agnathes
agamonte n. m. [du gr. a, sans, et gamos, mariage] fossiles ont été trouvés dans des sédiments lacustres.
(Syn schizonte) - individu asexué. V. Foraminifères. Les Agnathes actuels vivent dans les eaux douces ou
marines.
agate n. f. [du gr. Akhatês, cours d’eau de Sicile]
Classification :
- Variété de calcédoine colorée par zones. V. silice
-1. Céphalaspidomorphes : tous fossiles sauf la
(calcédoine).
lamproie. Répart. stratigr. : Ordovicien - Actual.
âge n. m. (durée d’un étage) - V. stratigraphie. -2. Ptéraspidomorphes : tous fossiles sauf le
Myxine. Répart. stratigr. : Ordovicien - Actuel.
âge absolu - Temps qui s’est écoulé depuis un -3. Thélodontes : Répart. stratigr. : Silurien sup. -
évènement donné. En géologie, l’unité de temps la Dévonien inf.
http://fribok.blogspot.com/
Agnostus [du gr. a, non, et gnostos, connu] - Genre Al - Symbole chimique de l’aluminium.
de Trilobite (V. fig. à ce mot) du Cambrien sup.
al. - V. et al.
agpaïtique adj. - S’applique à la structure de
syénites néphéliniques alcalines où la néphéline et alab - Pluriel de elb.
les feldspaths alcalins automorphes ont cristallisé les
premiers, et où les interstices ont été remplis par du alas (ou alass) n. m. - Dépression dans un cryokarst.
pyroxéne et/ou de l’amphibole sodiques et
albâtre n. m. [du gr. Alabastron, nom d’une cité
xénomorphes (ordre de cristallisation inverse du cas
égyptienne] - Variété de gypse très finement
général, p. ex. de celui des granites).
cristallisé, blanc et translucide, utilisé en sculpture.
agradation n. f. [G. Millot, 1964, par opposition P ar extension, ce terme désigne aussi diverses
à dégradation, cf. aggradation] - V. argile. adj. variétés de calcaires blancs, parfois veinés, utilisés
agradé, e. en sculpture ou en architecture.
agrégat n. m. [du lat. ad, vers, et grex, gregis, albédo n. m. [du lat. albedo, blancheur] - Rapport de
troupeau] - Dans les roches sédimentaires, petite l’énergie des ondes électromagnétiques renvoyées
masse plus ou moins lobée, formée par la par une surface, par réflexion ou diffusion, à
coalescence de pelotes (pellets), de grains ou de l’énergie des ondes électromagnétiques incidentes.
particules. L’albédo, parfois exprimé en pourcentage, est le plus
souvent utilisé dans le domaine des ondes
ahermatypique adj. [du gr. a, sans, hermas, récif, lumineuses. Il est de 0 pour un corps noir parfait, de
et tupos, forme] - Se dit des Madréporaires qui ne 0,1 environ pour un sol couvert de végétation, de 0,8
construisent pas de récifs. Ant. hermatypique. à 0,9 pour la neige. L’albédo joue un rôle important
dans les zonations thermiques et les climats du
algue-marine n. f. - Variété de béryl en grands Globe.
cristaux transparents bleu-vert. V. béryl.
Albien n. m. [A. d’Orbigny, 1842, de Alba, nom
aimantation rémanente - Aimantation induite dans latin pour l’Aube, Fr.] - Ètage le plus élevé du
un corps par un champ magnétique qui subsiste Crétacé inf. (ère secondaire). V. tabl. stratigraphie.
après la disparition du champ. V. paléomagnétisme. adj. albien, nne.
« air gun » [expression anglaise] - V. canon à air. albite n. f. [du lat. albus, blanc] - Variété de
feldspath plagioclase sodique ; abréviation usuelle
air libre (anomalie à l’-, correction à l’-) -
Ab.
V. géodésie.
albitisation n. f. - Processus, mal connu en général,
Airy (modèle d’-, hypothèse d’-) - V. géodésie.
conduisant dans une roche magmatique ou
akermanite n. f. [dédié à Akerman] - V. mililite. métamorphique à la formation d’albite qui devient le
seul feldspath.
aklé n. m. - Champ de dunes dont les crêtes,
albitophyre n. m. [de albite, et de porphyre] - Roche
sinueuses, sont, dans l’ensemble, perpendiculaire au
magmatique effusive comportant de l’albite comme
vent.
seul feldspath et des ferromagnésiens hydratés
http://fribok.blogspot.com/
(épidote, chlorite, amphibole, serpentine) ; ces Algonkien n. m. [J.W. Powell et U.S. Geol. Survey,
derniers sont peu nombreux dans les kératophyres, 1890, d’une ethnie indienne d’Amérique du
mais sont abondants dans les spilites (V. ces mots). Nord] - Division stratigraphique équivalant du
Protérozoïque. V. tabl. stratigraphie. adj. algonkien,
alcalin, e adj. [de l’arabe al-qaly, soude] n n e .
- S’applique : -1. aux minéraux riches en ions Na
et/ou K ; -2. aux roches magmatiques saturées où Algues n. f. [du lat. alga, même signification]
NaO + KO > AlO, Na et K se trouvant alors dans - Végétaux aquatiques, marins ou d’eau douce,
2 2 2 3
des feldspaths alcalins et dans des micas, puis s’ils souvent fossilisés quand ils s’incrustent de calcaire
sont en net excédent dans des amphiboles ou de silice. On y distingue principalement les
(riébeckite,…) ou des pyroxènes (ægyrine,...) ; -3. groupes suivants : Diatomées, Cyanophycées
aux roches magmatiques sous-saturées où NaO + (algues bleues), Chlorophycées (algues vertes),
2
KO > SiO, et qui contiennent alors de la néphéline Phéophycées (algues brunes), Rhodophycées
2 2
ou de la leucite, si AlO est en quantité suffisante. (algues rouges).
2 3
Ce qualificatif s’applique ainsi à des roches bien Il est souvent difficile de les dégager des roches qui
différentes, p. ex. à des granites (roches saturées) les renferment et l’on doit alors les étudier en lame
contenant 10 à 15% de NaO + KO, mais aussi à mince. Répart. stratigr. : Précambrien - Actuel.
2 2
des basaltes (roches sous-saturées) n’en contenant adj. algaire.
que 5%.
algues (charbon d’-) - Roche combustible
Alcyonaires n. m. [du gr. alkyon, alcyon, oiseau bitumineuse formée par l’accumulation et la
fabuleux] (Syn. Octocoralliaires) - Groupe de décomposition d’algues vertes lacustres.
Cnidaires comprenant notamment le corail rouge. V. boghead.
aléatoire (échantillonnage -) [du lat. alea, hasard] alios n. m. [mot gascon] - Horizon d’accumulation
- V. échantillonnage. dans un sol podzolique donnant un niveau durci par
cimentation des grains de sable ou de limon par des
Alectryonia [du gr. alektruon, coq] - Ancien nom colloïdes. On distingue l’alios ferrugineux, riche en
pour Lopha, genre de Bivalve (V. fig. à ce mot) du limonite, et l’alios humique, riche en matière
Jurassique - Crétacé. organique. Il est typique sous la forêt des Landes
(Fr.) où il se présente comme un grès mal cimenté,
Alethopteris - Genre de Plantes à allure de fougères jaune rouille à brun foncé, épais de 0,10 à 2 m.
appartenant au groupe des Ptéridospermales V. aussi podzol. adj. aliotique.
(Préphanérogames). Répart. stratigr. : Carbonifère -
Permien. allanite n. m. [dédié à Allan] (Syn. orthite) - Variété
d’épidote comportant des terres rares (Ce, Th, Y,
etc.).
Alleröd n. m. [du nom d’un lac danois] - Division
stratigraphique du Quaternaire (V. tabl. à ce mot)
européen basée sur l’analyse pollinique.
allite n. m. – Sol ayant subi une allitisation (p. ex.
latérite). adj. allitique.
aleurite n. f. [du gr. aleuron. farine] - Terme
désignant une roche détritique meuble à grain très allitisation n. f. (ou alitisation) - Altération
fin (généralement compris entre 10 µm et 100 µm). superficielle des roches conduisant à la formation
V. tabl. granulométrie. d’hydroxyde d’aluminium (Al(OH)3 ou gibbsite)
avec perte en SiO2 et divers cations (K, p. ex.). Ce
aleurolite n. f. - Terme (peu usité) désignant une processus, caractérisé essentiellement par une
aleurite consolidée. V. pélite, « siltstone ». hydrolyse sous un climat chaud et humide, intervient
dans la formation des sols et croûtes ferralitiques
algaire adj. - S’applique dans les roches (= latéritiques). adj. alitique, allitique.
sédimentaires aux dépôts et aux concrétions dus à
l’activité d’algues : concrétions algaires (ex. allivalite n. f. [de Allival, Roumanie] - Roche
oncolite), tapis algaires, ou minces couches (lamines magmatique grenue ultrabasique à cumulat d’olivine
< 500 µm) formées surtout par les Cyanophycées, et et plagioclases d’intercumulat.
qui par superposition donnent des stromatolites
(V. fig. à ce mot). allochème n m [de l’anglais allochem, lui-même du
gr. allos, autre, et de l’anglais chemical, chimique] -
http://fribok.blogspot.com/
Dans la classification des roches de R. Folk, allotriomorphe adj. [du gr. allotrios, étrange, et
éléments figurés formés dans le bassin de morphê, forme] - V. xénomorphe.
sédimentation. V. carbonatées (roches -). adj.
allochimique. allotropie n. f. [du gr. allos, autre, et trepein,
tourner] - Fait, pour un corps simple ou composé, de
allochtone [du gr. allos, autre, et khtôn, terre ; pouvoir se présenter sous diverses formes,
prononcé allok-] -1. n. m. et adj. : sens général, cristallines ou non, ayant des propriétés différentes.
venu d’ailleurs ; -2. adj. : s’applique à une roche V. polymorphisme. adj. allotropique.
sédimentaire, ou à l’origine de celle-ci, lorsque ses
composants ont été arrachés à une roche antérieure, alluvial (glacis -) - V. glacis.
résiduelle ou non. Ex. : l’origine allochtone de
certains charbons ; les flyschs sont, dans l’ensemble, alluviale (terrasse -, vallée -) [de alluvion] - V.
des dépôts allochtones. V. aussi allodapique, terrasse, et vallée.
resédimentation et sédimentaires (roches -) ; -3. n.
m. et adj. : terrains déplacés d’un substratum à un alluvion n. f. [du lat, alluvio, débordement] -
autre par l’effet d’un processus tectonique, p. ex. Sédiment des cours d’eau, à granulométrie liée au
nappe de charriage. Il faut souligner qu’il est parfois débit, et composé de galets, de gravier et de sable en
difficile de savoir si le transport de matériaux dépôts souvent lenticulaires, la fraction fine
géologiques ressortit à un processus sédimentaire ou correspondant à des argiles et limons (c’est elle qui
tectonique. V. tectonosédimentaire, olistostrome. domine dans les zones inondables). Alluvions
Ant. (dans tous les cas) autochtone. n. f. allochtonie. aurifères, diamantifères, stannifères,… : alluvions
allodapique adj. [K.D. Meischner, 1962, du gr. exploitables car ces métaux (rares dans les roches
allodapos, étranger] - S’emploie pour qualifier des mères) y ont été concentrés par tri mécanique (V.
calcaires microbréchiques composés d’une placer). v. alluvionner ; adj. alluvial, e, aux
accumulation de fragments d’autres sédiments (produits par les alluvions) ; alluvionnaire (contenu
calcaire qui, formés à faible profondeur, se sont dans les alluvions) ; alluvionné, e (recouvert
resédimentés à des profondeurs plus grandes et, d’alluvions) ; n. m. alluvionnement.
typiquement, s’intercalent au sein de formations
marneuses ou argileuses. V. aussi allochtone, almandin n. m. (ou almandine n. f.) [de Alabanda,
turbidite. en Asie Mineure] - Variété de grenat alumineux
ferrifère de couleur brun-rouge.
allogène adj. [du gr. allos, autre, et gennan,
engendrer ; on devrait dire allogénétique, V. -gène] alouette (pied d’-) - V. gypse.
-1. En minéralogie, se dit d’un minéral qui n’a pas
pris naissance dans la roche où il se trouve ; cas, p. alpin, e adj. - Qui appartient aux Alpes ; qui a des
ex., des minéraux détritiques dans une roche caractères qui sont ceux des Alpes. En géologie, cet
sédimentaires. (Syn. allothigène). Ant. authigène ; adjectif est souvent utilisé dans un sens très large,
-2. En géomorphologie, se dit d’un cours d’eau p. ex., l’expression « chaînes alpines» peut
coulant dans une région karstique et dont la source concerner tous les reliefs qui entourent la
se trouve en dehors de cette région. Méditerranée, ceux des Carpathes, des Balkans,
d’Iran, etc., qui se sont formés durant le cycle alpin.
allongement d’un minéral ou (signe d’-) - Relation,
pour une section d’un cristal vue au microscope alpin (cycle -) - Cycle orogénique débutant au
polarisant, entre son allongement géométrique et les Secondaire (Trias) et marqué surtout au Tertiaire par
indices n’ et n’ de cette section (V. réfraction). Si diverses phases tectoniques. V. tabl. stratigraphie.
g p
n’ est parallèle à cet allongement, ou fait avec lui un
g
angle inférieur à 45 , on dit que l’allongement est alpin (Trias -) -V. Trias.
positif ; si c’est n’, l’allongement est dit négatif.
p
alpinotype n. m. [H. Stille, 1920] - Type de style
allophane n. m. [du gr. allos, autre, et phaneîn, tectonique caractérisé par des plis accusés et des
paraître] - Aluminosilicate hydraté AlO, SiO, nappes de charriage affectant principalement une
2 3 2
nHO, mal cristallisé, voisin des minéraux argileux couverture sédimentaire, comme c’est le cas pour les
2
auxquels il paraît souvent faire transition. A l p e s . A nt. germanique.
adj. allophanique.
altération n. f. - Modification des propriétés
Allothériens n. m. [du gr. allos, autre, et thêrion, physco-chimiques des minéraux, et donc des roches,
bête sauvage] - V. Multituberculés. par les agents atmosphériques, par les eaux
souterraines et les eaux thermales (altération
allothigène adj. [du gr. allothi, d’autre part, et hydrothermale). Elle dépend en particulier du climat,
gennan, engendrer] - V. allogène. de la température des eaux, de la nature des roches et
http://fribok.blogspot.com/
de leur degré de fracturation. Elle a généralement d’Alvéolinidés. Répart. stratigr. : Crétacé inf.
pour effet de rendre les roches moins cohérentes ce (Aptien) - Actuel. V. fig. page suivante.
qui facilite leur désintégration (V. érosion). Ant.
inaltérable. v. (s’) altérer ; adj. altéré, e (qui a subi Alvéolinidés n. m. - Groupe de Foraminifères
une altération) ; altérable (qui peut s’altérer Miliolidés, fusiformes ou subsphériques, à structure
aisément). complexe, dont la taille, en moyenne de quelques
mm, peut parfois atteindre 10 cm. Leur squelette (ou
altérite n. f. - Formation superficiellle résiduelle test), de nature calcaire, est constitué par une lame
résultant de l’altération et de la fragmentation sur formant une spirale divisée en loges par des cloisons
place de roches antérieures sans transformation primaires méridiennes, elles-mêrnes subdivisées en
pédologiques. Ex. une arène granitique est une logettes par des cloisons secondaires. À la différence
altérite. cf. régolite. des Fusulines (qui sont paléozoïques), leur test ne
comporte qu’une couche. On les reconnaît bien à la
alternance n. f. (de faciès) - Fait pour deux ou loupe, leur test apparaissant blanc porcelané. Ce sont
plusieurs types de couche, stratifiées de se succéder des organismes de mers chaudes et peu profondes.
de manière répétitive avec plus ou moins de Ils forment parfois un constituant important de
régularité. Ex. alternance de bancs marneux et de certaines roches, notamment dans l’Éocène des
bancs calcaires dans les marno-calcaires ; alternance régions téthysiennes. Répart. stratigr. : Crétacé inf. -
de niveaux de péridotites et de gabbros dans la base Actuel.
des ophiolites. V. aussi cycle, séquence.
altitude n. f. - Élévation verticale d’un point au-
dessus du niveau moyen de la mer. L’altitude (ou
cote) utilisée pour les points cotés ou certaines
courbes de niveau, est définie pour un pays par
rapport à un point fondamental matérialisé : en
France, c’est le niveau moyen de la Méditerranée
mesuré par le marégraphe de Marseille.
alumine n. f. [du lat. alumen, inis, alun] - Oxyde
d’aluminium AlO. V. corindon.
2 3
aluminium n. m. - Symbole chimique Al. N et
masae atomique 13 et 26,97 ; ion 3+ de rayon 0,51 Å
; densité 2,7 ; clarke 81 300 g/t soit 8,1 % (3e
élément de l’écorce, et métal le plus abondant dans
Amaltheus [du gr. Amaltheia, chèvre qui nourrit
celle-ci). Métal blanc brillant à l’état pur, se trouvant
Zeus] - Genre d’Ammonite (V. fig. à ce mot) du
combiné dans de très nombreux silicates. Son oxyde
Jurassique inf. (Domérien).
est l’alumine AlO dont la forme naturelle est le
2 3
corindon. Le principal minerai est la bauxite, à
amazonite n. f. [de l’Amazone, fleuve d’Amérique
hydroxydes Al(OH) (gibbsite), AlO(OH) (diaspore
3 du Sud] - Variété de feldspath (potassique)
et bœhmite). V. aussi cryolite.
microcline de couleur vert émeraude.
aluminosilicate n. m. - Silicate dans lequel certains
ambre n. m. (ou ambre Jaune) [de l’arabe al-anbar]
atomes de silicium des tétraèdres sont remplacés par
(Syn. succin) - Résine fossile des conifères,
des atomes d’aluminium, d’où association de
translucide, jaune, brune ou rouge clair, en grains ou
tétraèdres [SiO]4+ et [AlO]5- (ex. feldspaths).
4 4 nodules (contenant parfois des fossiles, en particulier
V. silicate.
des insectes bien conservés).
alvéolaire (érosion -) - Type d’érosion qui produit
ambre gris - Concrétion intestinale produite par le
de petites cavités dans les roches. V. aussi taffoni.
cachalot.
alvéole n. m. [du lat. alveolus, même signification]
ambre noir - Syn. jais. Variété de lignite noire et
(souvent, à tort, n. f.) - Petite cavité, En
brillante (V. charbon).
paléontologie. V., p. ex., alvéole du rostre des
Belemnites.
améthyste n. f. [du gr. ametustos, qui préserve de
l’ivresse, les Grecs lui attribuant cette propriété]
Alvéolines n. f. [même étymologie qu’alvéole]
- Variété de quartz de couleur violette.
- Forarninifères du genre, Alveolina ou d’un genre
Voisin ; mot souvent amployé comme synonyme
améthyste orientale - V. corindon, de couleur vert.
http://fribok.blogspot.com/
(= phragmocône) divisée en chambres par des
amiante n. m. [du gr. amiantos, incorruptible] (Syn. cloisons sécrétées par l’animal et une partie, située
asbeste) - Terme sans signification minéralogique en avant de la cloison la plus récente, où se trouvent
précise, qui désigne des minéraux silicatés fibreux les organes mous de l’animal vivant (chambre
textiles, résistant au feu, soit des amphiboles d’habitation). Cette dernière peut être plus ou moins
(anthophyllite, riébeckite,…), soit des serpentines longue (de la moitié d’un tour à deux tours). Un
(chrysotile,...). adj. amiantifère, amianté, e. canal (siphon) la relie à la première loge qui est le
reste de la coquille initiale ou protoconque. Ce
Ammonites n. f. [de Ammon, un des noms de siphon est ventral ou, très rarement, dorsal
Jupiter, représenté avec des cornes de bélier] ( C l y m énies), alors qu’il est central dans le groupe
- Groupe de Céphalopodes Ammonoïdés caractérisé des Nautiloïdés. Un opercule nommé aptychus
par la situation du siphon du côté ventral et le dessin pouvait obturer la chambre d’habitation. Les
des lignes de suture comportant des selles et des cloisons sont soudées aux parois par des sutures
lobes découpés. Apparus au Trias où ils sont cloisonnaires visible, lorsque les couches externes de
représentés uniquement par le groupe des la coquille ont été enlevées, ou bien sur des
Phyllocératidés, ce sont des fossiles stratigraphiques moulages internes. Ces sutures comportent des selles
courants du Jurassique et du Crétacé, époque à la fin (convexités tournées vers l’avant) et des lobes
de laquelle ils disparaissent brusquement. (convexités tournées vers l’arrière) plus ou moins
compliqués selon les groupes. La forme de la
Classification : coquille constitue un caractère important de
-1. Phyllocératidés : coquille lisse ou peu ornée, classification en particulier au niveau de la famille et
suture dont les selles ont des divisions en forme de du genre : les tours de spire, plus ou moins hauts ou
spatule arrondie. Répart. stratigr. : Trias - Crétacé. larges, pourvus ou non d’une carène ventrale
-2. Lytocératidés : coquille dont chaque tour a peuvent se recouvrir les uns les autres (coquilles
généralement une section subcirculaire. involutes) ou au contraire être seulement jointifs
Ornementation souvent constituée de côtes fines. (coquilles évolutes) ou même ne pas se toucher, au
Sutures avec peu de selles et de lobes, ces derniers moins sur une partie des tours (coquilles déroulées).
bifides et symétriques. Répart. stratigr. : Jurassique Certaines espèces ont un enroulement en forme de
et Crétacé. vis (coquilles turriculées) ou bien encore sont
-3. Ammonitidés : toutes les autres Amrnonites rectilignes. Les dimensions de la coquille,
avec les groupes suivants : Psilocératacés, ordinairement de l’ordre du centimètre ou du
Éodérocératacés, Hildocératacés, Haplocératacés, décimètre, peuvent aller de quelques millimètres à
Stéphanocératacés, Périsphinctacés, Desmocératacés, plus de deux mètres.
Hoplitacés, Acanthocératacés. Répart. stratigr. : L’ornementation est très variable et constitue un
Jurassique et Crétacé. V. fig. page suivante. caractère de classification notamment au niveau du
genre et de l’espèce. Chez les Goniatites, elle est peu
ammonitico rosso n. m. [A. de Signo, 1850, marquée : stries ou treillage, côtes peu accusées.
expression italienne signifiant (marbre) rouge à Chez les Cératites existe fréquemment une
ammonites] - Faciès sédimentaire commun dans les costulation parfois noduleuse. Chez les Ammonites,
couches mésozoïques des zones alpines et qui elle est très diverse parfois absente, elle est souvent
montre des nodules calcaires de formes irrégulières constituée de côtes plus ou moins flexueuses, de
rouges et/ou blancs, rarement verdâtres, souvent tubercules ou d’épines. Tous les Ammonoïdés sont
constitués par des ammonites parfois corrodées, marins et devaient flotter et nager au-dessus des
entourés par une matrice argileuse rouge plus ou plateaux continentaux ou ramper sur leurs fonds. Ils
moins abondante, qui peut former un simple film constituent d’excellents fossiles stratigraphiques
entre les éléments ou bien, au contraire, représenter ayant permis de diviser l’ère primaire, depuis le
la plus grande partie de la roche. C’est un faciès Dévonien, et l’ère secondaire en de nombreuses
condensé, c’est-à-dire que sur une faible épaisseur, zones qui constituent d’excellents repères
il correspond à une longue durée de sédimentaion. biostratigraphiques pour ces périodes. On en a décrit
Il s’explique par une dissolution partielle des des milliers d’espèces réparties en quelque 1 800
carbonates d’un dépôt en cours de sédimentation sur genres. Évolution : V. tabl. Céphalopodes.
une ride ou une pente sous-marine à une profondeur Classification :
suffisante. On peut lui comparer, dans le -1. Clyménies (siphon dorsal ; connues seulement
Paléozoïque, les calcaires griottes. au Dévonien inf.).
-2. Goniatites (siphon ventral, sutures simples ;
Ammonoïdés n. m. - Groupe de Céphalopodes Dévonien - Permien).
fossiles protégés par une coquille unique en forme -3. Cératites (siphon ventral, sutures à lobes
de cône très allongé généralement enroulé en découpés ; Trias).
spirale plane. Cette coquille comporte une partie
http://fribok.blogspot.com/
Description:La géologie est, avant tout, une science de terrain : observations et prélèvement y sont le matériau de base de toute recherche. Pour en tirer parti, le géologue doit faire appel a beaucoup d'autres disciplines : physique, chimie, biologie, etc... Ce dictionnaire est destiné aux amateurs, étu