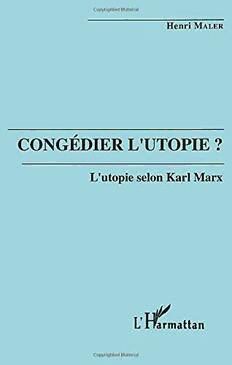Table Of ContentCONGEDIER L'UTOPIE?
@ L'Harmattan, 1994
ISBN: 2-7384-2870-3
HENRI MALER
CONGEDIER L'UTOPIE?
. L'utopie selon Karl Marx.
EditionsL'Ilarmattan
5-7,ruedel'Ecole Polytechique
75005Paris
a
Mes remerciements vont tous ceux qui ont soutenu ce travail de leurs
lectures vigilantes: Daniel Bensaïd, Denis Berger, Alain Brossat, Jean-
Michel Gros, Isaac Johsua, Georges Labica, Michael Uiwy, Jean-Marie
Vincent. C'est à l'espérance partagée avec tous ceux qui ont convoité
l'impossible qu'il doit d'avoir été entrepris. C'est à la tendresse partagée
avec Aude, Matthieu et Isabel qu'il doit son existence. C'est àla mémoire de
Louis Althusser queje le dédie.
SOMMAIRE
INTRODUCTION: Un détour par Marx. 7
PREMIERE PARTIE: L'UTOPIE CONJUREE
Leconceptd'utopie: avantMarx. . . . . Î~
I«
--'
Chapitre I: Parcours dela critique. . 33
1.Fonnations (1840-1844). . . . . . . . . . . 34
2.Transitions(1844-1845). 50
Chapitre II: Contours del'utopie. . 65
1.Ledevenirsocialistedelascience. 65
2.Ledevenirtotaldel'émancipation. . 82
DEUXIEME PARTIE: L'UTOPIE CRITIQUEE
*Leconcept d'utopie: selonMarx. 99
Chapitre I: Science et utopie. . . _ 111
1.Le devenir scientifique du socialisme. 111
2. Science doctrinaire etscience révolutionnaire. 118
3. Critique doctrinaire etcritique révolutionnaire. 126
4. Socialisme ütopique et socialisme scientifique. 135
Chapitre II: Communisme et utopie . 145
1.La présence du futur. ..... 149
2. Les nuées de l'avenir: l"es anticipations utopiques. _ 158
3. Les ombres duprésent: les extrapolations utopiques. 167
TROISIEME PARTIE: L'UTOPIE CONGEDIEE?
I« Le concept d'utopie: avec Marx? . 181
Chapitre I: Dépassement del'utopie? . 193
1.Histoireetutopie.. . . . . . 193
2. Dialectique et utopie. 210
Chapitre II: Déchéance de l'utopie'? . 231
1.Science ou utopie? . . . . '),.),.'..).
2. Communisme ou utOpie? . 244
CONCLUSION: Malgré Marx? . . 259
*Bibliographie.. . . . . . _ ."..... 271
.. Résumé, Table des Matières complète. . 281
INTRODUCTION
*UN DETOUR PAR MARX *
Air du temps: le soulagement et la résignation contemplent la table rase
des marxismes. Pourtant, les seuls marxismes réels, qu'il s'agisse des
marxismes pensés ou des marxismes pratiqués, furent et sont des marxismes
imaginaires, car seuls des marxismes imaginaires peuvent être réels: aucun
ne répond et ne correspond à la conception et au projet de Marx; aucun ne
peut prétendre en délivrer, pour le meilleur ou pour le pire, la vérité. TI
:n'existe aucun marxisme en attente d'authenticité, promis par-delà les
marxismes historiques: inévitablement, on devra poser àMarx (c'est-à-dire à
nous) des questions qu'il ne s'est pas posées -et répondre à saplace (qui est
la nÔtre). TI n'existe aucun marxisme en attente d'authentification: un
marxisme originaire - héritage sans héritiers - qui, gisant en deçà du
marxisme historique, suffirait à juger ce dernier. Si l'on en attendait toute
lumière sur l'histoire et sur lui-même, ce serait en vain qu'on tenterait
d'atteindre un texte premier, pour soumettre la profusion des commentaires
et l'éclatement des pratiques à l'épreuve du Texte; ou pour soumettre le
Texte à l'épreuve de ses avatars, bouffons ou tragiques. TIn'empêche:
-
l'illusion d'orthodoxie qui fonde l'orthodoxie - n'en finit pas de multiplier
ses chapelles; elles abritent les rituels d'une épreuve initiatique aux figures
imposées: quête du marxisme qui fonde le marxisme, dépassement du
marxisme qui le consacre oule condamne, le conjure ou l'absout.
Ainsi, les adeptes d'un retour à Marx, qu'ils se posent en accusateurs
ou en défenseurs pour qu'il soit inculpé ou disculpé des crimes commis en
son nom, deviennent, en dépit d'eux-mêmes, les procureurs de l'orthodoxie:
retour à Marx pour le mettre à l'épreuve du destin du marxisme, et dégager
de cette pure. vérité une condamnation du marxisme qui innocente l'ordre
établi; ou retour à Marx pour dégager le marxisme de son destin, et retrouver
dans une eau lustrale la virginité d'une critique radicale de tout l'ordre social
existant. Mais l'impossibilité même d'un retour à Marx n'annule pas la né-
cessité d'un détour par Marx, qui s'impose à quiconque s'interdit de le trai-
ter comme lui-même s'interdisait de traiter Hegel: en "chien crevé"; détour
qui s'impose à quiconque veut comprendre les discours et les pratiques qui
nous tissent; détour qui s'imposera tant que, à l'horizon de notre histoire,
*Notes del'Introduction page 19.
resterontirrésoluslesproblèmesqueMarx s'est posés et lesproblèmesque
nousposentlespetitesetles grandesbarbariesdelamodernité.
Pourtant,les bouleversementsintervenusdans les pays du "socialisme
réellementexistant"ontlégitimé,auxyeuxdescommentateurspressés,de se
constitueren Tribunalde l'histoire, un verdictsans clémence:une condam-
nationà mortde l'utopie, dont la penséedeMarxseraitle monstrueuxpro-
duit.Pour quine se satisfaitpas de cettejustice expéditive,il est indispen-
sablede remonter aux figures du débatqui datentd'une époqueoù même
l'anathèmenerenonçaitpastoujoursàlathéorie.
Autour de l'oeuvre de Marx, se noue une confrontation qui prend la fi-
gure étrange d'une combinatoire. Selon que ses protagonistes se posent en
pourfendeurs ou défenseurs de l'utopie et que Marx est, àleurs yeux, pour le
meilleur ou pour le pire, convaincu d'abandon 0\1de captation d'héritage, ils
occupent une place définie dans une intenninable partie de quatre coins.
Les pourfendeurs de l'utopie sont partagés. La critique marxienne des
fonnes utopiques du socialisme et du communisme a-t-elle, en leur donnant
congé, ouvert une voie radicalement nouvelle à la théorie et à la pratique de
l'émancipation SOciale? Ou bien, au contraire, la théorie de Marx ne
s'inscrit-elle pas, malgré elle, dans une tradition qui bloque son développe-
ment ou discrédite ses ambitions? Cette théorie prononce-t-elle la relégation,
inéluctable et prometteuse, de l'utopie? Ou bien, au contraire, annonce+elle
sa réalisation implacable et monstrueuse?
Les défenseurs de l'utopie ne sont pas moins divisés. Le communisme
critique, dont Marx serait le fondateur, reçoit-il, pour le réinvestir, un héri-
tage utopique qui garantit la fécondité de ses projets en stimulant l'espérance
de leur réalisation? Ou bien, au contraire, la critique marxienne de l'utopie,
aveugle à ses fondements et à ses effets, n'a+elle pas stérilisé les recherches
et fenné les perspectives dont les utopies portaient la promesse?
La persistance de ces questions, la divergence des réponses, l'urgence
des problèmes appellent de nouvelles recherches et dissuadent de les entre-
prendre: tant il est vrai, comme en témoigne la densité des travaux qui leur
ont été consacrés, qu'elles semblent parvenues àsaturation etvouées àla ré-
pétition. Aussi convient-il de justifier la voie du détour par Marx que nous
essaierons d'emprunter.
1.Défaire le commentaire
La variété des approches et la polarité des évaluations de l'utopie dic-
tent la diversité des conclusions à l'égard de la théorie de Marx. Mais
l'existence d'une critique marxienne de l'utopie pennet d'établir une ligne
de partage entre deux types d'approches: selon que l'examen confronte les
utopies àla critique de Marx ou la théorie de Marx àla critique des utopies.
8
Une première démarche se propose de mettre les utopies à l'épreuve du
-
marxisme. En abordant les utopies du point de vue de la théorie de Marx
dans l'une des interprétations canoniques dont la somme constitue le
marxisme réel-les partisans de cette approche s'efforcent de montrer que le
marxisme élucide le sens des utopies. Refermant la critique proposée par
Marx sur quelques exposés synthétiques, on se borne ici, le cas échéant pour
le préciser, à répéter leur schéma: de là, selon toute apparence, une position
orthodoxe. Aussi trouve-t-on de nombreux travaux qui Sontde simples re-
prises, assorties de quelques variations, de la critique des utopies menée par
Marx (et Engels): ils postulent, en effet, plus qu'ils ne démontrent, que le
marxisme. comprend (saisit et intègre) le contenu, le sens et les limites de
l'utopie. L'orthodoxie est alors tout entière dans sa proclamation: le
marxisme énonce la vérité des utopies.
La démarche la plus répandue a pour ambition de mettre le marxisme à
l'épreuve des utopies. Bien que ses adeptes soustraient généralement leur
propre méthode àun examen qui serait effectué dupoint devue de la théorie
de Marx, ils ne renoncent pas pour autant à présenter leurs analyses comme
concluantes à l'égard de cette théorie: ils s'efforcent de montrer, dans les
sens les plus divers et les plus contradictoires, que l'utopie (qu'ils
l'encensent ou la dénigrent, qu'ils en déplorent la présence ou l'absence dans
la théorie de Marx) révèle le sens du marxisme, là où le marxisme préten-
drait révéler le sens des utopies. Ala lumière de l'utopie et de sa critique, la
pensée de Marx fait alors l'objet de commentaires qui en déplacent
l'interprétation. L'hétérodoxie, partagée sur ses visées, communie dans sa
revendication: les utopies énoncent lavérité du marxisme.
Mais, qu'elles prennent l'oeuvre de Marx pour point de départ ou pour
terme de la confrontation, ces positions divergentes se fondent, à de rares
exceptions près, sur les mêmes présuppositions: une même lecture de la cri-
tique marxienne de l'utopie, proprement érigée en commune orthodoxie par
le redoublement apologétique et le questionnement critique de l'oeuvre de
Marx. Cette lecture réduit, sans la supprimer, la polarité entre positions hété-
rodoxes et positions orthodoxes et atténue sa portée. C'est ce que permettent
d'appréhender son postulat et ses résultats.
Le postulat qui fonde cette lecture et qui, dans ses versions apologé-
tiques, se présente sans fard est le postulat de la transparence. Dans le cas
présent, il revient à affirmer que le sens de la critique marxienne de l'utopie
est immé4iatement et intégralement lisible dans son énoncé explicite, en-
fermé de surcroît dans les textes qui prennent directement l'utopie pour ob-
jet. Pour les disciples, même dissidents, il est possible, avec les seules caté-
gories de ce discours, de préciser, détailler, approfondir les analyses qu'il
propose. On supposera alors que Marx et Engels ont élaboré la théorie adé-
quate des.influences subies et des dettes contractées, le limpide énoncé des
critiques nécessaires et des dépassements effectués: ils auraient vu clair en
9
eux-mêmes et produittous les moyens d'éclairer tout ce qu'ils n'ont pas ex-
plicitement dit. Pour les adversaires, même nuancés, cette prétention à la
transparence, voire à l'omniscience, doit évidemment être récusée. Mais ils
ne manquent pas de la prêter à Marx: Uleur suffit pour cela de se.décharger
de l'examen du texte sur le texte lui-même, de limiter sa citation à son exhi-
bition, de le prendre pour cristallin et clos.
Les résultats du commentaire orthodoxe confirment son postulat. La le-
çon de la critique marxienne de l'utopie serait,.elle aussi, immédiatement et
-
intégralement lisible dans la prétention que cette critique affiche ouaffiche-
rait - ostensiblement: prononcer la fin des utopies par leur dépassement et
leur intégration. à la Science révolutionnaire. Dépassement, intégration, fin
des utopies: telles seraient les vérités ultimes duprojet de Marx, dont il serait
d'autant moins nécessaire de vérifier le contenu et d'interroger le sens
qu'elles sont ouvertement proclamées parleur auteur. Rien n'empêche alors,
tout à loisit et à peu de frais, de légitimer ou de contester un tel projet, de
constater son succès ou son échec, pour s'en réjouir ou pour le déplorer:
quelques formules satisfont alors sans peine aux exigences des polémiques
sans fin qui donnent des gages à la pérennité du commentaire orthodoxe.
Pourtant, il suffit, pour contrarier la présomption d'évidence dont il bénéfi-
cie, dele confronter à quelques problèmes.
La critique marxienne des utopies ne tient pas dans les quelques pages
qui les évoquent: il est impossible de la reconstituer et de l'évaluer, dans sa
spécificité et sa totalité, sans mettre à contribution l'ensemble de la théorie
de Marx. Un tel constat n'engage, semble-t-il, qu'une simple question de
méthode, aussi décisive soit-elle. Mais il suffit de le radicaliser pour que se
découvrent les véritables enjeux: la nécessi~édesoumettre la théorie révolu-
tionnaire de Marx à l'épreuve de sa critique des utopies, dans la mesure où
la signification et la validité de celle théorie sont en question dans cette cri-
-
tique et, plus exactement, dans la critique des formes critiques et utopiques
du socialisme et du communisme. Le commentaire orthodoxe confirme, à sa
façon, la nécessité de cette mise àl'épreuve. En effet, quand, del'examen de
la critique marxienne de l'utopie, on ne retient que les deux formules du dé-
passement de l'utopie par la théorie révolutionnaire et de l'intégration de
l'utopie à la théorie révolutionnaire, c'est que l'examen de la spécificité de
cette théorie connait déjà sa conclusion: la théorie de Marx est une synthèse
qui dépasse en les intégrant les expériences et les savoirs préexistants et,
parmi eux, les expériences et les savoirs utopiques. Telle est la leçon com-
mune dont le destin révèle des contradictions et des impasses qui invitent à
se détoumerdu commentaire orthodoxe et de ses fausses clartés.
C'est la double prétention attribuée à la critique marxienne de l'utopie
qu'il convient alors de mettre en question. Peut-on considérer, tout d'abord,
10
que la théorie de Marx proclame ou assure le dépassement de l'utopie; voire
.
sa fin? Si oui, en quel sens? si non, pourquoi?
Dans sa version apologétique la plus plate, la thèse du dépassement de
l'utopie revient à affirmer que le "socialisme scientifique" tout à la fois ré-
cuse et ne récuse pas l'utopie, puisqu'il la conserve tout en la niant: schéma
hégélien qui dégénère rapidement en pure rhétorique. Selon cette version, les
utopies anticipent la vérité du marxisme et le marxisme réalise la vérité des
utopies. Ainsi naît une double thèse qui, omniprésente dans les commen-
taires, tient lieu le plus souvent d'explication du dépassement: les utopistes
sont les précurseurs de Marx et Engels qui sont les descendants des uto-
...
pistes. Mais, généralement réduite à son énoncé, cette thèse est immédiate-
mentengloutiesoussesthèmes.
Selon le thème des précurseurs, les utopies sont des préformations de la
pensée de Marx: enfances dont elle serait la maturité, germes dont elle ~erait
l'éclosion, anticipations dont elle serait la vérité (1). L'interprétation qui
s'organise autour de ce thème méconnait la singularité des oeuvres invento-
riées comme utopiques. Elle réduit leur confrontation avec la théorie de
Marx au recensement de convergences et de divergences, qu'elle interprète
en termes d'influences subies ou récusées. Et les pauvretés descriptives et
explicatives tissées autour du thème des précurseurs sont reconduites autour
de son doublet: le thème des descendants.
Selon le thème des descendants, la filiation ne fait aucun doute; et
l'explication génétique du dépassement de l'utopie se donne libre cours. Au
discours sur les "sources" du marxisme font écho les métaphores des pater-
nités (expressément reconnues) et des hérédités (dament établies). L'enfant
et l'adulte changent ici de place:l'enfant précurseur devient un adulte géni-
teur..Pour accréditer cette histoire de famille, on relèvera les ressemblances
et les dissemblances, puisque, de son propre aveu, le marxisme dépendrait de
ses procréateurs utopistes et ne peut être compris que par eux. Et si l'enfant
s'oppose àses procréateurs, c'est en vertu dulien généalogique qui les unit:
en cela consiste le dépassement.
Pour què de tels commentaires soient valides, encore faudrait-il qu'ils
ne soient pas réductibles àces métaphores. Encore faudrait-il que le passage
de la confusion et de l'obscurité utopiques à la distinction et à la clarté
-
scientifiquesne soit pas simplementproclamé et naïvement encensé ou
ironiquement contesté. Encore faudrait-il, en particulier, que son explication
dépende de la dialectique concrète dont il arrive qu'elle se réclame et non de
la vague génétique dont elle abuse.
Tant vaut la méthode tant valent les produits. Que l'on enferme la
conceptionde Marx dans cettelecturesuperficiellepourla reconduireou la
récuser, qu'elle soit présentée dans une version apologétiqueou dans une
version critique, le résultat revient à ceci: ce n'est pas le dépassementde
11