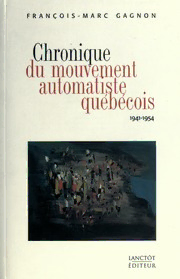Table Of ContentGAGNON
FRANÇOIS-MARC
.Chronique
du mouvement
automatise
.
québécois
1941-1954
LANCTOT
ÉDITEUR
CHRONIQUE DU MOUVEMENT AUTOMATISTE QUÉBÉCOIS
1941-1954
de François-Marc Gagnon
est le cinquante-cinquième ouvrage
publié chez
LANCTÔT ÉDITEUR
et le onzième de la collection
«L'HISTOIRE AU PRÉSENT».
Autres titres parus dans la même collection
Claude Corbo, Lettre fraternelle, raisonnêe et urgente à mes concitoyens
IMMIGRANTS
Georges Dor, Anna brailléeneshot (Ellea beaucoup pleuré), essai sur le langage
parlé des Québécois
Pierre Bourgault, La colère. Écrits polémiques, tome 3
Andrée Ferretti, Le Parti québécois: Pour ou contre l'indépendance?
Guy Bouthillier, L'obsession ethnique
Donald Guay, La conquêtedusport/Lesportetla sociétéquébécoiseaux/x*siècle
Georges Dor, Ta mé tu là? (Ta mère est-elle là?), un autre essai sur le langage
parlé des Québécois
Robert Lahaise, Libéralisme sans liberté, 1830-1860
Le Cercle Gérald-Godin, Tantquel'indépendancen'estpasfaite, elleresteà faire
André d'Allemagne, Le presque pays
CHRONIQUE DU MOUVEMENT
AUTOMATISTE QUÉBÉCOIS
1941-1954
du même auteur
Jean Dubuffet, Aux sources de lafiguration humaine, Montréal, Presses de
l'Université de Montréal, 1972
La conversion par l'image. Un aspect de la mission des Jésuites auprès des
Indiens du Canada au xvif siècle, Montréal, éditions Bellarmin, 1975
Premiers peintres de la Nouvelle-France, Québec, ministère des Affaires
culturelles, 2 vol., 1976. Avec la collaboration de Nicole Cloutier
Paul-Êmile Borduas (1905-1960). Biographie critique et analyse de
l'œuvre, Montréal, Fides, 1978
Paul-Émile Borduas. Écrits/Writings. 1942-1958, Halifax, The Press ofthe
Nova Scotia Collège of Art and Design, 1978. Avec la collaboration de
Dennis Young
Ces hommes dits sauvages, Montréal, Libre Expression, 1984
Hommes effarables et bestes sauvaiges, Montréal, Boréal, 1986, avec la
collaboration de Denise Petel
Paul-Êmile Borduas, Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 1988
Images du castor canadien xvf-xvuf siècles, Québec, Septentrion, 1994
François-Marc Gagnon
DU MOUVEMENT
CHRONIQUE
AUTOMATISTE
QUÉBÉCOIS
1941-1954
ANCTOT
L
ÉDITEUR
LANCTÔT ÉDITEUR
1660A, avenue Ducharme
Outremont, Québec
H2V 1G7
Tél.: (514) 270.6303
Téléc: (514) 273.9608
Adresse électronique: [email protected]
Site Internet: http://ww.total.net/~lanedit
Illustration de la couverture:
Paul-Émile Borduas, Sous leventdel'île, 1947,huile surtoile © Musée des beaux-arts du
Canada, Ottawa. Photo de l'œuvre: J. Sargent.
Mise en pages et maquette de la couverture:
Folio infographie
Distribution
:
Prologue
Tél.: (514) 434.0306/1.800.363.2864
Téléc: (514) 434.2627/1.800.361.8088
Distribution en Europe:
Librairie du Québec
30, rue Gay-Lussac
75005 Paris
France
Téléc: 43.54.39.15
Nous remercionsleConseildesArtsdu Canadadel'aideaccordéeà notreprogrammede
publication. Nous remercions également la SODEC, du ministère de la Culture et des
Communications du Québec, de son soutien.
Cetouvragea été publiégrâceàunesubventiondela Fédérationcanadiennedessciences
humaines et sociales, dont les fonds proviennent du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada.
© lanctôt é—diteur et François-Marc Gagnon, 1998
Dépôt légal 4e trimestre 1998
Bibliothèque nationale du Québec
ISBN 2-89485-057-3
Avant-propos
L'ambition du gros ouvrage que nous présentons aujourd'hui au public
est véritablement modeste. Nous nous sommes proposé de faire la
chronique d'un mouvement d'art québécois, probablement le seul avec
celui des plasticiens que nous ayons jamais eu, le mouvement auto-
matiste, qui a regroupé autour du peintre Paul-Émile Borduas, puis du
poète—Claude Gauvreau, un certain nombre de jeunes—artistes et intellec-
tuels certains très jeunes comme nous le verrons qui partageaient
les mêmes idées etles mêmes convictions plastiques, inspirées, surtoutles
premières, du surréalisme européen, mais ayant assez d'originalité sur le
plan pictural pour qu'il vaille la peine de s'intéresser à son histoire. Notre
intention était de retracer année par année la vie du groupe automatiste,
d'expliquer comment ce mouvement d'art, au sein duquel certes les
peintres ont eu une grande importance, mais pas exclusivement, puisqu'il
comporta aussi des danseuses, des poètes, même un médecin et psy-
chanalyste, d'expliquer donc comment ce mouvement d'art en est venu à
poser ce geste véritablement radical que fut la publication en 1948 du
manifeste Refusglobal, manifeste qui marque la fin de lavieille «idéologie
de conservation» au Québec, pour reprendre l'expression de Marcel
Rioux, et l'accession définitive de notre milieu à la modernité. C'est dire
que nous avons voulu nous intéresser à l'histoire des idées, à leur genèse,
mais aussi à leur développement à la fois dans le groupe et autour de lui.
Nous nous proposons donc de faire le récit de lavie d'un mouvement
d'art. Dans quelle mesure lanaissance du mouvementautomatiste a-t-elle
constitué un progrès par rapport à ce qui l'a précédée? Nous verrons que
cette question a été fortement débattue tout au long de son histoire. Et
donc, loin d'être extérieure au problème et même lui donnant son sens,
cette question fait partie de l'histoire du mouvement. Ce n'est pas que
8 CHRONIQUE DU MOUVEMENT AUTOMATISTE QUÉBÉCOIS
nous attachions tant d'importance à cette notion de progrès. L'apparition
d'un phénomène ou d'une entité n'est pas forcément synonyme de pro-
grès. L'avènement d'un régime totalitaire, parexemple, ou d'une politique
fondée sur le racisme ne sont pas des progrès. Il est vrai que, dans le cas
de la naissance d'un mouvement artistique contemporain, l'idéologie de
l'avant-garde a marqué si profondément les esprits qu'il est difficile
d'éluder la question. Pourquoi le simple fait que ce mouvement d'art
moderne ait paru digne d'attention semble-t-il impliquer qu'il soit consi-
déré comme «meilleur» que ce qui le précède? Révolutionnaire plutôt?
Si l'on veut, la révolution étant une puissante métaphore du changement.
«Histoire d'une révolution culturelle» porte en sous-titre une histoire de
l'influence du surréalisme sur la littérature québécoise. « TheAutomatists
seriously hoped to revolutionize the status quo...» porte en exergue la plus
récente histoire du mouvement automatiste.
Nous étudierons sur une assez c—ourte période (1941-1954) les
activité—s d'un petit groupe de personnes les quinze signataires de Refus
global à travers, notamment, leurs innombrables rencontres, leurs
échanges d'idées et d'œuvres, leur concorde et leurs dissensions, leurs
manifestations, expositions, publications, etc. Nos sources seront de toute
nature, mais les écrits y tiendront la meilleure place. Et, bien sûr, il en
résulte un récit ou, comme l'annonce le titre, une chronique du mouve-
ment automatiste québécois.
Pourtant, dans le récit que nous entreprenons ici, il y a trois facteurs
qui pourraient le distinguer du récit traditionnel. Tout d'abord, c'est un
récit qui part du présent, qui est écrit d'un «lieu» spécifique.Après avoir
été longtemps défini comme un ailleurs de l'Europe, le Québec, d'où nous
écrivons, réclame le privilège d'un temps qui lui soit propre. On nous
assure que «l'histoire-généalogie de la nation» ne fait que suivre le
modèle de l'Europe d'hier, qu'elle n'est qu'une «contamination du pré-
sent par le passé1 », ce qui revient à prendre bien légèrement un héritage
dont on est les premiers responsables... Une culture mieux enracinée que
la nôtre peut bien se payer le luxe d'une histoire non événementielle. Elle
a peu à perdre. Ses artistes sont trop prestigieux pour être menacés par
toutes les entreprises de «déconstruction» ou de «définition» auxquelles
on voudra bien les soumettre dans les écoles. Mais c'est un luxe que nous
ne pouvons pas nous payer.
1. François Furet, L'atelier de l'histoire, Paris, Flammarion, 1982, p. 13.