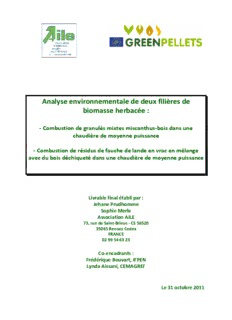Table Of ContentAnalyse environnementale de deux filières de
biomasse herbacée :
- Combustion de granulés mixtes miscanthus-bois dans une
chaudière de moyenne puissance
- Combustion de résidus de fauche de lande en vrac en mélange
avec du bois déchiqueté dans une chaudière de moyenne puissance
Livrable final établi par :
Jehane Prudhomme
Sophie Merle
Association AILE
73, rue de Saint-Brieuc - CS 56520
35065 Rennes Cedex
FRANCE
02 99 54 63 23
Co-encadrants :
Frédérique Bouvart, IFPEN
Lynda Aissani, CEMAGREF
Le 31 octobre 2011
Sommaire
Sommaire _________________________________________________________________3
Listes des figures ___________________________________________________________4
Liste des tableaux___________________________________________________________5
Introduction _______________________________________________________________1
I. Problématique et cadre de l’étude __________________________________________1
I.1. Contexte___________________________________________________________________ 1
I.2. Pourquoi cette étude ? _______________________________________________________ 1
I.3. Listes des questions auxquelles l’étude peut apporter des éléments de réponses________ 2
I.4. Champ d’étude_____________________________________________________________ 2
II. Sélection des filières à évaluer___________________________________________3
II.1. Frontières des systèmes étudiés_______________________________________________ 3
II.2. Hypothèses spécifiques pour l’évaluation des filières _____________________________ 7
III. Analyse environnementale______________________________________________8
III.1. Méthodologie retenue______________________________________________________ 8
III.2. Cadre méthodologique de l’Analyse de Cycle de Vie_____________________________ 8
III.2.1. Définition des objectifs et du champ d’étude__________________________________ 9
III.2.2. Inventaire _____________________________________________________________ 10
III.2.3. Evaluation des impacts environnementaux__________________________________ 11
III.2.4. Interprétation des résultats selon l’objectif__________________________________ 11
III.3. Application aux systèmes étudiés____________________________________________ 11
III.4. Résultats de l’analyse environnementale______________________________________ 13
III.5. Etude de différents scénarios pour les distances de transport des matières premières 20
IV. Analyse des coûts de revient____________________________________________22
V. Réponses aux questions posées ___________________________________________24
VII.1. Discussion autour des résultats_____________________________________________ 25
VII.2. Limites de cette étude ____________________________________________________ 27
Conclusion _______________________________________________________________29
Bibliographie _____________________________________________________________30
Annexe 1: Itinéraire technique retenu pour le miscanthus _________________________33
Annexe 2: Hypothèses prises en compte pour la fertilisation du miscanthus ___________36
Annexe 3 : Hypothèses principales retenues pour la récolte des résidus d’entretien du
territoire : résidu de landes broyées. ___________________________________________37
Annexe 4 : Hypothèses principales retenues pour la transformation de landes _________38
Annexe 5 : Hypothèses principales retenues pour la combustion ____________________39
Listes des figures
Figure 1 : Limites du système pris en compte pour la filière granulés bois-miscanthus comme agrocombustible 4
Figure 2: Limites du système pris en compte pour la filière résidus d’entretien du territoire comme
agrocombustible__________________________________________________________________________ 5
Figure 3 : Limites du système pris en compte pour la filière granulés bois ____________________________ 6
Figure 4 : Phase de l’Analyse du Cycle de Vie (d’après Jolliet et al., 2010)____________________________ 9
Figure 5 : Démarche générale de l’analyse d’impact des émissions et associations aux catégories d’impacts
(d’après Jolliet et al., 2010) ________________________________________________________________ 11
Figure 6: Energie primaire non renouvelable nécessaire (MWh) à la production de 1 MWh de chaleur –
Contribution de chaque processus et comparaison entre agrocombustibles et ressources fossiles_________ 13
Figure 7: Potentiel de réchauffement climatique (kg CO eq) pour la production de 1 MWh de chaleur –
2
Contribution de chaque processus et comparaison entre agrocombustibles et ressources fossiles_________ 14
Figure 8: Diagramme des émissions de GES associées à la culture de miscanthus (kg CO eq/1 MWh de chaleur
2
produit) – en pourcentages cumulés__________________________________________________________ 16
Figure 9: Potentiel d’acidification (kg SO eq) pour la production de 1 MWh de chaleur – Contribution de
2
chaque processus et comparaison entre agrocombustibles et ressources fossiles______________________ 16
Figure 10: Potentiel d’eutrophisation (kg PO 3- eq) lié à la production de 1 MWh de chaleur – Contribution
4
de chaque processus et comparaison entre agrocombustibles et ressources fossiles____________________ 17
Figure 11: Diagramme du potentiel d’acidification (kg SO eq) associé à la culture de miscanthus pour 1 MWh
2
de chaleur produit – En pourcentages cumulés _________________________________________________ 19
Figure 12 : Diagramme du potentiel d’eutrophisation (kg PO 3- eq) associé à la culture de miscanthus pour 1
4
MWh de chaleur produit – En pourcentages cumulés_____________________________________________ 19
Figure 13: Comparaison de la consommation d’énergie primaire non renouvelables (MWh nécessaire/MWh
produit) pour les deux scénarios de production de granulés mixtes. _________________________________ 20
Figure 14: Comparaison du potentiel de réchauffement climatique (kg CO eq) des deux scénarios de production
2
de granulés mixtes________________________________________________________________________ 21
Figure 15: Comparaison du potentiel d'acidification (kg SO eq) des deux scénarios de production de granulés
2
mixtes _________________________________________________________________________________ 21
Figure 16: Comparaison du potentiel d'eutrophisation (kg PO 3- eq) des deux scénarios de production de
4
granulés mixtes__________________________________________________________________________ 22
Liste des tableaux
Tableau 1: PCI et Densité des combustibles étudiés ______________________________________________ 7
Tableau 2: Impacts environnementaux étudiés__________________________________________________ 12
Tableau 3: Teneur en N, S et PCI des agrocombustibles étudiés.____________________________________ 18
Tableau 4 : Hypothèses de transport pour les 2 scénarios_________________________________________ 20
Tableau 5: Dépenses liées à l'implantation d'une culture de miscanthus dans le cadre d'un adhérant
COOPEDOM, en €/ha, sur 15 ans et par année. ________ ________________________________________ 23
Tableau 6: Aide à l’implantation lié à la culture de miscanthus dans le cadre d'un adhérent COOPEDOM, en
€/ha, et €/t sur 15 ans et par année. ______________ ____________________________________________ 23
Tableau 7: Dépenses liées à la récolte et la production de chaleur à partir d’un mélange fauche de lande –
plaquettes forestières._____________________________________________________________________ 24
Tableau 8: Récapitulatif du prix du Mwh en entrée de chaudière pour les différents agrocombustibles______ 24
Tableau 9: Carences identifiées et hypothèses retenues pour les données issues de l’inventaire pour la filière
production chaleur à partir de granulés mixtes _________________________________________________ 28
Tableau 10: Carences identifiées et hypothèses retenues pour les données issues de l’inventaire pour la filière
production de chaleur à partir de fauches de lande______________________________________________ 29
Tableau 11: Rendement de la culture de miscanthus en tonnes de matières sèche par ha_________________ 34
Tableau 12 : Composition du lisier de porc ____________________________________________________ 36
Tableau 13 : Facteurs d’émission liés à l’épandage de lisier de porc________________________________ 36
Introduction
Le présent document est le rapport final de l’analyse environnementale de deux filières
agrocombustibles, réalisée dans le cadre du projet européen Life+ Green Pellets.
Cette étude utilise une méthodologie ACV (Analyse du Cycle de Vie).
I. Problématique et cadre de l’étude
I.1. Contexte
Face aux enjeux actuels de durabilité (Brundtland, 1987), les systèmes agricoles se doivent
d’évoluer afin de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre et d’augmenter leur
indépendance énergétique vis-à-vis des produits pétroliers. Le Grenelle de l’Environnement
de 2007 a permis de définir des objectifs en termes d’énergie renouvelable sur 15 ans. Ainsi,
le plan d’action national en faveur des énergies renouvelables du Ministère de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer (Ministère de l’écologie, 2009) fixe pour
2020 la valeur de 23% d’énergie renouvelable contre 10% en 2005 et une diminution des
émissions de gaz à effet de serre de 20% (Commission européenne, 2010).
La valorisation énergétique de la biomasse semble être une alternative intéressante, allant
dans le sens de ces objectifs ; elle est en pleine expansion. Cependant, face au
développement rapide des filières biomasse-énergie, il parait indispensable de développer
de nouvelles filières de valorisation pour des types de biomasse peu ou pas exploitées à
l'heure actuelle de sorte d'augmenter le potentiel de substitution des filières existantes
telles que le bois-énergie ou les déchets verts. Les cultures ligno-cellulosiques apparaissent
actuellement comme étant un bon complément. Le projet européen Life + Green Pellets
(AILE, 2011a) a pour objectif d’évaluer l’utilisation de biomasse herbacée dans un contexte
où le bois viendrait à manquer. La principale problématique est de dégager les opportunités
et les limites de ces filières.
I.2. Pourquoi cette étude ?
L’objectif de cette étude est de fournir une information sur ces filières aux pouvoirs publics
et aux utilisateurs de chaudière, dans une optique d'aide à la décision (choix
d'investissements, justification de politique de soutien etc.). Elle permettra par ailleurs
d’informer le public et de nourrir le débat sur les bioénergies. Enfin, il s’agit également de
mettre en avant les étapes critiques des filières (contributions majoritaires aux bilans
environnementaux globaux par exemple) et d'identifier les améliorations à envisager sur ces
points. Elle s’inscrit dans une logique de durabilité environnementale et de diminution des
intrants des systèmes agricoles.
Les questions sont posées par l’association AILE, au titre d’une réflexion prospective sur le
développement de l’utilisation de la biomasse. Ces questions sont importantes dans le cadre
de l’aide à la décision quant au développement de ces filières dans les régions Bretagne et
Pays de la Loire.
1
L’approche retenue dans ce projet est une approche comparative. En effet, deux filières
alternatives vont être comparées à des filières de référence fossiles et biomasse.
Pour l’évaluation des impacts environnementaux, nous avons retenu une approche de type
Analyse de Cycle du Vie simplifiée (Jolliet et al., 2010), tenant compte du cadre défini par les
normes ISO (ISO, 2006a)(ISO, 2006b).
Pour les autres aspects (sociaux, économiques et techniques), il s’agira principalement de
mettre en évidence les questions soulevées par le développement de ces filières et d’y
répondre à dires d’experts grâce aux différents partenaires du projet. Il n’y aura pas
d’analyse économique, sociale ou d’analyse de risques.
L’intérêt est porté sur l’intégralité de la filière pour les deux cas étudiés. Des détails sont
fournis pour chacune des étapes.
I.3. Listes des questions auxquelles l’étude peut apporter des éléments de réponses
- Quels sont les impacts environnementaux, techniques, sociétaux et économiques
des deux filières étudiées (diagnostic de la filière)?
- Sont-elles intéressantes à développer dans l’Ouest de la France (approche
territoriale) ?
- Quel est leur intérêt par rapport aux filières de référence ? (quels sont les
bénéfices environnementaux ou – à l'inverse – les aggravations des impacts
environnementaux engendrés par leur développement ? Y a t-il des transferts de
pollution ?)
- Quelles sont les phases les plus pénalisantes du point de vue de ces impacts,
comment les améliorer (démarche d’éco-conception) ?
I.4. Champ d’étude
Cadre géographique : la question est posée à une échelle locale. Les produits de
combustion (lande, miscanthus, bois) sont disponibles dans un rayon de 40 km autour
du lieu de transformation.
Cadre temporel : L’inventaire des données est basés sur les technologies et pratiques
agricoles actuelles ainsi que sur les études existantes, qui ne sont pas forcément
représentatives du contexte dans lequel pourraient se développer les filières étudiées
(dans quelques années).
Acteurs de l’étude : Tous les partenaires du projet Green Pellets sont impliqués dans
cette étude : AILE, CEMAGREF, IFPEN, ADEME, ARVALIS, AEBIOM, COOPEDOM, CAVAC, la
chambre d’agriculture de Bretagne et du pays de la Loire, les conseils généraux des Côtes
d’Armor, du Maine et Loire, de Loire Atlantique, de Vendée, et d’Ille et Vilaine, le conseil
régional de Bretagne.
Maître d’ouvrage : Association AILE
Maîtrise d’œuvre : Association AILE – Jehane Prudhomme
2
Expert fournissant les données : tous les partenaires du projet et les membres du
réseaux technologie Biomasse.
Expert Résultat : les membres de l’évaluation territoriale, l’ADEME et les financeurs.
Société civile : ONG et collectivités territoriales
Réglementation : La filière biomasse-énergie est soumise à une réglementation
européenne portant sur les rejets gazeux des chaudières. Tout d’abord, l’arrêté de 1997
fixe les valeurs limites réglementaires d’émission pour les chaudières de plus de 2 MW
(CITEPA, 1997) et la norme EN 303-5 (AFNOR, 2005) fixe des seuils à ne pas dépasser
pour les chaudières de puissance inférieure à 300kW. Entre les deux, il y a pour l’instant
un vide juridique mais cette norme est en cours de révision pour être élargie.
De plus, le Plan Particule (Ministère de l’écologie et al., 2011) impose des normes en
termes de rejet de particules.
En outre, le gouvernement accorde un crédit d’impôt au renouvellement d’appareils
anciens par des machines plus récentes et plus performantes.
La question a déjà été posée et des études environnementales et économiques ont déjà
été menées (ADEME et BioIntelligenceService, 2005)(ECOBIOM, 2009). L’ADEME a aussi
réalisé une étude bibliographique sur le sujet (ADEME et BioIntelligenceService., 2009).
Cependant, ces études se focalisent soit sur la filière bois soit uniquement sur la culture
de miscanthus comme biocarburant.
Par ailleurs, l’IFPEN et l’ADEME ont réalisé des guides visant à préciser les méthodologies
pour l’étude de filières biomasse-énergie et établir un dialogue entre experts ACV et
décideurs (ADEME et BioIntelligenceService, 2009)(Prieur et Bouvart, 2007)(ADEME et
BioIntelligenceService, 2009).
Cependant, certaines questions restent en suspens comme l’utilisation du sol et la
compétition entre cultures alimentaires et biomasse.
Notre étude apporte donc une première approche des filières complètes de production
de chaleur, en prenant en compte la production du combustible, sa transformation et sa
combustion.
Par ailleurs, aucune étude ACV sur les landes n’a déjà été publiée.
II. Sélection des filières à évaluer
II.1. Frontières des systèmes étudiés
L’étude porte sur 2 filières :
- Combustion de granulés mixtes miscanthus-bois dans une chaudière de moyenne
puissance,
- Combustion de résidus de fauche de lande en vrac en mélange avec du bois
déchiqueté dans une chaudière de moyenne puissance.
Ces filières ont été sélectionnées car leur mise en place semble possible à court-moyen
terme en région Bretagne / Pays de la Loire, dans des conditions favorables au
3
développement de la biomasse comme combustible, notamment en cas de
renchérissement des énergies fossiles.
Les combustibles choisis :
- peuvent être produits dans l’ouest de la France (conditions climatiques et
matérielles),
- présentent une composition compatible avec les chaudières automatiques
actuellement sur le marché.
Les deux filières choisies sont contrastées :
- une filière plus longue, avec transformation des matières brutes en granulés,
produisant un combustible de qualité contrôlée pour alimenter des chaudières de taille
moyenne ;
- une filière plus courte, avec un combustible issu de l’entretien des espaces naturels,
bénéficiant donc de soutien public pour sa production, utilisé en vrac pour limiter les
coûts de transformation.
Le champ d’étude des deux filières est décrit sur les figures 1 et 2.
Figure 1 : Limites du système pris en compte pour la filière granulés bois-miscanthus comme
agrocombustible
4
Figure 2: Limites du système pris en compte pour la filière résidus d’entretien du territoire comme
agrocombustible
Pour pouvoir comparer les bilans environnementaux (ACV) de chacune de ces deux filières,
les résultats obtenus sont ramenés à une base comparable; correspondant à une unité de
"service rendu" (unité fonctionnelle), soit dans le cas présent 1 MWh de chaleur produit en
sortie de chaudière. L'ensemble des étapes de transport intervenant dans ces filières sont
prises en compte dans l'étude.
Pour la filière miscanthus (culture dédiée à la production de biomasse-énergie), l’étude
prend en compte toutes les étapes nécessaires à la culture et à la transformation du
miscanthus en granulés ainsi que les impacts dus à sa combustion en chaudière. Cela
implique la prise en compte des intrants pour chaque sous-système. Les données
proviennent essentiellement de documents publiés par AILE ainsi que par les différents
partenaires du programme.
Pour la fauche des landes, il s’agit de biomasse herbacée poussant sur des espaces naturels.
Elles ne demandent aucun entretien, la seule opération mécanisée est la fauche. Pour cette
5
Description:Sont-elles intéressantes à développer dans l'Ouest de la France (approche
territoriale) ? . 3 Référence : (ThermExcel, 2011). 4 Référence Nous utilisons
le logiciel GaBi 4 (PE International, 2011) ainsi que la base de données associée