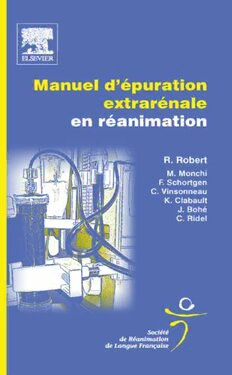Table Of ContentManuel d'epuration extrarenale
■ Societe de reanimation de langue fran~aise
Conseil d'administration 2007
President : Fran~ois Fourrier (Lille)
Vice-president: Daniel de Backer (Bruxelles)
Secretaire general : Antoine Vieillard-Baron (Boulogne-Billancourt)
Secretaire general adjoint : Khaldoun Kuteifan (Mulhouse)
Tresorier : Jean-Philippe Fosse (Bobigny}
Manuel d'epuration extrarenale en reanimation
Responsablee ditoriale : Marie-Jose Rouquette President designe: Bertrand Guidet (Paris}
Editrice: Muriel Chabert Membres: Frederic Baud (Paris}, Marie-Claude Jars-Guincestre
Chef de projet: Fran9oise Methiviez
(Garches), Nadia Kerkeni (Lille). Laurent Papazian (Marseille},
Conception graphique et maquette de couverture: Veronique Lentaigne
Jean-Louis Ricome (Saint-Germain-en-Laye), Rene Robert
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits reserves (Poitiers), Jean-Christophe Roze (Representant du GFRUP, Nantes)
62, rue Camille-Desmoulins, 92442 lssy-les-Moulineaux cedex
http://france.elsevier.com
l'editeur ne pourra @Ire tenu pour responsable de tout incident ou accident, tanl aux per
sonnes qu'aux biens, qui pourrait resulter soil de sa negligence, soil de !'utilisation de tous
produits, methodes, instructions ou idees decrits dans la publication. En raison de l'evo
lution rapide de la science medicale, l'editeur recommande qu'une verification exterieure
intervienne pour les diagnostics et la posologie.
Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par lous procedes reserves pour
lous pays. En application de la loi du 1er juillet 1992, ii est interdit de reproduire, meme
partiellement, la presente publication sans l'autorisation de l'edileur ou du Centre trancais
d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Auguslins, 75006 Paris).
All rights reserved. No part of this publication may be translated, reproduced, stored in a
retrieval system or transmitted in any form or by any other electronic means, mechanical,
photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the publisher.
All rights reserved No part of this publication may be translated, reproduced, stored in a
retrieval system or transmitted in any form or by any other electronic means, mechanical,
photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the publisher.
Photocomposition : Muriel Peirani ISBN : 978-2-84299-932-2
lmprime aux Pays-Bas par Krips, 7940 KC Meppel ISSN : 1242-8132
Dep5t legal : Janvier 2008
Les auteurs Sommaire
Julien Bohs
INSERM U870/INRA U1235/INSNUniversite Claude Bernard Lyon-1/Hospices
civils de Lyon,
Glossaire des abreviations utilisees en cours d'ouvrage X
Reanimation medicale, centre hospitalier Lyon Sud,
165, chemin Grand Revoyet, (69310. Pierre-B.enite
Quand debuter une epuratlon extrarenale ?
Karine Clabault
Notions prealables importantes
Service de reanimation medicale, hOpital Charles-Nicolle, CHU de Rouen,
Objectifs de l'epuration extrarenale
1, rue de Germon!, 76031 Rouen
.Criteres d'epuration extrarenale 2
Mehran Monchi
Reanimation medicale, lnstitut Jacques-Cartier, Catheters d'epuratlon extrarenale 5
6, avenue Noyer Lambert, 91300 Massy
Choix du catheter 5
Christophe Ridel Insertion du catheter 9
Urgences nephrologiques et transplantation renale; hopital Tenon, Dysfonction du catheter 10
4, rue de la Chine, 75970 Paris cedex 20
Infection du catheter 12
Rene Robert Conclusion 13
Service de reanimation medicale, h1lpital Jean-Bernard, CHU Poitiers,
86021 Poitiers cede,x Anticoagulation en epuratlon extrarenale 15
Frederique Schortgen Methodes d'anticoagulation en epuration extrarehale 15
Service de reanimation medicale, CHU Albert Chenevier-Henri Mondor, Role de la technique d'epuration 2'6
51, avenue de Tassigny, 94000 Creteil Choix therapeutique salon le patient 26
Christophe Vlnsonneau
Service des brOles, groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul, Membranes de dialyse 30
27, rue du Faubourg Saint-Jacques, 75679 Paris cedex 14 Caracteristiques physiques des membranes capillaires 31
Proprietes caracteristiques : biocompatibilite, permeabilite
hydraulique, cut-off 32
Caracteristiques Chimiques (polymeres constitutifs) 34
Sterilisation . 35
Biocompatibilite et mortalite dans l'insuffisance renale aigue 35
Conclusion ' 36
Prlnclpes des echanges en epuratlon extrarenale 38
Convection 38
Diffusion 42
Adsorption 44
Conclusion 44
Dose de dialyse 46
Introduction 46
Role pronostique de la dose de dialyse en reanimation 46
Concept de dose de dialyse · 48
Quelles recommandations pour l_a pratique .. 52
Conclusion 53
Aspects pratiques de la nutrition artificielle
Prescription d'une seance d'hemodialyse
au cours de l'epuration extrarenale 101
intermittente 55
L'insuffisance renale aigue induit-elle des besoins
Parametres influenGant la tolerance 55 nutritionnels particuliers ? · 1o 1
Parametres influenGant la dose de dialyse 59
Quelles sont les consequences des apports nutritionnels
Gestion de !'anticoagulation 61
chez le patient en insuffisance renale aigu~ ? 101
Quand debuter et arrllter l'hemodialyse intermittente ? 61
Quelles sont les interactions entre les apports nutritionnels
artificiels et les techniques d'epuration extrarenale ? 102
Nouveautes dans la surveillance d'une seance
de dialyse 63
Gestlon des problemes au cours d'une seance
Mesure de l'efficacite d'epuration 63 d'hemodlalyse intermittente 104
Tolerance hemodynamique 65 Problemes de tolerance hemodynamique 104
Conclusion 66 Dose de dialyse delivree insuffisante 105
Dysfonctionnement de la voie d'abord vasculaire. 106
Hemofiltration continue : utilisation pratlque 67
Coagulation iterative de la membrane malgre
Description du circuit 67 un traitement anticoagulant bien conduit 107
Reglages pratiques 67 Detresse respiratoire en cours de seance · 108
Composition du solute de substitution 71 Deglobulisation au decours d'une seance
L'hemofiltration doit Eltra realisee sur un temps suffisant 71 d'hemodialyse intermittente 108
Surveillance du malade en hemofilJration 72 Apparition d'une fievre au cours ou au decours
Indications 73 d'une seance d'hemodialyse 109
Dlalyse lente quotldlenne 76 Problemes pratlques en hemofiltratlon. 111
Definition 76 Coagulation du circuit 111
Etudes cliniques 76 Modification des pressions sur la machine 112
Comparaison des clairances 78 Le malade n'est pas bien « epure » 112
Conclusion 81 Le malade reste hyponatremique 113
Problemes en rapport avec les autres electrolytes 113
Hemofiltratlon a haut volume 83 La pression arterielle baisse -114
lnterets potentials 84
Qualite de l'eau et entretlen des generateurs
Effets secondaires et inconvenients potentials 86
de la dialyse dans les services de reanimation 115
Conclusion 87
Circuit de l'eau 115
Utilisation des medicaments en hemodialyse Controle microbiologique de l'eau 117
lntermittente et en hemo(dla)filtration continue 89 Qualite chimlque de l'eau 119
Influence de l'insuffisance renale sur la pharmacocinetique 89 Que faire quand la qualite de l'ea4 preconisee
n'est pas obtenue ? 122
Mecanismes d'elimination des medicaments au cours de
l'epuration extrarenale 91 Conclusion 123
Medicaments et hemodialyse: clairance, ajustement
posologique 92
Medicaments et hemo(dia)filtration continue : clairance, I
ajustement posologique 96
Quelques examples en pratique 97
Conclusion 100
Quand debuter· une epuration.
Glossaire des abteviatlons ijtilisees
extrarenale ?
en cours d'ouvrage
CMI concentration minimale inhibitrice
CWH continuous venovenous hemofiltration (hemofiltration II n'existe pas de recommandation precise sur les indications de l'epuration
extrarenale (EER) en reanimation pour deux raisons :
veinoveineuse continue)
CWHD continuous venovenous hemodiafiltration (hemodiafiltration 1) lad efinition de l'insuffisance renale aigue (IRA) n'est pas univoque et. ace jour,
veinoveineuse continue) les conclusions de la conference de consensus de 2007 sont en attente ;
EDD extended daily dialysis ,,, 2) ii n'existe pas de valeur seuil de y eqtinine ou d'ur.ee plasmatique pour
EER epuration extrarenale indiquer l'EER au cours de l'IRA ·'
ETO oxyde d'ethylene _ . ..
•l~t::,:
EVAL ethynyl-vinyl-alcool t:; r . Notions prealables importantes
HBPM heparine de bas poids moleculalre
HDI hemodialyse intermittente
• La creatinine plasmatique et la 1iltration glomerulaire sont liees de tacon
HFAV hemofiltration arterioveineuse
HFC hemofiltration continue exponentielle (figure 1) . Ainsi, au debut de l'IRA, de faaib les augmentations
des chiffres de creatinine plasmatique correspondent une alteration nota-
HFW hemofiltration veinoveineuse continue
ble de la fonction renale. ,
Ht hematocrite
HWC hemofiltration veinoveineuse continue • De plus, au cours de l'IRA, ii existe.une secretion tubulaire de creatinine qui
IC intetvalfe de contlance peut atteindre 50 %, Ainsi, au cours de l'IRA, les chitfres de creatininemie
IRA insuffisance renale aigue sous-estiment !'importance de !'alteration de la fonction renale.
IRC insuffisance renale chronique
Ku! coefficient d'ultrafiltration Objectifs de l'epuration extrarenale
OAP CEdeme aigu du poumon
PAN poly-acrylo-nitrile a
L'EER repond des objectifs multiples dont l'importance varie dans le temps:
PM poids moleculaire
• epurer des substances endogenes toxiques pour l'organisme ,, ;
PMMA polymethylmethacrylate «
• assurer l'homeostasie du milieu interieur (potassium, sodium, acide-base et
PTM pression transmembranaire
~~aj; . I
Qd debit du dialysat
Qs debit sanguin • centraler la volemie ;
SCD slow continuous dialysis • permettre la nutrition ;
SORA syndrome de detresse respiratoire aigue • trailer le sepsis ;
SLED slow low efficiency dialysis • epurer des « substances toxiques exogenes ,, (indications non renales
SLEDD slow extended daily dialysis d'EER).
SMC synthetically modified cellulose Dans un premier temps, les objectifs principaux sont :
TCA temps de cephaline active • le contrale des desordres metaboliques (hyperkaliemie, acidose, hyponatre-
TRU taux de reduction de l'uree mie);
UF ultrafiltration • le traitement de l'hypervolemie :si elle existe ;
Vd volume de distribution • le maintien de l'equilibre volemique ;
VP volume plasmatique • l'epuration des dechets azotes.
• Oligoanurie sur 12 h.
Figure 1. Relation entre creatininemie plasmatique et filtration glome
a
rulaire. • Dysnatremies associees une IRA (Na < 115 ou > 160 mmol/1).
• Complications uremiques:
- pericardite ; neuropathie/myopathie ;
Creatinine
- coma ou crises convulsives (encephalopathie) :
(µmol/1)
- hemorragie digestive.
800
Autres criteres 121
700
• Uree > 30 mmol/1.
• Application des criteres du groupe ADQI (classification F de RIFLE) : ele
vation de plus de 3 fois la valeur de la creatinemie ; diminution du debit de
filtration glomerulaire de 75 % ou creatininemie > 352 µmol/1 ou diurese
< 0,3 ml/kg/h pendant 24 h ou anurie > 12 h.
Depuis plus de 30 ans, ii est conseille de debuter l'EER avant que les chiffres
d'uree n'atteignent 35 mmol/1 [3]. Cela permet de reduire la frequence des
complications en particulier hemorragiques ei peut-etre la mortalite (4, 5].
Deux facteurs sont impliques dans ces eludes : l'inten.site du syndrome ure
mique biologique et la precocite de mise en place de l'EER. La precocite de
Filtration glomerulaire (ml/min) mise en oouvre de l'EER en reanimation semble etre uh element important a
- Cfe at 100 ➔ 200µmolll = baisse de 50% FG
prendre en compte (6-8]. ·
- Creal 800 ➔ 900 µmol/1 = baisse de 10% F
En resume, ii est recommande de debuter l'EER dans les situations
su iv antes : ·
Dans un deuxieme temps, la poursuite de l'EER permet de maintenir l'homeos • l'IRA est compliquee d'OAP ;
a
tasie du milieu interieur, d'aider la ma1trise des variations volemiques et de • ii exfste une hyperkaliemie menayante ;
permettre la nutrition artificielle. • les chiffres de creatinine s'elevent rapidement ;
• l'oligoanurie est persistante (12 h):
a
Criteres d'epuration extrarenale • ii existe des troubles metaboliques multiples associes l'IRA;
• les chiffres d'uree sont > 35 mmol/1. '
De plus, la tendance actuelle est de recommander de debuter l'EER precoce
Les criteres d'initiation de l'EER releves dans les eludes sont Ires variables et
ment chez les malades de reanimation.
souvent assez peu precis.
Criteres classiques de recours a
l'epuration extrarenale 11, 21
• Hyperkaliemie symptomatique ou > 6,5 mmol/1. /
• lideme aigu du poumon (OAP) de surcharge, surtout en cas d'anurie.
• Acidose metabolique intense (pH < 7, 1) .
References Catheters d'epuration ·
extrarenale
Lameire N, Van Biesen W, Vanholder R. Acute renal failure. Lancet 2005; 365: 417-
30.
2 Guerin C. Ouand debuter une epuration extrarenale? In: Robert R, Honore P, Bastien 0, a
eds. Les circulations extracorporelles en reanimation. Paris : Elsevier : 2006. p. 91-8. L'epuration extrarenale (EER) impose le recours un acces vasculaire permet
3 Kleinknecht D, Jungers P, Chanard J, et al. Factors influencing immediate prognosis tant un haul debit sanguin (> 150 ml/min en general). Dans le contexte de la
in acute renal failure with special reference to prophylactic hemodilaysis. Adv Nephrol reanimation, les catheters veineux centraux constituent generalement le seul
Necker Hosp 1971 ; 1 : 207-30.
acces vasculaire rapidement utilisable pour l'EER.11 existe deux types de cathe
4 Van Bommel EFH, Bouvy ND, So KL, Vincent HH, Zieste R, Bruining HA, et al. High a
ter adaptes l'EER : les catheters temporaires plutot destines aux pathologies
risk surgical acute renal failure treated by continuous arteriovenous hemodiafiltration:
metabolic control and outcome in sixty patients. Nephron 1995: 70: 183-90. aigues et les catheters implantes pour un usage prolonge (pathologie chroni
5 Kresse S, Schlee H, Deuber HJ, Koall W, Osten B. Influence of renal replacement therapy que). Nous n'aborderons dans ce chapitre que les aspects correspondant aux
on outcome of patients w,i!h acute renal failure. Kidney International 1999: 56: 75S- catheters temporaires qui sont les plus utilises en milieu dereanimation.
78S.
Le choix du catheter et de la voie d'abord influe beaucoup sur l'efficacite de
6 Gettings LG, Reynolds HN, Scalea l Outcome in post-traumatic acute renal failure when a
continuous renal replacement therapy is applied early vs. late. Intensive Care Med 1999; l'EER. De plus, !'utilisation d'un catheter d'EER inadapte aboutit de frequentes
25: 805-13. alarmes sur le circuit d'aspiration du sang (alarmes de pressions trap negati
7 Bouman CSC, Oudemans-van straaten HM, Tijssen JGP, et al. Effects of early high vo ves avant la pompe). Ces alarmes exaspereht l'equipe soignante et engendrent
lume continuous venovenous hemofiltration on survival and recovery of renal function
des arr@ts repetes ou des irregularites du flux sanguin extracorporel, accele1ant
in-intensive care patients with acute renal failure: a prospective, randomized, trial. Grit
Care Med 2002 : 30 : 2205-11. · les phenomenes de coagulation sur la membrane d'epuration [1 ]. Le choix de
8 Oemirkilic U, Kuralay E, Yenicesu M, et al. Timing of replacement therapy for acute renal l'abord vasculaire peut done fortement influencer le vecu des EER par l'equipe
failure after cardiac surgery. J Card Surg 2004: 19: 17-20.
soignante.
a
Nous al Ions aborder successivement dans ce chapitre les principaux elements
conna1tre pour mieux choisir le catheter d'EER (polymere, diametre,longueur), le
site d'insertion et les soins pour une meilleure prevention des dysfonctions.
Choix du catheter
Types de catheter
On peut utiliser en EER :
• un catheter monolumiere avec un flux sanguin alternatif. Ce type de catheter,
encore assez utilise chez les dialyses chroniques, est de mains en mains
utilise en milieu de reanimation. En effet, ce type de debit est incompatible
avec la majorite des machines d'epuration continue."De plus, les debits san
guins restent assez limites (150 a.200 ml/min);
• deux catheters monolumieres inseres sur deux veines differentes ou sur
la meme veine avec des orifice~ d'aspiration et de restitution de sang eloi
gnes d'au mains 2 cm. L'avantage de ·ce type d'abord est de permettre un
flux sanguin con~inu assez eleve. De plus, on peut tunneliser les catheters.
IJnconven ient de cette solution est la necessite d'un double abord veineux, Ces incompatibilites chimiques ant motive le developpement de copolymeres
a
augmentant les temps d'insertion et les risques lies la catheterisation ; de polyurethanes-polycarbonates(exemple: carbothane) qui ne presentent plus
• un catheter bilumiere. Ces catheters ont longtemps eu des performances d'incompatibilite avec les solutes iodes ou alcooliques et permettent, du fail de
assez limitees (debits sanguins < 250 ml/min) du fail de leur faible diametre leur plus grande resistance, une reduction de l'epaisseur de la paroi du catheter.
a a
(11 12 F). On assiste cependant !'apparition depuis quelques annees de
a
nouveaux catheters bilumieres ayant un diametre plus large (13,5 14 F), per Determinants du flux sanguin :
mellant done des debits sanguins nellerr:ient plus importants. Celle solution
longueur et diametre du cath~ter,
reste la plus simple et la plus·u tilisee.
position ·
Tableau 1
a
La loi de Poiseuille permet de determiner le.d ebit sanguin pass.ant travers
lncompatibilites chimiques des polymeres utilises [2]
un catheter.
r,i:;. ·;· ,it,~ "/. -.
On peut voir d'apres celle equation que le diametre du catheter joue un rOle
Polymere majeur. En effet, une augmentation de 19 % du diametre permet de doubler le
debit sanguin. lnversement, une thrombose interne mijme limitee (depots de
Le polymere utilise conditionne largement la rigidite des catheters d'EER. Line fibrine}, reduisant de 19 % le diametre de la lumiere interne du catheter, divise
trop grande rigidite augmente les risques de perforation des veines ou de le flux sangu in par deux.
l'oreillelle droite, alors qu'une rigidite insuffisante rend !'insertion plus difficile. Par ailleurs, si l'on desire utiliser un catheter deux fois plus long, ii suffit
Les catheters d'EER utilises en milieu de reanimation sont generalement en d'augmenter le diametre de 19 % pour obtenir le m~me debit sanguin.
polyurethane ou en silicone. Le polyurethane est un polymere dont la rigidite II est done fondamental de choisir un catheter de diametre suffisant selon !'in
est Ires variable selon la procedure de fabrication. De plus, le polyurethane a dication et le type d'EER qui sera realise.
a
des proprietes thermoplastiques, devenant plus souple la temperature cor~
a
porelle par rapport la temperature ambiante. Les catheters en silicone sont
generalement plus souples que les catheters en polyurethane. Leur insertion
necessite souvent l'emploi d'un dilatateur rigide.
II existe une incompatibllite chimique entre certains polymeres et les solutes
utilises comme antlseptiques lors des pansements (21: les polyurethanes sont
degrades par les alcools et le polyethylene glycol (pommades, gels), les si Ii
a
cones sont incompatibles avec les solutes iodes et un moindre degre avec la
polyvidone iodee (Betadine®, voir tableau 1). Celle incompatibilite se manifeste Les deux determinants principaux du debit sanguin obtenu sur un ca\he
essentiellement par des possibilites de perforation du catheter en cas d'applica, ter sont !e diametre interne de la lumiere et la position de l'extremtte du
tions repetees et prolongees d'antiseptiques incompatibles (surtout s6us forme catheter. En effet, !'aspiration dU:sang cree une depression auteur des orifi-
de solution visqueuse ou de pommades) sur leur point d'insertion.
.,
ces d'aspiration des cath.eters veineux, rendant possible un collapsus de la Selection du site d'insertion
paroi veineuse autour du catheter. Plus le debit sanguin est important autour
des orifices d'aspiration, plus la probabilite de collapsus est faible. Ainsi, Chez les patients presentant un risque d'insuffisance renale definitive, par
la position ideale de l'extremite d'un catheter d'EER est l'oreillette droite. exemple les patients ayant une nephropathie prealable, les recommandations
Classiquement, cette position etait consideree comme dangereuse du fail actuelles sont d'eviter !'utilisation des veines sous-clavieres [3]. En effet, le
des risques de perforation de l'oreillette droite. Cependant, !'utilisation de taux de stenose veineuse observee apres insertion d'un catheter d'EER sur
a a
catheters recants, Ires souples (generalement en silicone), permet de mini une veine sous-claviere est de 42 50 %, centre 0 10 % pour une veine
miser ces risques de perforation. jugulaire [3). Ces stenoses sous-clavleres limitent considerablement les pos
' La position rec, , omrnia/:i n,d ee1 • ~'.,s ~-t d,(o' ni:: ,• •,;;· ,,:; : ye,' in, ~.J',::i:a, v.;e:/ fM;,:::•,~ ,:tjl:~!{ ,u• :•:r:,e ,Jiour le. s :!, sibilites de realisation de fistule arterioveineuse en cas d'evolution vers une
"catMtel:$' t,einorau* ~t laj oo Hi .lai!reitfil tda'.V:e slupeiier~r e et J, 1 insutfisance renale chronique.
~ • :·' 1:I9'' "!,i,ll~'\ ~I ~, roIl tei ;,p!, u,r' ; ~~-p,~""·~J._,, ~r'~' '~:•~:,:,p )n!:•, J~I•! J1!P\:,, (~,tu:• ~,,[:3 ' J1i. i',f'> (' 1~ fLeem cohraoliexs .d uL as itvee ienset djuognuela siroeu vinetnetr nliem igtea uacuhxe vaei nloensg tjeurgnuplas ireetse iAcolenrsniedse reoeu
a
Ainsi, un catheter jugulaire interne gauche necessite une longueur de 4 comme peu appropriee pour !'insertion d'un catheter d'EER, du fail de la dou
5 cm de plus qu'un catheter jugulaire interne droit pour atteindre l'entree de ble courbure imposee au trajet de ce dernier. Cependant, l'utilisation de cathe
a a
l'oreillette droite. L'acces la veine cave inferieure par une ponction femorale ters recents plus souples et d'une longueur suffisante (4 5 cm de plus qu'en
a
necessite l'utilisation de catheters d'une longueur superieure 20 cm. Le plus jugulaire interne droite) permet d'.utiliser la veine jugulaire interne gauche de
souvent, ii taut done privilegier une longueur de 24 ~ 28 cm pour s'assurer man iere satisfaisante.
d'un debit vasculaire suffisant autour d'un catheter femoral. Pour les catheters d'EER utilises eil reanimation, ii existe peu de donnees sur
La recirculation remet au contact de la membrane un plasma deja epure. Plus le risque infectieux selon le site utilise. Une elude sur 218 patients consecutifs
le taux de recirculation e~t eleve, plus le debit sanguin efficace est faible. (318 catheters, 6235 jours au total) constate un risque relatif de bacteriernie
a
Le taux de recirculation est influence par : de 3, 1 pour les catheters femoraux (interval le de confiance [IC) a 95 % : 1,8
• la distance entre les orifices d'aspiration et de reinjection du sang sur le 5,2) par rapport aux catheters_jugulaires internes (5). Ces donnees orit motive
catheter. Plus cette distance est elevee, moins ii ya de recirculation ; les recommandations actuelles de la National Kidney Foundation de reserver
• le debit sanguin dans le vaisseau ou se situe l'extremite distale du catheter. les catheters femoraux aux patients confines au lit et de ne pas les maintenir
II taut que le debit sanguin autour de l'exiremite distale du catheter soil net plus de 5 jours [3).
tement plos important que le debit sanguin extracorporel. On voit ainsi que .
l'orei llette droite est la situation ideale pour l'extremite interne du patheter. Insertion du catheter
a
Ainsi, les taux de recirculation mesures ont et~ de 4 5 % avec des·catheters
jugulaires internes ou sous-claviers, centre 1O % pour des catheters femoraux i
Le tableau 2 resume les principales complications pouvant @Ire liees !'inser-
de 24 cm et 18 % avec des catheters femoraux de 15 cm [4).
tion du catheter. I
On peut par ailleurs souligner que !'inversion des lignes (aspiration sur la voie
L'experience de l'operat~ur semble @Ire le principal facteur ·1ie au risque de
bleue et retour sur ·1a voie rouge du catheter) augmente nettement le taux de
complication. Le guidage echographique de !'insertion semble diminuer net
recirculation(+ 20 % pour un catheter jugulaire interne droit). Celle inversion
tement la frequence de ces complications. Une revue des eludes randomisees
des lignes peut @Ire utilisee ponctuellement pour terminer une EER, mais elle
a concernant !'insertion echoguidee constate un risque relatif de complication
doit donner lieu une analyse de la cause de dysfonction du catheter afin
de 0,22 (IC a 95 %, 0,10 a 0,45) par rapport a !'insertion non guidee par
d'eviter son usage trop repete.
l'echographie [6]. II semble done prudent. lorsque cela est possible (disponi
Chez les patients en bas ~ebit_cardiaq·ue, la fai~le vitesse de circu,l_ation_san1
bilite du materiel adequat), d'utiliser un "reperage echographique !ors de !'in
guine auteur du catheter indu1t une augmentation du taux de rec1r5u1atLo,n.
sertion des catheters d'EER [3J. :
Tableau 2 pour les catheters jugulaires et sous-claviers). Ces positions incorrectes
Complications liees al 'lnsertion d'un catMter' d'epuration extrarenale •so:nt le plus souvent dues a une longueur insuffisante des catheters utili-
'
Mllposition du calhdter • une hypovolemie avec collapsus veineux autour du catheter. II est alors pos
~•d u sile,de poncll sible d'obtenir un debit sanguin extracorporel adequat apres un remplissage
~oral<· n~ t>m6dl vasculaire.
'"- a
Les dysfonctions tardives sont generalement dues une thrombose. Ces
H6mothorax; hl!monl6diastln
thromboses peuvent etre internes au catheter ou, plus rarement, externes.
~6mat?rries' II est generalement reconnu que l'extremite d'un catheter (surtout si elle est
Embolle rigide).p eut provoquer des lesions sur !'endothelium vasculaire et engendrer
~du une thrombose extrinseque. La prevention de ces thromboses repose sur une
Arythm1es insertion soigneuse, l'ulilisation d'un catheter souple et les mesures genera
le~ de prophylaxie des thrombophlebites (les heparines de bas poids mole
Arri cardiaq
culaire ont un risque d'accumulation chez l'insuflisant renal). Le traitement
des thromboses veineuses constituees est fonde sur !'ablation du catheter et
Les variations anatomiques peuvent expliquer une partie des complications
une anticoagulation d'au mains 1 mois, avec verification echographique de la
observees lors d'une insertion non echoguidee. En effet, dans une etude echo a
resolution de la thrombose [8). Ces thromboses veineuses sont clairement
graphique realisee chez 104 patients, la frequence des variations anatomiques
differencier des minces gaines de fibrines pouvant se constituer autour deS
de la jugu!aire interne pouvant gener !'insertion d'un catheter a ete de 26 %
catheters, generalement apres plusieurs jours. Ces gaines peuvent gener le
(7). De plus, en cas de catheterisation prealable de la veine, la frequence des
fonctionnement du catheter, mais ne necessitent pas d'anticoagulation prolon
thromboses veineuses genant la ponction peut atteindre 18 %.
gee apres ablation du catheter.
Les thromboses internes au catheter sont les causes les plus frequentes de
Dysfonctlon du catheter
dysfonction tardive. Ces thromboses peuvent toucher la lumiere interne du
catheter ou les orifices d'aspiration.
On parle de dysfonction lorsqu'il est impossible d'obtenir un debit sanguin La prevention de ces thromboses repose sur une injection vigoureuse de
adequat avec un catheter d'EER (debit insuflisant avec de frequentes alarmes). 10 ml de NaCl 9/1000 sur chaque voie apres chaque utilisation, suivie de la
Les dysfonctions peuvent etre precoces, c·est-a-dire des la premiere utilisa mise en place d'un verrou d'antlcoagulant dans chaque lumiere du cathe
« »
tion du catheter ; ou tardives, apres une premiere utilisation satisfaisante. ter. Le volume de !'anticoagulant doit etre ajuste sur le volume de la lumiere
a
Les causes de dysfonction precoce peuvent etre : interne du catheter (inscrit sur la brochure, generalement de 1 2 ml pour
• une coudure du catheter sur son trajet. Cette eventualite est rare en position les catheters non tunnelises). Cependant, meme avec un volume bien ajuste,
femorale ou jugulaire interne droite. II taut alors verifier soigneusement le les eludes recentes suggerent qu'environ 75 % du verrou mis en place sont
a
trajet du catheter pour deceler les coudures a !'examen clinique ou l'aide relargues dans la circulation systemique du patient en 30 min [9].
d'une radiographie. On peut parfois corriger ces coudures en retirant de Les verrous d'anticoagulant utilises actuellement sont essentiellement de deux
a a
1 ou 2 cm le catheter. Le caractere thermoplastique de certains catheters les types: les solutions d'heparine (1000 10 000 unites/ml) ou les solutions
a
rend plus souples apres leur insertion et facilite la correction des coudures. base de citrate (citrate trisodique, solution de 30 45 %). Le choix du verrou
a
Cependant, ces anomalies sont parfois impossibles corriger de maniere doit tenir compte du relargage systemique de la plus grande partie du verrou
satisfaisante et imposent l'insertion d'un autre catheter: utilise. Ainsi, par rapport aux solutions ayant une faible concentration d'Mpa
a
• une mauvaise position de l'extremite du catheter (idealement dans la velne rine (:5'. 1000 Ul/ml), les solution~ d'heparine concentree (5000 10 000 UI/
a a
cave inferieure pour les catheters femoraux ou l'entree de l'oreillette droite ml) semblent associees un risque plus faible de thrombose interne au cathe
a
ter, mais aussi un _risque d'hemorragi~_plus eleve chez le patient [10].