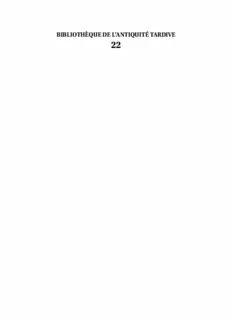Table Of ContentBIBLIOTHÈQUE DE L’ANTIQUITÉ TARDIVE
22
BIBLIOTHÈQUE DE L’ANTIQUITÉ TARDIVE
PUBLIÉE PAR L’ASSOCIATION POUR L’ANTIQUITÉ TARDIVE
c/o Bibliothèque d’Histoire des Religions de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
28, rue Serpente 75006 Paris (France)
Cette collection sans périodicité régulière, éditée par Brepols Publishers, est conçue comme la série de suppléments à la
revue Antiquité tardive publiée depuis 1993 par l’Association chez le même éditeur. Elle est composée de monographies,
de volumes de Mélanges ou de Scripta Varia sélectionnés soit par l’Association avec l’accord de l’éditeur soit par l’éditeur
avec l’agrément de l’Association dans le domaine de compétence de l’Association : histoire, archéologie, littérature et
philologie du IVe au VIIIe siècle (de Dioclétien à Charlemagne). Un conseil scientifique procède à la sélection et supervise
la préparation quand elle est assurée par l’Association, sous la responsabilité du Conseil d’Administration dont voici la
composition actuelle :
Président : François BARATTE, professeur d’archéologie de l’Antiquité tardive à l’Université Paris-Sorbonne.
Vice-présidente : Gisella CANTINO WATAGHIN, professora di archeologia all’Università degli studi del Piemonte Orientale
“A. Avogadro”, Vercelli.
Secrétaire : Thierry RECHNIEWSKI, ingénieur.
Trésorier : Marc HEIJMANS, ingénieur de recherches au CNRS, Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence.
Jean-Pierre CAILLET, professeur d’histoire de l’art médiéval à l’Université Paris-Ouest.
Jean-Michel CARRIÉ, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.
Jutta DRESKEN-WEILAND, Prof. Dr. Université de Göttingen.
Alan Simon ESMONDE CLEARY, Professor at the University of Birmingham.
Hansgerd HELLENKEMPER, Direktor Emeritus, Römisch-Germanisches Museum Köln.
Gisela RIPOLL, profesora titular, Universitat de Barcelona.
Jean TERRIER, archéologue cantonal de Genève.
BIBLIOTHÈQUE DE L’ANTIQUITÉ TARDIVE
22
LE CHEVAL DANS LES SOCIÉTÉS ANTIQUES
ET MÉDIÉVALES
ACTES DES JOURNÉES D’ÉTUDE INTERNATIONALES
ORGANISÉES PAR L’UMR 7044
(ÉTUDE DES CIVILISATIONS DE L’ANTIQUITÉ)
Strasbourg, 6-7 novembre 2009
Sous la direction de
Stavros Lazaris
Préface de
Cécile Morrisson
F
© 2012, Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without the prior permission of the publisher.
D/2012/009527
ISBN 978-2-503-54440-3
Printed on acid-free paper
TABLE DES MATIÈRES
PRÉFACE
Cécile Morrisson .............................................................................................................................................................9
EN GUISE D’INTRODUCTION
Essai de mise au point sur la place du cheval dans l’Antiquité tardive ......................................................................15
Stavros Lazaris
LE CHEVAL, ANIMAL DE GUERRE ET DE LOISIR
Chevaux de guerre et chevaux de course dans l’Antiquité grecque ............................................................................27
Roland Étienne
Le cheval dans la guerre gréco-romaine : vers une lente spécialisation de la cavalerie ............................................39
Emmanuelle Furet
Des chevaux du cirque : économie et passions à Rome ................................................................................................61
Michel Matter
L’emploi de la cavalerie romaine d’après les Res Gestae d’Ammien Marcellin.........................................................73
Alain Chauvot
LE CHEVAL DANS LES SOCIÉTÉS MÉDIÉVALES OCCIDENTALES
The Horse in the Byzantine world ..................................................................................................................................87
Taxiarchis G. Kolias
La dame et le destrier : les plus nobles conquêtes du chevalier ...................................................................................99
Georges Bischoff
La chevalière au Moyen Âge : entre fantasme et réalité ............................................................................................105
Ludivine Fest
Loger, nourrir, équiper le cheval : un essai de synthèse pour la seconde partie du Moyen Âge ...........................113
dans l’Est de la France et ailleurs
Jean-Jacques Schwien et Yves Jeannin
ÉQUIPEMENTS ÉQUESTRES, ARMES ET HIPPIATRIE
Les étriers byzantins : la documentation du Balkan central .....................................................................................135
(cid:57)(cid:88)(cid:77)(cid:68)(cid:71)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:44)(cid:89)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:227)(cid:72)(cid:89)(cid:76)(cid:252)(cid:3)(cid:72)(cid:87)(cid:3)(cid:44)(cid:89)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:37)(cid:88)(cid:74)(cid:68)(cid:85)(cid:86)(cid:78)(cid:76)
6 TABLE DES MATIÈRES
(cid:48)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:72)(cid:89)(cid:68)(cid:88)(cid:91)(cid:3)(cid:71)(cid:182)(cid:112)(cid:83)(cid:82)(cid:84)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:87)(cid:82)(cid:69)(cid:92)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:29)(cid:3)(cid:79)(cid:182)(cid:72)(cid:91)(cid:72)(cid:80)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:38)(cid:68)(cid:85)(cid:76)(cid:254)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:42)(cid:85)(cid:68)(cid:71) ...............................................................143
Bernard Bavant
Lat. - griech. SCALA als spätantike Bezeichnung für den Steigbügel ....................................................................155
und die Benennungen des Steigbügels bei anderen Völkern
Ulrich Kraft
Les armes et les techniques de combat des guerriers steppiques du début du Moyen-âge. ..................................193
Des Huns aux Avars
(cid:48)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:72)(cid:79)(cid:3)(cid:46)(cid:68)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:78)(cid:76)
La monture des saints cavaliers dans l’art byzantin .................................................................................................201
Catherine Vanderheyde
Contribution à l’étude du lexique hippiatrique grec .................................................................................................213
Anne-Marie Doyen-Higuet
Index ...............................................................................................................................................................................223
Figures.............................................................................................................................................................................233
REMERCIEMENTS
Au moment où j’achève cet ouvrage, ma reconnaissance J’ai plaisir aussi à remercier Jean-Pierre Caillet, direc-
va d’abord aux deux directeurs successifs de l’UMR 7044 teur de la collection Bibliothèque de l’Antiquité tardive, et
(Étude des civilisations de l’Antiquité : de la préhistoire à Christophe Lebbe des éditions Brepols qui ont accueilli
Byzance), Dominique Beyer et Anne-Marie Adam, qui avec bienveillance cet ouvrage.
m’ont soutenu sans relâche tout au long du programme de Mes remerciements les plus vifs s’adressent aussi à
recherche Les équidés dans l’Antiquité tardive et à Byzance Aude Gräzer-Ohara qui m’a été d’une grande aide pour
(2007-2009). Les Journées internationales d’étude et les mettre aux normes éditoriales les contributions. Elle a été
Actes de celles-ci sont le résultat immédiat de ce pro- par ailleurs une lectrice attentive et un soutien bien heureux
gramme qui a permis d’évaluer la place du cheval pour la durant toute la préparation de cette publication. Les
guerre et les loisirs. échanges que j’ai eu avec Gérard Siebert et Dominique
Cécile Morrisson avait accepté de prononcer les conclu- Lenfant ont été pour moi d’une aide précieuse également.
sions de ces Journées et de préfacer les Actes. Qu’elle soit (cid:40)(cid:81)(cid:191)(cid:81)(cid:15)(cid:3)(cid:88)(cid:81)(cid:3)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:85)(cid:70)(cid:76)(cid:3)(cid:106)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:85)(cid:76)(cid:72)(cid:16)(cid:45)(cid:82)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:84)(cid:88)(cid:76)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:87)(cid:3)
vivement remerciée. De même, je tiens tout particulière- ouvrage dans sa dernière mouture et m’a permis d’en sup-
ment à remercier les autres byzantinistes strasbourgeois qui primer bien des imperfections.
ont accepté de participer à ce programme de recherche, Toute ma gratitude va à ma famille et notamment à ma
ainsi que tous les collègues grâce auxquels cet ouvrage a femme dont l’infatigable concours a été pour moi un encou-
pu voir le jour. ragement constant et une aide inestimable.
PRÉFACE
Les journées internationales d’étude organisées à Stras- blesses naturelles du cheval pour aider le cavalier à mieux
bourg les 6 et 7 novembre 2009 à l’initiative de Stavros (cid:87)(cid:76)(cid:85)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:191)(cid:87)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:68)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:17)
Lazaris prennent la suite de deux colloques réunis à l’École Le rôle du cheval, que ce soit dans la guerre, les courses
française d’Athènes en 2003 puis à l’université de Mont- puis les jeux du cirque et le transport, a occupé plusieurs
pellier en 20071. Cette continuité s’exprimait formellement historiens durant ces Journées aussi bien en ce qui concerne
dans la permanence du titre, puisque l’invitation de 2009 la Grèce ancienne (R. Étienne) que Rome (F. Furet, M. Mat-
portait déjà l’intitulé « Les équidés dans l’Antiquité tardive ter), Byzance (T. Kolias) ou l’Occident médiéval (L. Fest,
et à Byzance », mais il fallut bien se rendre à l’évidence : G. Bischoff, J.-J. Schwien et Y. Jeannin).
malgré leurs services éminents dans le domaine des trans- Plusieurs études apportent ici une information détaillée
ports quotidiens et modestes, l’âne et les dérivés de ses sur les effectifs en cause, leur évolution et l’importance
croisements avec la gent hippique n’avaient pas encore croissante de la cavalerie. Ainsi, dans l’ancien modèle re-
(cid:74)(cid:68)(cid:74)(cid:81)(cid:112)(cid:3)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:76)(cid:74)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:76)(cid:191)(cid:84)(cid:88)(cid:72)2 ni conquis l’intérêt des cher- tracé par E. Furet, la cavalerie ne représentait encore qu’une
cheurs. Aussi le cheval, qui mériterait plus encore que le unité d’élite minoritaire (un quart des effectifs en 400
lion, le titre de roi des animaux – du moins de notre point d’après la Notitia dignitatum). Les cavaliers cuirassés, ca-
de vue d’êtres humains – a-t-il suscité la majorité des tafractarii et clibanarii, sont déjà une unité d’élite qui n’est
contributions et par conséquent forcé à adopter un titre pas toujours employée à bon escient ni bien coordonnée
(cid:71)(cid:112)(cid:191)(cid:81)(cid:76)(cid:87)(cid:76)(cid:73)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:88)(cid:86)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:88)(cid:17) (cid:68)(cid:89)(cid:72)(cid:70)(cid:3)(cid:79)(cid:182)(cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:72)(cid:87)(cid:3)(cid:84)(cid:88)(cid:76)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:182)(cid:82)(cid:69)(cid:77)(cid:72)(cid:87)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:112)(cid:191)(cid:68)(cid:81)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:86)(cid:3)
Vu la place occupée par le cheval dans la guerre, les raisons politiques, comme le montre A. Chauvot4. Les che-
loisirs, les transports, les pratiques agricoles3(cid:3)(cid:72)(cid:87)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:192)(cid:72)(cid:87)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3) vaux des courses et des jeux du cirque ont attiré l’attention
celle-ci dans l’imagerie et l’imaginaire, le thème est im- (cid:87)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:3)(cid:106)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:88)(cid:85)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:53)(cid:17)(cid:3)(cid:101)(cid:87)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:72)(cid:87)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:48)(cid:17)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:40)(cid:81)(cid:191)(cid:81)(cid:15)(cid:3)(cid:74)(cid:85)(cid:107)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:106)(cid:3)(cid:86)(cid:68)(cid:3)
mense et suscite un intérêt croissant. Il a été abordé par les familiarité avec les textes militaires de tactique et polior-
chercheurs strasbourgeois et leurs invités essentiellement cétique ou encore avec les traités d’interprétation des rêves,
sur deux grandes périodes et zones géographiques : l’An- T. Kolias clôt la première partie en proposant un panorama
tiquité gréco-romaine et la haute époque byzantine, entre fort utile de la place du cheval à Byzance.
la Méditerranée et le monde des steppes d’une part, l’Oc- Malgré une importance déterminante dans notre connais-
cident médiéval de l’autre. L’archéologie, les textes ou la sance sur la place du cheval dans les civilisations antiques
linguistique, et l’iconographie ont été parallèlement ou si- et médiévales, l’analyse économique systématique de la
multanément mis à contribution dans les trois parties qui production et de l’usage des chevaux (élevage, prix,
composent l’ouvrage. Elles sont précédées d’une introduc- contraintes de leur utilisation5) ou encore de la proportion
tion qui se réfère au programme de recherche qui a précédé dans laquelle son achat et son entretien pesaient sur les
ces Journées d’étude et les objectifs poursuivis pendant sa budgets des États est encore à réaliser. Le « cheval et l’ar-
durée. Dans son introduction, S. Lazaris propose une syn- gent » constituera d’ailleurs le thème d’une prochaine ren-
thèse sur les recherches menées tout au long de ce pro-
gramme pour comprendre comment la cavalerie romaine
d’abord, byzantine ensuite, a su compenser certaines fai- 4. Sur les critiques qui s’expriment encore au VIe siècle dans des
textes comme le Dialogue sur la Science politique du patrice
Ménas, voir ZUCKERMAN 2004. Sur ce traité, voir MAZZUCHI 1982.
Procope, lui, s’en prend aux réactionnaires qui déplorent la vertu
perdue des anciens fantassins combattant corps-à-corps, et qui
1. Tous deux publiés : voir GARDEISEN (éd.) 2005 et GARDEISEN et ridiculisent les archers de leur temps. Or ces archers, bien
al. (éd.) 2010. protégés et polyvalents car armés, en plus de l’arc, d’une épée
2. Selon les témoignages archéologiques l’âne apparaît en France et d’une lance, représentent le sommet de la «technologie»
seulement au cours du VIIe siècle et ne devient courant qu’à moderne pour cette époque et leur atout principal consiste dans
l’époque carolingienne (ARBOGAST et al. 2002, p. 7-8). le fait qu’ils sont montés et sont d’excellents cavaliers (Bella I,
3. Ce dernier rôle ne concernant pas pour des raisons climatiques 1, 6-17).
évidentes le monde méditerranéen (voir remarque de T. Kolias, 5. Sur les contraintes logistiques, voir HALDON 2005, HALDON 2006
infra, p. 89). et HALDON 2010.
10 PRÉFACE
contre (prévue dans le cadre d’une collaboration entre auraient adopté au Ve siècle, sans doute par l’intermédiaire
T. Kolias et S. Lazaris)6. À propos de l’élevage en tout cas, de leurs fédérés alains ou germains de la région danubienne
un consensus se dégage sur le fait qu’il n’y a pas à propre- – et non par celui des Perses, comme on le suppose géné-
ment parler, aux époques traitées, de « races » mais plutôt ralement – le mors à aiguilles de forme 1. C’est au contraire
des régions spécialisées et plus ou moins réputées telles en auprès de ces derniers qu’ils auraient emprunté la forme 2
Grèce (R. Étienne), et à Byzance la Thrace, la Cappadoce, de ce mors avant de la diffuser à leur tour. Quant à la
la Phrygie (T. Kolias et S. Lazaris), au bas Moyen Âge, (cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:72)(cid:3)(cid:22)(cid:15)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:112)(cid:72)(cid:3)(cid:106)(cid:3)(cid:38)(cid:68)(cid:85)(cid:76)(cid:254)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:42)(cid:85)(cid:68)(cid:71)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:69)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:3)
l’Italie, l’Espagne ou la France (J.-J. Schwien et Y. Jean- datées entre le règne de Justin II et le début de celui de
nin). (cid:48)(cid:68)(cid:88)(cid:85)(cid:76)(cid:70)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:68)(cid:89)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:84)(cid:88)(cid:182)(cid:72)(cid:79)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:191)(cid:74)(cid:88)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:81)(cid:112)(cid:70)(cid:85)(cid:82)(cid:83)(cid:82)(cid:79)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:74)(cid:72)(cid:85)-
L’ouvrage s’inscrit justement dans la longue durée et la maniques vers 590, elle paraît une innovation de détail
période moderne n’a pas été oubliée, toujours dans une intéressante à mettre au crédit des Byzantins. L’archéolo-
perspective pluridisciplinaire : images et textes associés par gue strasbourgeois met en lumière le rôle des alliés et fé-
L. Fest pour dresser le portrait de la « chevalière » médié- dérés de Byzance dans un scénario convaincant de ces
vale, ou par G. Bischoff pour celui, provocateur, de la dame emprunts croisés, première pierre de l’étude de l’équipe-
et du destrier comme les conquêtes du chevalier d’après les ment équestre de l’armée byzantine qu’il appelle de ses
documents des XIVe-XVe siècles. Revenant dans des do- vœux. Au corpus désormais bien édité des textes des traités
maines moins imaginaires, J.-J. Schwien et Y. Jeannin ont militaires9, à l’étude des armements qu’en a tiré T. Kolias
montré, dans une synthèse pionnière et à travers quelques dans un ouvrage classique10(cid:15)(cid:3)(cid:79)(cid:182)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:112)(cid:82)(cid:79)(cid:82)(cid:74)(cid:76)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:112)(cid:191)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:106)(cid:3)
exemples régionaux parlants, tout ce que l’archéologie mé- cet égard il y a vingt ans, commence d’apporter maintenant
diévale de l’est de la France et l’archéozoologie pouvaient le témoignage décisif d’éléments conservés et datés. Elle
apporter à la connaissance de la morphologie, de l’équipe- s’est insérée ici dans une étroite confrontation avec les
ment (éperons, fers), des écuries etc. Voici une piste à suivre sources textuelles ou iconographiques, souvent dans le
parmi bien d’autres dans un domaine qui suscite un intérêt même exposé ou au cours de discussions fructueuses. C’est
grandissant et sur lequel ce livre a le mérite d’avoir à nou- ainsi qu’U. Kraft conforte et complète ici les travaux ar-
veau attiré l’attention. chéologiques évoqués ci-dessus en étudiant en linguiste la
diffusion du terme skala dans le grec byzantin et le latin
Dans une perspective plus technique, les contributions tardif, et les autres dénominations de l’étrier notamment
de ce volume s’attachent tout particulièrement à éclaircir chez les peuples des steppes.
la transmission des équipements équestres, les armes du Nos connaissances sur les armes et l’équipement des
cavalier et le développement des connaissances hippolo- Huns ou des Avars, d’après le matériel des tombes du Da-
giques et hippiatriques aux IVe-VIe siècles, au moment où la (cid:81)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:3)(cid:77)(cid:88)(cid:86)(cid:84)(cid:88)(cid:182)(cid:106)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:57)(cid:82)(cid:79)(cid:74)(cid:68)(cid:3)(cid:11)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:15)(cid:3)(cid:192)(cid:113)(cid:70)(cid:75)(cid:72)(cid:86)(cid:15)(cid:3)(cid:112)(cid:83)(cid:112)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:3)(cid:72)(cid:87)(cid:3)(cid:69)(cid:85)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:15)(cid:3)
confrontation avec les peuples des steppes contraint l’em- (cid:112)(cid:87)(cid:85)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:112)(cid:89)(cid:82)(cid:84)(cid:88)(cid:112)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:48)(cid:17)(cid:3)(cid:46)(cid:68)(cid:93)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:17)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:79)(cid:74)(cid:85)(cid:112)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:70)(cid:72)(cid:83)(cid:87)(cid:76)-
pire à une transformation radicale de l’organisation de ses cisme parfois exprimé sur le peu de valeur historique des
unités, de leur équipement et de leurs méthodes de combat. sources iconographiques, C. Vanderheyde analyse les re-
Aussi, l’étrier qui permet d’abandonner la lance au pro- présentations des saints cavaliers dans l’art byzantin et peut
(cid:191)(cid:87)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:182)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:3)(cid:83)(cid:88)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:182)(cid:112)(cid:83)(cid:112)(cid:72)(cid:3)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:83)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:75)(cid:112)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:80)(cid:80)(cid:72)(cid:3) y déceler le perfectionnement du harnachement visible en
S. Lazaris le rappelle dans les pages qui suivent (p. 7)7, est Cappadoce au IXe-Xe(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:113)(cid:70)(cid:79)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:88)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:79)(cid:182)(cid:76)(cid:81)(cid:192)(cid:88)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:182)(cid:68)(cid:85)(cid:80)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)
un élément essentiel de cette adaptation de Byzance aux occidental au XIIe siècle, et rappeller le lien de la vogue du
techniques de « ceux d’en face »8. Or, les découvertes motif du saint cavalier transperçant un symbole du Mal
d’étriers de forme archaïque à repose-pied étroit dans le avec la situation historique de la frontière orientale. Dans
(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:91)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:79)(cid:112)(cid:3)(cid:72)(cid:87)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:73)(cid:68)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:112)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:38)(cid:68)(cid:85)(cid:76)(cid:254)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:42)(cid:85)(cid:68)(cid:71)(cid:3)(cid:11)(cid:44)(cid:88)(cid:86)- un contexte relevant de l’hippiatrie et à partir des textes
tiniana Prima, fondée vers 535 et abandonnée dès 615) techniques et d’une intime familiarité avec la pratique vé-
(cid:86)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:79)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:71)(cid:76)(cid:84)(cid:88)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:57)(cid:17)(cid:3)(cid:44)(cid:89)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:227)(cid:72)(cid:89)(cid:76)(cid:252)(cid:3)(cid:72)(cid:87)(cid:3)(cid:44)(cid:17)(cid:3)(cid:37)(cid:88)(cid:74)(cid:68)(cid:85)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:84)(cid:88)(cid:72)(cid:3) térinaire, s’insérant dans l’intérêt croissant pour les textes
dès cette époque, les Byzantins avaient intégré les étriers hippiatriques, illustré par ses propres travaux, ceux
en fer à leur équipement, tandis que d’autres trouvailles d’A. McCabe et de S. Lazaris11, A. Doyen-Higuet s’attache
serbes montrent que la production de ces types archaïques à l’analyse des termes décrivant l’anatomie du cheval et
continua jusqu’au Xe siècle. L’intermédiaire protoavare, tout particulièrement son pied ainsi que la marche et les
privilégié jusqu’ici dans l’historiographie, doit donc être défauts éventuels de celle-ci.
abandonné : les Byzantins eurent connaissance des étriers
en fer avant même l’arrivée des Avars dans les régions * * *
(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:88)(cid:69)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:106)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:191)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:88)(cid:3)VIIe siècle.
(cid:39)(cid:182)(cid:68)(cid:83)(cid:85)(cid:113)(cid:86)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:114)(cid:80)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:91)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:70)(cid:72)(cid:79)(cid:79)(cid:112)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:38)(cid:68)(cid:85)(cid:76)(cid:254)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:42)(cid:85)(cid:68)(cid:71)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:80)-
paré aux trouvailles germaniques d’une part et steppiques 9. DAGRON 1987 ; Maurice, Strategicon (éd. DENNIS 1984 ; DENNIS
de l’autre, B. Bavant offre une analyse quantitative des & GAMILLSCHEG 1981) ; MCGEER 1995b. Voir la récente mise au
différents types de mors pour démontrer que les Byzantins point de SULLIVAN 2010.
10. KOLIAS 1988.
11. DOYEN-HIGUET 2006 ; MCCABE 2007 et LAZARIS 2010. Voir
également LAZARIS 2007 et notamment LAZARIS 2011b, où
6. S. Lazaris aborde ce propos dans LAZARIS 2011a. l’auteur relie légitimement le développement de la littérature
7. Ainsi que dans son article : LAZARIS 2005. hippiatrique grecque et latine au IVe siècle, puis sa compilation
8. DAGRON 1987. Sur d’autres aspects de cette adaptation, voir au VIe siècle, et l’intérêt renouvelé des « encyclopédistes » du Xe
MCGEER 1988 et MCGEER 1995a. pour le développement de la cavalerie.
Description:These Actes des Journées d’étude internationales (Strasbourg, 6-7 November 2009) are the end result of a 2007-2009 research programme held at the UMR 7044 (Étude des civilisations de l’Antiquité: de la Préhistoire à Byzance) on the role of the horse in the Byzantine Empire. These fourteen