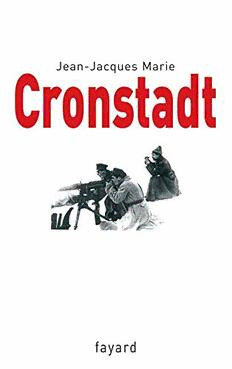Table Of ContentCRONSTADT
DU MÊME AUTEUR
Les Paroles qui ébranlèrent le monde, Seuil, coll. «L’Histoire immé-
diate», 1967.
Staline, Seuil, coll. «L’Histoire immédiate», 1967.
Les Bolcheviks par eux-mêmes (avec Georges Haupt), Maspero,
1969.
L’Affaire Guinzbourg-Galanskov (avec Carol Head), Seuil, coll.
«Combats», 1972.
LAffaire Pliouchtch (avecTania Mathon), Seuil, coll. «Combats»,
1976.
Le Trotskysme, Flammarion, coll. «Champs», 1977.
Trotsky, Presses universitaires de France, coll. «Que sais-je?», 1980.
Trotsky, LGF, coll. «Biblio essais», 1984.
Vladimir Vissotsky,S eghers, 1989.
1953, les derniers complots de Staline, Complexe, coll. «La
Mémoire du siècle», 1993.
Staline, Presses universitaires de France, coll. «Que sais-je?», 1995.
Les Peuples déportés d’Union soviétique, Complexe, coll. « Questions
du XXe siècle», 1996.
La Russie de 1855 à 1956, Hachette, coll. «Les Fondamentaux»,
1997.
La Jeunesse de Trotsky, Autrement, coll. «Naissance d’un destin»,
1998.
La Jeunesse de Staline, Autrement, coll. «Naissance d’un destin»,
1998.
Le Goulag, Presses universitaires de France, coll. «Que sais-je?»,
1999.
Staline, Fayard, 2001.
Lénine, Balland, 2004.
Le Trotskysme et les trotskystes, Armand Colin, coll. «L’Histoire au
présent», 2004.
La Guerre civile russe (1917-1922), Autrement, coll. «Mémoires»,
2005.
Jean-Jacques Marie
Cronstadt
Fayard
© Librairie Arthème Fayard, 2005.
O Forts et batteries
Reprise de la forteresse de Cronstadt par l’armée rouge le 17 mars 1921
Avant-propos
Le 1 er mars 1921, 15000 marins et soldats se réunissent
dans un froid glacial sur la place de l’Ancre à Cronstadt, île
minuscule située au fond du golfe de Finlande, à une tren-
taine de kilomètres à l’ouest de Petrograd, dont elle défend
l’accès. Ils huent les dirigeants communistes venus les
haranguer puis leur interdisent de prendre la parole. Après
six heures de discours, de débats et de cris, ils votent à la
quasi-unanimité une résolution dénonçant la politique du
parti communiste au pouvoir et stigmatisant sa mainmise
sur les soviets dont ils exigent la réélection immédiate, à
bulletins secrets. C’est le premier pas d’une insurrection
qui, selon la Grande Encyclopédie soviétique 1, rassemblera
27 000 marins et soldats et s’achèvera, dix-sept jours plus
tard, dans de sanglants corps à corps à la baïonnette et à la
grenade. Près de 7 000 insurgés fuiront alors en hâte les
combats et la répression. Ils se traîneront, des heures
durant, affamés, épuisés et transis sur la mer gelée pour
rejoindre la Finlande voisine, où les attendent trois camps
de concentration, leurs barbelés, les poux, la gale et la
faim.
Cette insurrection n’a cessé de susciter les interpréta-
tions les plus contradictoires : «troisième révolution» ou
«complot garde-blanc» monarchiste; «crépuscule sanglant
des soviets» ouvrant l’ère du stalinisme, ou complot livrant
« Cronstadt au pouvoir des ennemis de la révolution » ;
9
CRONSTADT
mutinerie anticommuniste ou protestation antibureaucra-
tique ; révolte spontanée ou soulèvement minutieusement
préparé; émeute de marins excédés par le «communisme de
guerre » et ses réquisitions ou dernière opération des servi-
ces spéciaux étrangers ; banale révolte antibolchevik de
soldats-paysans ou insurrection d’anciens héros de la révo-
lution montés à l’assaut du gouvernement qu’ils avaient
pourtant porté au pouvoir trois ans plus tôt.
Dans un récit romancé de l’insurrection, publié en
1987 à Moscou, Le capitaine Dikstein, le romancier
Mikhaïl Kouraev insiste sur le trafic dont l’histoire de
Cronstadt a été l’objet : « Des personnages historiques,
qui se sont hissés à l’avant-scène de la révolution et de la
guerre civile et ont joué un certain rôle dans les événe-
ments de Cronstadt, ont, comme par miracle, soudain
disparu sous la glace avec les centaines de soldats de l’ar-
mée rouge et d’élèves officiers qui, par une nuit de bour-
rasque, ont attaqué l’imprenable forteresse et l’ont prise
au cours d’un corps à corps furieux et meurtrier. » Il y voit
un de ces trous noirs tragiques de l’histoire où « les villes
gèlent dans les lueurs des incendies, où les tréfonds des
cuirassés couverts de neige flambent de désespoir 2 ».
Pourtant, des années durant, les élèves des écoles sovié-
tiques ont appris par cœur un poème d’Edouard
Bagritski, dont un quatrain évoquait ses vingt ans :
La jeunesse nous a entraînés
Au combat, sabre dégainé.
La jeunesse nous a jetés
Sur la glace de Cronstadt.
Mais ils ne pouvaient guère savoir pourquoi. Dans le
calendrier historique révolutionnaire de 1939 imprimé à
Moscou, Cronstadt n’existe qu’à travers l’insurrection des
10
AVANT-PROPOS
marins. . . de 1906 et de sa garde rouge de l’été 1917, puis
l’île disparaît de l’histoire. Des mémorialistes amnésiques
se faisaient une étrange concurrence dans le silence.
Il était pourtant impossible d’effacer complètement
cette insurrection de l’histoire. Lénine l’évoque longue-
ment et à plusieurs reprises lors du Xe congrès du parti
communiste russe de mars 1921. Une image officielle, à
usage de masse, en fut donc fabriquée et consignée dans le
Précis d'histoire du Parti communiste de L'Union soviétique,
publié en 1938, inlassablement réédité jusqu’à la mort de
Staline, et dont l’étude était obligatoire. Mieux valait
néanmoins en parler le moins possible.
Le débat sur Cronstadt, escamoté en Union soviétique,
a eu lieu à l’Ouest, reprenant inlassablement les mêmes
documents, les mêmes textes et les mêmes témoignages,
répétant à satiété les mêmes interprétations, voire les
mêmes affabulations.
Deux ouvrages d’historiens occidentaux, l’un améri-
cain, La tragédie de Cronstadt de Paul Avrich, l’autre israé-
lien, Kronstadt 1917-1921 d’Israël Getzler, ont marqué
un premier renouveau dans cette histoire. Paul Avrich,
s’appuyant sur des documents d’archives américaines,
aboutissait à une conclusion apparemment surprenante :
« Dans le cas de Cronstadt, l’historien peut se permettre
d’affirmer que sa sympathie va aux rebelles, tout en
concédant que la répression bolchevik fut justifiée 3 .»
Pour Israël Getzler, au contraire, les dix-huit jours de la
révolte de Cronstadt ont représenté F «âge d’or de la
démocratie soviétique» et les mesures prises par les
bolcheviks après son écrasement constituent « un
programme typique de contre-révolution 4 ». Ces deux
points de vue opposés se situent des deux côtés de la ligne
de partage traditionnelle que dessinaient déjà Ida Mett,
dans La commune de Cronstadt, crépuscule sanglant des
11