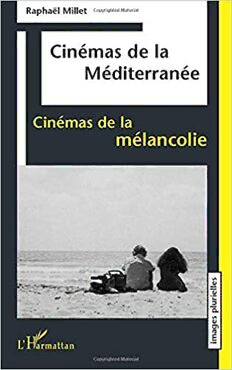Table Of ContentCinémas de la
Méditerranée,
Cinémas de la
mélancolie
-V)
-
cu
.;c:u
-
~
c..
V)
(1)
tj)
~
.E-
Collection Images plurielles
dirigée par Olivier Barlet
Face à la menace de standardisation occidentale, la collection Images
plurielles se donne pour but de favoriser la recherche, la confrontation et
l'échange sur les scènes et écrans œuvrant de par le monde, dans les
marges géographiques aussi bien que dans lamarginalité par rapport aux
normes dominantes, à une pluralité de l'image. Elle est ouverte aux
champs de l'écriture, de l'esthétique, de la thématique et de l'économie
pour le cinéma, l'audiovisuel et le théâtre. Elle privilégie, hors de toute
chapelle de pensée, la lisibilité du texte, la liberté des idées et la valeur
documentaire.
Déjà parus
Bernadette PLOT, Un manifeste pour le cinéma: les normes culturelles
dans lapremière Revue ducinéma,1997(prix Simone Genevois).
Sada NIANG (Sous la direction de), Littérature et cinéma en Afrique
francophone: Assia Djebar etOusmane Sembène,1997.
Koffi KWAHULE, Pour une critique du théâtre ivoirien contemporain,
1997.
Antoine COPPOLA, Le cinéma sud-coréen, 1997.
Olivier BARLET, Les cinémas d'Afrique noire: le regard en question,
1997.
Yves THORAVAL,Les cinémas de l'Inde, 1998.
Sylvie CHALAYE, Du Noir aunègre: l'image duNoir au théâtre (1550-
1960),1998.
Jean-Thobie OKALA, Les télévisions africaines sous tutelle, 1999.
Paulo Antonio PARANAGUÀ, Le cinéma enAmérique latine: le miroir
éclaté, 2000.
Martine BEUGNET, Marginalité, sexualité, contrôle dans le cinéma
contemporain, 2000.
José Alexandre CARDOSO MARQUES, Images de Portugais en
France: Immigration etcinéma, 2002
Raphaël Millet
Cinémas de la
Méditerranée,
Cinémas de la
mélancolie
L'Harmattan L'Harmattan Hongrie L'Harmattan Italia
5-7,ruedel'École-Polyteclmique Hargitau.3 ViaBava,37
75005Paris 1026Budapest 10214Torino
FRANCE HONGRIE ITALIE
Couverture: Aouni Kawas et Darina AI-Joundi
pendant le tournage
de Beyrouth fantôme, de Ghassan Salhab.
Cliché D. R.
@L'Hannatlan,2002
ISBN: 2-7475-2921-5
En amitié à
Xavière et Nadir,
Ghassan et Nesrine,
Joana et Khalil,
Dominique et Mona,
Hayet et Jamel,
Magda et Marie-Claude,
Olivier et Olivier.
Les textes qui composent ce recueil reprennent pour la
plupart des idées développées dans des articles publiés
entre 1996 et 2001 dans les revues Positif, Qantara, Simulacres
et Cinémathèque ainsi que dans la dernière édition du Diction-
naire du cinéma paru chez Larousse, mais aussi dans les pro-
grammes cinématographiques de l'Institut du monde arabe à
Paris ainsi que du festivalltBlack Movie" à Genève. Le tout est
le fruit de rencontres qui m'ont mené vers des terres et des
mers qui n'étaient pas les miennes.
"IIest possible, indépendamment du lieu où l'on est né et où l'on
vit, de devenir Méditerranéen. La méditerranéité ne s'hérite pas,
elle s'acquiert. C'est une distinction, non un avantage. LaMéditer-
ranée est aussi un destin."
Predrag Matvejevitch, Bréviaireméditerranéen
Quant à moi, je suis Breton.
Mais aussi Méditerranéen.
On a les origines que l'on se découvre.
Ou se donne.
6
Introduction
"Puisque tout ce qu'on prend dans la main, c'est du vent
Puisque tout n'est que ruine, désespoir."
Omar Khayam, Rubayat.
Il s'est passé quelque chose. Pas grand chose. Et le vent
l'emportera certainement... Mais il s'est passé quelque chose.
À la fin du siècle dernier. Le xxe... Quelque chose dont on ne
gardera peut-être pas vraiment trace, si ce n'est une emprein-
te imperceptible dans la longue histoire des images. Les ciné-
mas de la Méditerranée, et d'un peu plus peut-être, ont bougé.
Ont exprimé quelque chose. Quelque chose d'ancien et de nou-
veau à la fois. Exprimé une mélancolie profondément médi-
terranéenne. Solaire. Un peu tragique aussi. Terriblement fin
de siècle. Oui, une mélancolie solaire, c'est cela. Voire, dans les
moments de douce grâce, une mélancolie ensoleillée. Rien là
d'incompatible. Une humeur d'après-guerre. D'après les
guerres. Un mal-être au monde généralisé de sociétés en ruine,
d'humanités à la dérive. Prises dans une tectonique des senti-
ments. Saisies dans une faille esthétique.
"De ce fait, nous ne voyons pas lamême chose que les individus
quivivaientilyadeux ou troiscents ans. Lemême espace ne nous
inspire plus les mêmes méditations et ne nous suggère plus le
même type de contemplation."
AlainCorbin, L'Hommedans lepaysage.
7
Oui, il s'est passé quelque chose. Presque rien. Mais quand
même. Une poignée de films, certains remarquables, d'autres
néanmoins significatifs, ont vu le jour. Difficilement. Mais ils
y sont parvenus. Travaillant en lignes transversales. D'une
rive à l'autre. D'un pays à l'autre. D'un regard à l'autre. Jetant
des passerelles connues, galvaudées et pourtant renouvelées,
réhabitées, entre l'Orient et l'Occident, le Sud et le Nord.
Séries de regards croisés, de jambes décroisées, de travellings
entrecroisés, fondant l'Orient et l'Occident en de molles
caresses, comme disait déjà Gérard de Nerval de ces territoires
bordant une même mer. De ces territoires dont l'arrière-pays
est moins le désert que la Méditerranée. L'arrière-pays du
centre. L'arrière-pays du cœur. L'arrière-pays de tous, qui les
rapproche, les unit. Et ne les rend pas heureux pour autant.
Mais dont le bleu leur donne le blues, une forme de spleen
bien du Midi, bien du Sud... Une humeur sèche et lourde à la
fois. Une humeur de quelque chose qui, décidément, ne va
pas. Quelque chose de pas nouveau, que le meilleur des ciné-
matographies méditerranéennes des dix dernières années a su
réinvestir. Se réapproprier. Et réinventer. En nous livrant là
une nouvelle vision de la mélancolie éternelle et infinie.
Apport crucial s'il en est, pour mieux nous comprendre nous-
mêmes.
Pas un cinéma, mais des cinémas, si fragiles
Et pourtant, les choses ne sont guère aisées. Car de quoi
parle-t-on? Quand on sait qu'il n'y a pas Hun"cinéma de la Médi-
terranée. Qu'il n'y a même pas Hun" cinéma arabe. Encore
moins un cinéma libanais. Et moins encore un cinéma palesti-
nien. Il n'y a plus de cinéma algérien. Ily a eu un cinéma égyp-
tien dont il reste bien peu, mais ce n'est certes pas là qu'il s'est
passé le plus de choses ces derniers temps. Peut-être y a-t-il un
cinéma turc, mais rien n'est moins sûr. Un peu au-delà, il
semble qu'il y ait un cinéma iranien, en tout cas qui se dessine,
s'affirme depuis le milieu des années quatre-vingt. Avec des
tendances fortes, identifiables et quasiment dominantes. On
8
pourrait presque parler d'une ligne, d'un mouvement, voire
d'une école. Oui, une "école" iranienne, avec tout ce que cela a
de nécessairement réducteur. Oui, mais l'Iran, c'est déjà une
frontière, une limite où l'aire méditerranéenne s'arrête.
Non, en Méditerranée, rien. Ou si peu. Que des cinémas
épars, des bribes de cinématographies nationales par ci, les
restes d'une grandeur perdue par là. Non, il n'y a pas en Médi-
terranée une cinématographie homogène que l'on pourrait sai-
sir dans sa totalité, en toute exhaustivité et toute objectivité. Et
même si l'on réduisait l'investigation au seul monde arabo-
méditerranéen, on ne trouverait rien de plus. Donc, rien. Rien,
si ce n'est une sorte d'humeur partagée et transversale. Une
synthèse du "sentiment de Méditerranée". Car la Méditerranée,
ce n'est pas qu'une géographie, une géologie, une histoire, une
géopolitique... C'est aussi une émotion. Oui, un sentiment.
Des cinéastes perdus
Cela ne constitue pas pour autant une seule et même ciné-
matographie. Surtout si les bribes que l'on tente d'assembler,
de saisir, sont parfois réduites à peu de chose. Et pourtant, oui,
et pourtant encore, il y a des cinéastes. Qui avancent, contre
vents et marées, même si ces dernières n'existent pas -ou si
peu - en Méditerranée. Mais il y a des marées humaines:
Le Caire, Beyrouth, Istanbul... Millions. Il y a des flux et reflux
politiques. Des avancées et des retraits militaires. Et au milieu,
des cinéastes. Qui travaillent, vaille que vaille. Oui, des
cinéastes. Des anciens, qui ont bien du courage de continuer.
Des plus jeunes, qui ont bien du courage de se lancer. Car per-
sonne n'a dit que c'était facile de faire du cinéma. Surtout pas
sur le pourtour méditerranéen. Encore moins quand on en est
au Sud.
"IIYa des tigres malades dans la mélancolie des couchants
Avec des fureurs grises en leurs lents mouvements"
Nuno Judice, LaCondescendancede flêtre.
9
Alors, quelle perspective pour un cinéaste libanais? Quel
horizon pour un cinéaste algérien? Est-ce beaucoup plus dégagé
pour un cinéaste marocain? Ou tunisien? Même pour un réali-
sateur turc ou égyptien, il n'y a désormais plus rien d'aisé. La
faible quantité d'œuvres produites chaque année en est un
signe. Parmi d'autres. Moins strictement économiques, mais
peut-être plus politiques. Ces pesanteurs économiques et poli-
tiques, justement, voilà qui a rendu les créateurs, et pas seule-
ment les cinéastes, bien mélancoliques ces derniers temps. Leur
bonheur d'être triste n'est donc pas sans racines géopolitiques.
L'impossible bassin méditerranéen
L'aire ici étudiée est donc en partie insituable. Un peu ban-
cale... Même si l'on sait tout de suite ce que HMéditerranée"
veut dire. C'est en fait aujourd'hui l'aire d'une ère. Celle de la
fin d'une époque. Ou du début d'une nouvelle. Quelque chose
d'insaisissable. À l'image de la mélancolie, toujours indéfinis-
sable. Et c'est pourtant le paradigme mélancolique qui va nous
permettre de saisir cette aire cinématographique mouvante.
Cette aire, ici imparfaitement embrassée, certains la trouve-
ront trop large: il aurait fallu s'en tenir aux cinémas arabes; la
TUrquie, ce n'est pas le monde arabe, etc.; et que vient faire
Israël là-dedans? Pour d'autres, elle sera trop resserrée: la
Méditerranée, c'est plus que cela, il y a un quart nord-ouest
presque complètement délaissé. L'actualité cinématogra-
phique récente de l'Italie, de l'Espagne, voire de la France, ne
permet que très peu d'inclure tout cela dans l'analyse ici déve-
loppée, au risque de s'écarter de l'axe paradigmatique retenu.
Et si des cinématographies Hoccidentales" trouvent leur place
dans ce regard porté sur la Méditerranée, c'est davantage
comme cinématographies plus anciennes, sorte de corpus,
voire de référent. Ce n'en est que plus stimulant: on en vient
à embrasser d'un seul coup d'œil, d'un seul mouvement de
phrase, aussi bien Pollet, Pasolini, Rosselini, Salvatores, Vis-
conti, Tanner, Godard, que Salhab, Ayouch, Allouache, Ustao-
glu, Ceylan, Suleiman.
10