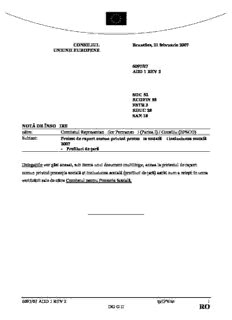Table Of ContentCONSILIUL Bruxelles, 21 februarie 2007
UNIUNII EUROPENE
6097/07
ADD 1 REV 2
SOC 52
ECOFIN 58
FSTR 3
EDUC 28
SAN 18
NOTĂ DE ÎNSO IRE
către: Comitetul Reprezentan ilor Permanen i (Partea I) / Consiliu (EPSCO)
Subiect: Proiect de raport comun privind protec ia socială i incluziunea socială
2007
- Profiluri de ţară
Delegaţiile vor găsi anexat, sub forma unui document multilingv, anexa la proiectul de raport
comun privind protecţia socială şi incluziunea socială (profiluri de ţară) astfel cum a reieşit în urma
verificării sale de către Comitetulpentru Protecţie Socială.
________________________
6097/07 ADD 1 REV 2 ip/IPV/at 1
DG G II RO
CUPRINS
BELGIA.................................................................................................................................3
BULGARIA.........................................................................................................................22
REPUBLICA CEHĂ............................................................................................................33
DANEMARCA....................................................................................................................44
GERMANIA........................................................................................................................54
ESTONIA............................................................................................................................66
IRLANDA............................................................................................................................76
GRECIA...............................................................................................................................87
SPANIA...................................................................................................................................
...............................................................................................................................99
FRAN A...........................................................................................................................111
ITALIA .............................................................................................................................122
CIPRU 133
LETONIA..........................................................................................................................146
LITUANIA........................................................................................................................157
LUXEMBURG ..................................................................................................................168
UNGARIA.........................................................................................................................177
MALTA.............................................................................................................................189
ĂRILE DE JOS...............................................................................................................199
AUSTRIA..........................................................................................................................211
POLONIA..........................................................................................................................223
PORTUGALIA..................................................................................................................234
ROMÂNIA........................................................................................................................246
SLOVENIA........................................................................................................................256
SLOVACIA.......................................................................................................................266
FINLANDA.......................................................................................................................277
SUEDIA.............................................................................................................................288
REGATUL UNIT...............................................................................................................298
2
BELGIQUE
1. Situation actuelle et principales tendances
La croissance économique de la Belgique a faibli en 2005 pour atteindre 1,2 %, mais elle
devrait reprendre de l'élan pour s'établir à 2,7% en 2006. Malgré la création de 39 000
emplois, le taux de chômage est resté à 8,4% en 2005 (contre 8,8 % dans l'Union des 25).
Des disparités régionales sensibles subsistent, tant sur le front de l'emploi1 (64,9 % en
Flandres, 56,1 % enWallonie, 54,8 % à Bruxelles) que celui du chômage2 (5,4% enFlandres,
12,1 % en Wallonie, 15,9 % à Bruxelles). Le chômage des jeunes a continué de progresser
21,5 % en2005). L'emploides 50-64 ans, en revanche, a connu une amélioration au cours des
cinq dernières années, passant de 26,3% en 2000 à 31,8% en 2005, mais il reste faible et
nettement inférieur à la moyenne de l'Union (42,5 % en 2005). Cette progression résulte
principalement de l'augmentation de 33,1 % de l'emploi des femmes dans cette classe d'âge au
cours des cinq dernières années. Sur de cette période, le taux d'emploi des femmes est passé
de 51,5% à 53,8%, tandis que celui des hommes a légèrement reculé (69,5 % en 2000 contre
68, 3% en 2005). Le taux de risque de pauvreté était de 15 % en 2005, avec des différences
régionales sensibles (11 % en Flandres, 18 % en Wallonie et un taux estimé à 27 % à
Bruxelles). L'espérance de vie à la naissance (76,7 ans3 pour les hommes et 82,4 ans4 pour les
femmes) est proche de la moyenne de l'Union. En revanche, la Belgique est au-dessus de la
moyenne de l'Union pour ce qui est du nombre d'années de vie en bonne santé, tant pour les
hommes (67,4 ans contre 64,55 ans) que pour les femmes (69,2 ans contre 666 ans). Avec
1,72 enfant par femme7, le taux de fécondité s'établit également au-dessus de la moyenne de
l'UE (1,52). Le ratio de dépendance des personnes âgées était de 26,3 en 2005 et il devrait
atteindre 41,3 d'ici 2030. Les dépenses brutes de protection sociale ont progressé depuis 2000
et représentaient 29,3 % du PIB en 2003. Les retraites et la santé constituent la majeure partie
des dépenses de protection sociale (44,1 % et 27,7% respectivement).
2. Approche stratégique globale
Le rapport met en exergue l'augmentation et la création d'emplois comme principaux vecteurs
pour assurer l'avenir de la sécurité sociale. La stratégie s'articule autour de trois objectifs qui
sont, d'une part, de maintenir de façon structurelle l'équilibre financier du système de sécurité
sociale en gardant un niveau élevé de protection sociale et davantage lier les allocations
sociales, dont les pensions, à l'évolution du bien-être, d'autre part, de renforcer l'interaction
entre les politiques d'inclusion sociale et le développement de l'emploi notamment par des
mesures d'activation en faveur des groupes à risque et, enfin, d'offrir des soins de santé de
qualité et abordables.
Les mesures du rapport sont étroitement liées aux priorités et objectifs identifiés dans le
Programme National de Réforme (PNR) 2005-2008 destinés à atteindre les objectifs de la
Stratégie de Lisbonne et les objectifs de l'OMC en matière sociale. Bien que la stratégie
proposée par la Belgique présente de nombreuses similarités avec les précédents plans, elle
montre une bonne compréhension de la nature multidimensionnelle de l'exclusion sociale.
1 Chiffre 2005 (source: SPF économie –direction générale statistique, Belgique)
2 Chiffre 2004 (source: SPF économie –direction générale statistique, Belgique)
3 Estimation provisoire 2005 (source: Eurostat)
4 Estimation provisoire 2005 (source: Eurostat)
5 Chiffre UE 15 (source: Eurostat)
6 Chiffre UE 15 (source: Eurostat)
7 Estimation provisoire 2005 (source: Eurostat)
3
L'intégration de la dimension de genre est absente du rapport malgré la disponibilité de
statistiques ventilées par sexe. Cela étant, plus de femmes que d'hommes sont susceptibles de
bénéficier des mesures proposées dans le cadre des objectifs stratégiques prioritaires, car elles
tendent à être surreprésentées dans les groupes cibles
La préparation de chacun des trois piliers du rapport a fait l'objet d'une concertation et d'une
coordination entre tous les niveaux de pouvoirs législatifs compétents et a associé de
nombreux d'acteurs comme les partenaires sociaux ou encore des associations de personnes
vivant dans la pauvreté et l'exclusion sociale. Cependant, la collaboration entre les acteurs des
trois piliers reste limitée, entraînant, par conséquent, un manque de relations entre les trois
piliers. Une meilleure coordination et un échange d'information entre ces acteurs constituent
un challenge pour les prochains plans afin d'en améliorer la cohérence et l'aspect
"interrelatedness".
3. Intégration sociale
3.1. Principales tendances. Le taux de risque de pauvreté après transferts sociaux s'est établi
à 15 % en 2004, avec un risque plus élevé pour les personnes âgées (21 %), les personnes
seules (21 %), les locataires (27 %), les personnes vivant dans un foyer monoparental (36 %)
et les chômeurs (28 %). Le taux de pauvreté des travailleurs, qui est de 4%, est nettement en
dessous de la moyenne de l'Union (8 %). Les transferts sociaux continuent de jouer un rôle
important, dans la mesure où ils réduisent de 46% le taux de risque de pauvreté qui, avant
transferts sociaux (hors pensions de retraite), était de 28 % en 2004. Le revenu net des
bénéficiaires de prestations d'aide sociale en pourcentage du seuil de pauvreté est de 76,6%
pour une personne seule, 68,5 % pour un couple marié avec deux enfants, et de 89,9% pour
un parent seul avec deux enfants. La part des enfants de 0 à 17 ans vivant dans un ménage
sans emploi a reculé de 13,8 % en 2002 à 13,5 % en 2006 (9,5 %8 en moyenne dans l'Union).
Une faible amélioration a été enregistrée en matière de sortie précoce du système scolaire
(13 % en 2005), avec un écart important entre les sexes (15,3 % pour les garçons et 10,6 %
pour les filles). Tandis qu'en 2005, 81,8% des 20-24 ans avaient un moins un diplôme de fin
d'études secondaires, le chômage des jeunes a continué de progresser, pour s'établir à 21,5 %,
au-dessus de la moyenne de l'Union(18,5 %). Un autre point important est l'écart entre le taux
de chômage des ressortissants de l'Union et celui des ressortissants de pays tiers (25,4 % en
2005), qui est trois fois plus important que la moyenne de l'UE.
3.2. Principaux défis et priorités. Le plan 2006, fruit d'une large concertation, se concentre
sur trois priorités qui sont de garantir un logement correct et abordable pour chacun, de
développer l'activation et la diversité dans l'emploi et l'intégration sociale et, enfin, de lutter
contre la pauvreté des enfants. Les deux premiers défis déjà identifiés dans les précédents
NAP Inclusion nécessitent toujours davantage d'engagements politiques et financiers.
Malgré l'effort des Régions d'augmenter le nombre de logements sociaux, l'offre reste
insuffisante pour répondre aux besoins. Par ailleurs, les catégories sociales plus faibles sont
encore contraintes de consacrer une trop grande partie du budget du ménage à leur logement.
Augmenter la participation au marché du travail de certains groupes spécifiques constitue
toujours un défi essentiel. Le taux de chômage de longue durée pour les parents isolés (14%),
les personnes d'origine hors UE 25 (20%), les personnes handicapées et les personnes peu
qualifiées (8%) requiert des mesures spécifiques d'accompagnement vers l'emploi. Le taux de
8 Estimations 2006 (source: Eurostat)
4
chômage des personnes âgées et des jeunes restent préoccupants en Belgique. Le risque de
pauvreté infantile en Belgique est inférieur à la moyenne de l'UE (17% contre 19%) mais les
enfants de parents isolés et ceux qui vivent dans des ménages sans travail sont confrontés à un
risque de pauvreté particulièrement élevé, respectivement 36% et 70%. Ces priorités
répondent aux défis identifiés dans le Rapport conjoint 2006 et ont pour objectif premier
d'augmenter la participation au marché du travail, d'assurer l'accès aux ressources et services
nécessaires pour pouvoir vivre dans la dignité, de prévenir la discrimination et d'éliminer la
pauvreté infantile.
3.3. Mesures stratégiques. La première priorité vise à garantir un logement correct et
abordable pour chacun. Cette politique consistera à améliorer l'offre de logements modestes
non seulement en étendant le parc existant de logements sociaux mais aussi en renforçant le
contrôle et le respect de normes de qualité plus strictes. Le pourcentage de logements sociaux
du secteur locatif par rapport au nombre total de ménages privés devrait ainsi passer de 6.3%
en 2004 à 8% en 2010. Cet objectif reste ambitieux dans la mesure où, depuis 1995, ce
pourcentage est resté constant à environ 6.3%. Des mesures financières telles que la
simplification d'octroi des allocations de loyer et l’optimalisation d’un système pour le
paiement des garanties locatives faciliteront l'accès des plus démunis à des logements sociaux
habitables et conformes. L'objectif est aussi d'étendre le droit à l'énergie en améliorant la
fourniture et l'accès au gaz, à l'électricité et à l'eau pour une meilleure protection des plus
démunis. Le budget des agences immobilières sociales sera également augmenté afin
d'accroître leurs possibilités d'action et de promotion et de réaliser des travaux de rénovation
ou de réhabilitation. Des mesures d'accompagnement des sans abri sont aussi prévues afin
d'organiser leur insertion par le logement. Enfin, une coopération entre les différentes entités
sera mise en place afin d'accroître la connaissance de la problématique du logement en
Belgique. La plupart de ces mesures restent peu innovantes et le rapport reste assez discret sur
la manière dont elles vont être réalisées et financées. Aucune dimension de genre n'est
spécifiée à l'exception d'une volonté à Bruxelles d'augmenter le nombre de places
d'hébergement pour les femmes sans-abri.
Développer l'activation et la diversité dans l'emploi et dans l'intégration sociale constitue la
seconde priorité. L'activation et la diversité visent à augmenter le taux d'emploi et à créer des
emplois en accordant une attention particulière à des groupes cibles spécifiques comme les
personnes d'origine hors UE, les personnes peu qualifiées et infra-scolarisées et les personnes
handicapées. Les résultats visés par cette mesure sont issus du PNR et sont en ligne avec les
objectifs fixés pour 2010 par la Stratégie de Lisbonne en matière de taux d'emploi (70%), de
participation à la formation tout au long de la vie (12.5%) et de réduction du décrochage
scolaire (10%). Le taux d'emploi des femmes devrait aussi atteindre l'objectif de Lisbonne de
60% en 2010. Enfin, les autorités belges souhaitent ramener le taux de chômage des
personnes hors UE au niveau de celui des travailleurs belges. Vu l'importance du problème
(aggravé si on tient compte des personnes d'origine étrangère naturalisées belges pour qui la
participation au marché du travail reste difficile) et l'objectif ambitieux affiché, il aurait été
souhaitable que la problématique de l'intégration des immigrés fasse l'objet d'une approche
intégrée dans une mesure distincte. Au niveau fédéral, un groupe de travail sur la
discrimination veille à une harmonisation efficace des différentes mesures d'emploi destinées
à promouvoir l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi des groupes à risque. La Flandre
consacre près de 8 millions EUR par an à un certain nombre d'initiatives en matière de
diversité afin de prévenir l'exclusion du marché du travail pour les plus âgés, les personnes
d'origine étrangère et les personnes handicapées et prévoit une prime à l'emploi pour
l'engagement de personnes de plus de 50 ans. Les trois régions vont élargir l'offre des
structures d'accueil pour enfants afin de pouvoir permettre aux parents demandeurs d'emploi
5
d'accéder au marché du travail. Plusieurs initiatives et instruments seront développés pour
promouvoir l'emploi des groupes cibles en leur offrant un accompagnement sur mesure dans
leurs démarches d'insertion. Le FSE devra, à ce titre, jouer un rôle important. Le
développement de l'économie sociale et de services de proximité continuera tant en Flandre
qu'en Wallonie et sera accompagné d'autres activités non nécessairement professionnelles. En
plus de différentes recherches et études qui seront lancées pour évaluer l'impact des mesures
d'activation, les moyens d'enregistrement et de monitoring en matière de diversité seront
harmonisés et améliorés.
La troisième priorité, la lutte contre la pauvreté infantile, a comme objectif de mettre fin à
l'engrenage de la pauvreté. L‘accent mis sur ce groupe cible dans la politique de lutte contre la
pauvreté est innovante pour la Belgique. Le pourcentage d'enfants de moins de 16 ans en
risque de pauvreté devrait diminuer à 12% en 2010 (contre 17% en 2003) et la proportion
d'enfants (0-17 ans) vivant dans des ménages sans emploi rémunéré devrait passer de 12.9%
en 2005 à 7% en 2010. Atteindre de tels niveaux pour l'ensemble de la Belgique nécessitera
beaucoup d'efforts étant donné les différences régionales. Néanmoins, une série de mesures a
été mise sur pied. En complément des mesures financières des deux autres politiques
susmentionnées, le système de bonus à l'emploi et la nouvelle allocation familiale de rentrée
prévue depuis août 2006 contribueront à améliorer le revenu des familles. Les autorités belges
accorderont aussi beaucoup d'importance à lutter contre le décrochage scolaire et stimuler la
participation sociale de tous les enfants dès le plus jeune âge. Dans le domaine de
l'enseignement, des efforts seront entrepris pour diminuer la contribution des parents aux frais
scolaires et diversifier les populations qui fréquentent l'école. Les liens entre les familles et les
écoles seront renforcés et l'implication des parents dans leur rôle éducatif sera encouragée.
Enfin, la politique d'aide spéciale à la jeunesse et notamment l'accueil des mineurs étrangers
non accompagnés sera améliorée par une série de mesures.
3.4. Gestion. Le plan a été élaboré en étroite collaboration, sous la coordination du Service
Public de Programmation (SPP) Intégration Sociale, par deux groupes de travail "actions" et
"indicateurs" composés non seulement des représentants du niveau fédéral, de chacune des
Communautés et Régions mais aussi des représentants d'autres administrations notamment
locales (Union des Villes et des Communes), des partenaires sociaux (Conseil national du
Travail), des experts ainsi que des associations de personnes vivant dans la pauvreté et
l'exclusion sociale. Les deux groupes de travail ont été élargi aux représentants de tous les
secteurs de la société civile. Dans le développement d'indicateurs et la détermination de
targets, le groupe de travail "indicateurs" a aussi utilisé les résultats de nombreux débats,
recherches et rapports. L'implémentation du plan se traduit par des plans d'action fédéraux et
régionaux coordonnés. Le monitoring de l'évolution des targets sera la responsabilité des
groupes de travail mais les différentes administrations responsables pourront introduire elles-
mêmes sur le site internet du SPP Intégration Sociale les données permettant de suivre la mise
en œuvre de leurs actions respectives. En 2007, un colloque public sur le plan sera encore
organisé dans le but de formuler des recommandations pour l'avenir.
4. Retraites
En 2004, les personnes âgées avaient un niveau de vie inférieur de 3 % à la moyenne
nationale, un écart qui reste relativement faible par rapport à d'autres États membres, tandis
que le risque de pauvreté (21 %) est considéré comme étant nettement plus élevé que pour la
population belge âgée de moins de 65 ans.
Malgré de récentes améliorations, le taux d'emploi des travailleurs âgés reste faible. Selon le
rapport 2006 sur la viabilité, la Belgique est un État membre à risque moyen concernant la
6
viabilité des finances publiques, notamment en raison de l'ampleur considérable de la dette
publique. La Belgique supporte d'importantes pressions budgétaires du fait du vieillissement
de la population: selon les prévisions de 2005 du groupe de travail sur le vieillissement de la
population, les dépenses du régime public de retraite passeront de 10,4 % à 15,5% du PIB
entre 2004 et 20509. Selon les prévisions du SGI, le taux de remplacement théorique net pour
le régime public (pour un travailleur partant à la retraite à 65 ans après 40 ans de vie active au
salaire moyen) devrait reculer légèrement, de 63% en 2004 à 61 % en 2050, tandis que le
taux de remplacement théorique net global devrait progresser de 67 % à 74%, à la faveur d'un
apport de 4,25% des revenus bruts aux régimes professionnels (40-45 % de la population
active sont actuellement affiliésà un telrégime).
Garantir l'adéquation, la viabilité et la solidité du régime public est une des principales
préoccupations de la politique belge en matière de retraites. Le rapport conjoint 2006 souligne
l'importance de l'amélioration de la situation de l'emploi des travailleurs âgés pour
l'adéquation et la viabilité des retraites. Dans le même temps, le rapport insiste sur les efforts
déployés pour améliorer l'adéquation des retraites (notamment des pensions minimales et des
pensions professionnelles). Le gouvernement belge a pris des mesures supplémentaires dans
ce sens, en particulier en faveur des femmes, avec l'augmentation du revenu de retraite
minimum (GRAPA) jusqu'au seuil de risque de pauvreté, l'instauration d'un mécanisme
d'ajustement des pensions de retraite en fonction de l'évolution de l'aide sociale, et une
meilleure prise en compte du travail à mi-temps dans la détermination du revenu de retraite
minimum. L'harmonisation, d'ici 2009, de l'âge de retraite légal pour les travailleurs salariés
se poursuit.
Les dispositions relatives à la retraite anticipée ont été réformées à la fin de 2005 et devraient
contribuer à l'adéquation et à la viabilité financière du régime de retraite en encourageant un
allongement de la vie active dans le cadre d'un dispositif appelé "pacte entre les générations",
au moyen notamment d'un recul de l'âge de la retraite anticipée de 58 à 60 ans et d'incitations
à l'allongement de la vie professionnelle au-delà de l'âge de 62 ans et d'une durée d'au moins
44 ans (système de "bonus"). L'augmentation du taux d'emploi des personnes âgées reste
cependant primordiale.
Par ailleurs, la stratégie visant à garantir la viabilité financière des retraites continue de
s'appuyer dans une large mesure sur la gestion globale de la sécurité sociale et sur la réduction
de la dette publique. En outre, l'épargne est transférée vers un fonds de réserve (quis'élevait à
4,5 % du PIB en 2005) et est donc affectée aux futures dépenses liées au vieillissement.
À long terme, la promotion des régimes de retraite professionnels pourrait faire progresser les
taux de remplacement, et donc le niveau de vie relatif des retraités. Tandis qu'un rendement
minimum est garanti pour les cotisations versées par le salarié et l'employeur dans tous les
régimes de retraite complémentaires, des efforts supplémentaires pourraient être nécessaires
pour assurer une bonne couverture de la population active (notamment des femmes) par les
régimes professionnels.
5. Soins de santé et soins de longue durée
5.1. Soins de santé
9 Les projections nationales figurant dans le rapport 2006 sur la stratégie nationale en matière de
protection et d'intégration sociales, lesquelles reflètent les récentes réformes et différents choix méthodologiques,
indiquent que la progression des dépenses pour les retraites entre 2005 et 2050 pourrait représenter 3,9% du
PIB.
7
Description du système. Le système de soins de santé belge repose sur un système
d’assurance obligatoire soins de santé qui fait partie intégrante de la sécurité sociale. La
couverture est quasi universelle (99%). Environ 70% du financement vient du secteur public
(cotisations complétées par des interventions de l’Etat et des taxes affectées), 22%
directement des familles (out of pocket), le restant étant couvert par les assurances
complémentaires. Ces dernières restent marginales, il existe un consensus pour poursuivre la
consolidation et la pérennité de l’assurance obligatoire publique. Les patients ont liberté de
choix du dispensateur et accès direct aux spécialistes. Les dispensateurs sont essentiellement
rétribués à l’acte par les patients sur la base de tarif fixés en concertation avec les partenaires
sociaux, les mutualités et les dispensateurs de soins. Les patients sont ensuite remboursés aux
alentours de 75% par leur mutualité (sauf pour les frais d'hospitalisation, où la mutuelle
intervient ex ante). L'offre est étendue et il n'y a pas de listes d’attente. L'Etat fédéral est
exclusivement compétent en ce qui concerne le régime d'assurance soins de santé obligatoire,
partie intégrante du système de sécurité sociale. Par contre, Etat fédéral et régions se partagent
les compétences en ce qui concerne l'offre des soins et la santé publique. La stratégie belge
consiste à alléger les charges financières pour les patients les plus démunis, à améliorer la
qualité des soins à travers une orientation vers l'usager centrée sur la continuité des soins, et
maîtriser la croissance des coûts à travers un meilleur rapport coût/efficacité.
Accès. Bien que le régime belge des soins de santé assure à la population un haut niveau de
protection (99%), les autorités craignent que la participation demandée aux patients pour
certains services (21,5% en paiement direct des ménages in 2004; pourcentage relativement
élevé bien qu’en diminution dans les années récentes) puisse fortement grever le budget des
catégories sociales les plus vulnérables. Pour limiter ce risque, les pouvoirs publics ont pris un
éventail de mesures qui prévoient notamment des plafonds annuels (maximum à facturer), un
remboursement majoré et la gratuité des soins préventifs pour tous. Le maximum à facturer
constitue en fait l'outil de base de l'action pour l'accessibilité financière des soins de santé
grâce à son champ d'action très large (500.000 soit 11% des ménages belges en ont bénéficié
en 2005). Le champ d’application du mécanisme du «maximum à facturer» sera élargi. De
plus, pour ce qui concerne les médicaments, plusieurs actions sont prévues pour diminuer
leurs coûts pour les patients (baisses des prix obligatoires, incitations à l'utilisation des
génériques, élargissement du remboursement à certains médicaments innovants). Il n'y a pas
de problèmes d'inégalités d'accès au niveau territorial. On essaye d'optimaliser la répartition
géographique de l'offre, au niveau hospitalier, à travers les 'bassins de soins', et au niveau des
médecins généralistes au moyen de primes pour les médecins s'installant dans des zones en
pénurie de médecins.
Qualité. En ce qui concerne la qualité des prestataires, le système se base traditionnellement
sur les normes de reconnaissance pour les institutions de soins. Il existe une agence pour
analyser les pratiques cliniques et développer les bonnes pratiques et évaluer les technologies
médicales. On développe un système d'évaluation par les pairs, par exemple en comparant les
hôpitaux sur une série d'indicateurs pour leur permettre de définir eux-mêmes leurs objectifs
d'amélioration. En vue d’augmenter sans cesse la qualité des soins, les autorités visent à
garantir des prestations orientées vers l'usager (adaptées à leurs besoins) centrées sur la
continuité des soins, notamment via une priorité donnée aux soins de première ligne, aux
politiques de prévention, à la liberté de choix des patients et à la disponibilité de l'information.
Plusieurs vaccins sont gratuits et facilement accessibles via les centres de soins préventifs
pour les enfants.
Viabilité à long terme. Le total des dépenses de soins de santé, qui a atteint 2.922 PPP$ per
capita et 9,3% du PNB en 2004 est relativement élevé, les dépenses ayant en outre fortement
8
augmenté ces dernières années. Les projections du groupe du travail sur le vieillissement
(AWG) prévoient une augmentation de 2.4 points pourcentage dans les dépenses publiques
des soins de santé, les projections nationales une augmentation de 3.7 points pourcentage d'ici
à 2050. Le gouvernement compte relever le défi de l’augmentation des dépenses de santé en
œuvrant sur divers axes: au niveau macro, par la fixation d'une norme de croissance de
dépenses publiques de santé (fixée à 4.5% par an hors inflation), déclinée en objectifs
budgétaires partiels par grandes rubriques médicale et paramédicale. Un suivi continu est mis
en place pour assurer le respect de la norme. Au niveau micro, on mise sur les politiques
visant à responsabiliser tous les acteurs en matière de santé: co-paiements pour les usagers,
forfaitarisation de certaines prestations hospitalières (ce qui n'incite pas à la
surconsommation), répartition d’une partie du budget entre les mutuelles sur base de
'dépenses théoriques' (c’est-à-dire en fonction des profils de risque de santé des assurés).
L'amélioration de la coordination des soins et l’utilisation rationnelle des ressources ont une
grande importance pour améliorer le rapport coût/efficacité. On favorise donc le recours aux
soins de première ligne et l’utilisation du dossier médical du patient. Des mesures corollaires
prévoient une évaluation technologique, un taux de remboursement plus élevé pour les
médicaments génériques, l’adoption de meilleures pratiques de prescription. En 2005 et 2006
l'objectif budgétaire annuel de croissance de 4,5% en termes réels a été atteint. Développer les
politiques de promotion de la santé et de modes de vie saine constitue également une priorité
pour toutes les autorités.
5.2. Soins de longue durée
Description du système. Les soins de longue durée peuvent être prestées en milieu
hospitaliers, dans des services spécialisées, dans des institutions spécialisées, ou à domicile.
Malgré les prix relativement élevés, le niveau d'institutionnalisation des personnes âgés est
relativement élevé (6-7% des personnes âgés 65+) Les Communautés et Régions ont
beaucoup de compétences, l'offre varie donc selon ces Communautés et Régions. Il existe une
coordination entre les matières fédérales, communautaires et régionales Il existe aussi une
coordination entre les services de soins généraux et les services de soins de longue durée, par
exemple via les services intégrés de soins à domicile, permettant d’utiliser au mieux la
complémentarité des différents dispensateurs de soins et services d'assistance.
Accès. Le défi de l’amélioration des soins de longue durée est lié à la priorité du maintien à
domicile. Pour y arriver, on développe le continuum de soins, les centres de soins de jour, et
les courts séjours. Les services de soins à domicile se spécialisent (services d'aide, soins
palliatifs à domicile). Néanmoins, le maintien à domicile engendre aussi de coûts pour le
particulier tels que la difficulté de transport aux centres de jour, ou la nécessité de continuer à
payer un loyer si on est en institution pour un court séjour. Une attention particulière a été
portée dans le rapport belge aux différents services visant à prendre en compte de façon
appropriée et ciblée les souffrances mentales. Un développement récent est un circuit de soins
adapté pour les patients en état neurovégétatif persistant qui vient combler le manque de
structure adéquate pour ce type de patient.
Qualité. En matière de soins de longue durée, l’accréditation, les pratiques d’évaluation par
les pairs (par exemple le collège gériatrique) et le développement de qualifications
professionnelles adéquates, sont également garant de la qualité des services offerts. Une
importance particulière est accordée à la coordination pour permettre une offre de soins et de
services d'aide intégrée, continue et multidisciplinaire, adaptée aux besoins de la personne.
9
Les années à venir seront e.a. consacrées à développer et implémenter des trajets de soins
pour les patients chroniques.
Viabilité à longue terme. De nombreux risques spécifiques aux soins de longue durée sont
assurés via l'assurance obligatoire soins de santé, les défis de garantir la viabilité financière
sont donc les mêmes que pour les soins de santé. Un des défis pour les années à venir consiste
à assurer le déploiement des ressources humaines, tenant compte du vieillissement de la
population. Des efforts seront fournis afin de renforcer la position des dispensateurs
travaillant en première ligne et d’assurer suffisamment de prestataires d’aide et de soins ayant
un statut attractif. Il sera également nécessaire de développer différentes formes possibles de
soins, tenant compte du degré de dépendance des personnes (soins résidentiels, soins de jour,
soins de nuit, court séjour). A cette fin, un protocole pluriannuel a été conclu entre les
différentes autorités compétentes en 2005.
6. Défis à venir
• Augmenter les taux d'emploi, notamment des travailleurs âgés, des jeunes, des migrants et
des ressortissants de pays tiers, et améliorer l'accès au marché de l'emploi des chômeurs
de longue durée, des travailleurs peu qualifiés et des parents isolés;
• multiplier les efforts pour mettre des logements décents et à prix raisonnables à la portée
d'un plus grand nombre de personnes;
• garantir la viabilité et l'adéquation des régimes de retraite en réduisant davantage encore la
dette publique et en continuant d'améliorer l'accès, en particulier des femmes, à des
régimes de retraite du second pilier;
• faire face à la progression des dépenses pour les soins de santé en améliorant le rapport
coût/efficacité, tout en garantissant l'accès aux soins des groupes vulnérables;
• améliorer le régime des soins de longue durée en favorisant les soins à domicile.
10
Description:sociales, dont les pensions, à l'évolution du bien-être, d'autre part, Une faible amélioration a été enregistrée en matière de sortie précoce du système scolaire . scolaires et diversifier les populations qui fréquentent l'école Les projections nationales figurant dans le rapport 2006