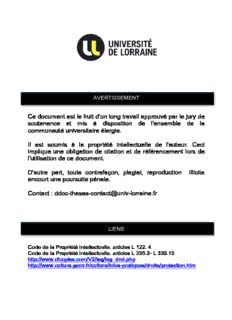Table Of ContentAVERTISSEMENT
Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite
encourt une poursuite pénale.
Contact : [email protected]
LIENS
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm
JURY :
Catherine ABADIE-REYNAL, Professeur d'archhlogie classique A l'Universit6 de Nancy 2
Yves GRANDJEAN, Professeur &mérited 'archéologie classique à 1'Universitd de Nancy 2
Jean-Y ves MARC,P rofesseur d'archéologie romaine A l'université de Strasbourg 2, Marc Bloch
François RICHARD, Professeur d'histoire romaine à l'Université de Nancy 2
Michel SEVE, Professeur d'histoire grecque A l'Université de Metz
20. L'arc d'Assuras (Zmfur)
Atius Archbologique de la Tunisie, Fe Ksour, No8 0.
CIL VIII 1798.
L'arc d'Assuras, dédié h Caracalla en 215, domine la plaine du Sers. Visible de
très loin, sur le plateau qui domine l'Oued Zanfur, cet arc h une baie n'était que
l'un des trois arcs connus de la ville. On éprouve des difficultés & situer les deux
antres dans le tissu rirbiun d'aujourd'hui, dors que le site n'est pas fouillé, et que
la plupart des ruines au-dessus du sol ont disparu. Quant h l'arc de Caracalla, son
état de ddlabrement inquiète.
.-
Figure 1; L-arc a-Assuras aeyne par oruce, CL mpruudt plir Phyfai~.
Eïgaw 2: L'arc d'Assurai en 2005.
Figure 4: L'arc en 1994, claveaux et restes de 19enbhleinent.
Figure 5: L'arc en 1994, faces latérales
Figure 6: L'Arc d'Assuras, 1994
Bibliographie :
CURTIS, Roman Monumentul Arches, p. 72 no 62
FORTUNER D., no 1 1.
FROTINGHAM, no 3 1 1.
GRAEF, no A62.
GUERIN, Voyages, 11, p. 568.
KAHLER,n o 55a.
PELISS~ERE ., »Lettre à Mr Hase D, R. A., 1848, p. 394.
PLAYFAIR, Travels, p. 207.
POINSSOT J., « Inscriptions inédites recueillies pendant un voyage en Tunisie »,
B. A. A., 1884, p. 250, et pl. XXII.
TEMPLE (SIR) GR., Excursions in the Mediterranean : Algiers and Tunis, 2 vol.,
Londres, 1835, p. 266.
TISSOT,G éographie Comparée, II, p. 568.
20.1. La ville et la région
La cité est magnifiquement située face à l'opulente plaine du Sers. Elle occupe un
vaste plateau orienté Nord-OuestISud-Est, qui descend doucement vers la plaine, à
l'Est. La véritable défense naturelle se situe au Sud et à l'Ouest, grâce au lit assez
encaissé de l'oued Zanfour qui sert de défense naturelle en coritournant le plateau. Selon
les voyageurs du XIX\iècle, plusieurs portes s'ouvraient dans une enceinte dont
l'existence était confirmée à leur époque par l'existence de tronçons de fondations bien
visibles, mentionnés notamment par Poinssot', repris par ~issot-e t qui ont disparu
aujourd'hui. Si la présence de deux autres arcs dans la ville est incontestable, on peut
discuter de leur rôle effectif comme portes dans l'enceinte. Ils ont été décrits par
Fortuner, mais ils ont beaucoup souffert depuis trente ans, et si nous avons pu
photographier l'arc de l'Ouest, dont on voit nettement un piédroit conservé jusqu'à
l'imposte, nous n'avons pas repéré celui du Nord. Un autre arc, situé à 150 mètres à
l'Ouest de celui de Caracalla, semble également avoir été construit à l'intérieur de la
muraille.
La cité, d'une très vaste étendue, possédait un théâtre encore bien conservé au XIX
siècle, à côté duquel s'élevait un arc, au Nord de la ville. Le forum n'a pas été localisé,
il pourrait se situer entre le temple, au Nord, et l'arc de Caracalla. Enfin, comme dans
toutes les cités de quelque importance, une citadelle byzantine est venue occuper
l'emplacement le plus propre à la défense.
Le fait qu'aucun village ne soit venu occuper le site est comme toujours à la fois
porteur d'espoir pour des fouilles approfondies, car le site est « conservé par les
))
cultures qui I'occupexit (conime à Séressi, Medeina, Mactar, Uchi Maius etc .), mais
laisse inquiet devant la disparition rapide de blocs immédiatement utilisables, ou
intéressants d'un point de vue « décoratif ». Ainsi, des éléments photographiés au sol en
1994, comme un chapiteau et un bloc de fût de colonne, ont-ils disparu aujourd'hui.
Assuras faisait partie des colonies de César, ou plus vraisemblablement d'Auguste,
ainsi que nous l'indique son nom : Colonia Iulia Assuras. Elle était rangée dans la tribu
Horatia. On sait qu'au lendemain de l'annexion par César du royaume de Numidie,
celui-ci fut contrôlé grâce à la création de colonies, destinées à absorber et reconvertir
les vétérans de légions devenues trop nombreuses. Situées géographiquement à des
points stratégiques, pour former une couronne autour de Carthage, elles constituaient
également une couverture militaire protégeant l'accès à 1'Africa Vetus. C'étaient, en
roco on su la ire':
Col. Iiilia Carthngo ; Col. Iuli .Assuras ; Col. Iul. Curubis; Col. Iul.
Neapolis; col. lul. Thuburbo Maius ; Col. Iul. Veneria Cirtu nova ; Col. lul. Simitthu ;
Col. lul. Uthina ; Col. Iul. Hippo Dinrrhytus ; Col Iul. Thuh ... ; Col. Iz~l Muxula ; Col
'
Poinssot, op. cit., p. 252
'
Tissot, op. cit, p.570.
'
Consulter la liste établie par le P. Mesnage, opzu. cit, p. 41-43.
Iul. Thuraria. En Numidie, Auguste fonda la colonie d 'Hippo Regius, et dans le même
temps, Utica, Thabraca, Thunu Suda, Thuburnica, Uchi Maius (fondée par Marius avec
Thibaris), Vaga, devinrent des municipes. On peut penser, au vu des constructions et
des dédicaces, que la période sévérienne fut la plus prospère pour la ville, mais elle a
connu une longue existence, puisqu'elle est encore nommée dans une lettre de Cyprien,
et figure parmi les évêchés énumérés dans les conciles jusqu'au Ve siècle.
Figure 7: L'oued Zanfur à l'Est de la ville ; au second plan, I'arc ; à gauche, au bord de I'oued,
restes de quais d'époque romaine. La route moderne suit le cours de l'oued au niveau du site.
Figure 8: Les champs au pied de I'arc ; au second plan, la ferme du «gardien » du site. A
l'horizon, la plaine du Sers.
Figure 9: Cours de l'oued Zanfur en direction du Sers à I'EstISud-Est de la ville.
Le plan de la ville :
il a été communiqué par l'oinssot4, d'après un relevé d'Espérandieu, et c'est
touj c
Figure IO: Plan de la ville établi par Espérandieu, in Poinssot.
4 Ouvrage cité, p. 25 1
20.2. L'arc
Situation:
Cet arc s'élève à l'Est de la ville, sur la partie du plateau où la pente est la plus
douce, et il est orienté de telle façon que sa façade Est est à l'extérieur de la ville. Il ne
nous semble pas qu'il ait constitué une entrée ou une porte à proprement parler,
contrairement à l'arc situé à l'Ouest, sur le tracé probable de la muraille, en direction de
Ksour. En effet, la grande voie qui traverse la ville, reliant Ksour à Elles, suit un axe
Est-Ouest qui aboutit à un pont sur l'oued Zanfour situé à I'EstlSud-Est de l'arc qui
nous occupe. C'est ce passage qui aurait mérité une « porte D, mais paradoxalement on
ne voit pas trace de monument important dans cette zone.
Comme, à l'époque de Caracalla, la ville n'avait pas besoin d'enceinte, cette
dernière avait dû disparaître en grande partie, à l'instar de tant d'autres villes. Aussi, le
mur décrit par Poinssot, qu'il considère comme l'enceinte romaine, et dont il dit qu'on
peut en suivre les fondations sur presque tout son parcours, doit-il dater de l'époque
byzantine, où il constituait l'indispensable complément de la citadelle. C'est
certainement le bâtiment assez bien conservé, situé au centre du site, et que l'on voit
fig .2
L'arc qui nous intéresse possède deux façades identiques, qui présentaient
chacune une inscription, ce qui confirme qu'il n'était pas relié directement à une
muraille. S'il en existait bien une pour protéger la ville en direction du Sers, elle se
serait située plutôt au débouché du pont sur l'oued, comme à Uzappa, où l'ensemble de
la topographie est très voisin. Poinssot indique une autre porte, « vers le Sud Ouest »,
qui n'est pas mentionnée sur le croquis d'Espérandieu, et se situait peut-être au
débouché de l'autre pont, au Sud Ouest du plan.
Dimensions :
ort tuner'
Nous empruntons celles de :
Largeur totale : 1 1,18 m
Hauteur : 7m
Epaisseur : 2,78 m, 5,68 m, avant-corps compris.
Largeur de la baie : 5'3 8 m
Plan de E'arc :
Le schéma du plan, établi avec les incertitudes liées à l'enfouissement du socle et
d'une partie de la plinthe, particulièrement de celle des piédestaux, figure dans la thèse
de Fortuner, Pl XVII, nOl. Nous ne l'avons pas reproduit, puisqu'il n'est
qu'hypothétique.
Etat de conservation :
sera surpris de constater les ravages subis par l'arc ces dernières années. 11
011
était certes consolidé, mais encore intact lorsque nous l'avions photographié en 1994,
(fig.6). Son état actuel, en 2005, est très inquiétant, (fig.2 ). Le système de consolidation
utilisé ici est très différent de celui que nous avons vu en place à Séressi ; on peut se
demander si la constructioi~e n béton, malgré !es ouvertures pratiquées en hauteur, n'est
pas trop rigide pour accompagner les poussées ?
Poinssot proposait les dimensions suivantes : longlieur : l lin ; largeur de la baie :5,60m ;
hauteur sous clé :7m. Ce sont les mêmes que celles données par Tissot, op. cit., p. 570, et celles de
Guérin, op. cit., p. 88.
Ici, nous avions un blocage de moellons ; or, lorsque Duthoit avait étayé l'arc de
Cuicul au XIXe siècle, il avait eu recours à un blocage de moellons, qui semble avoir
bien résisté ; le blocage utilisé un temps à Timgad, de même nature, avait également
permis d'attendre en sécurité la reprise totale de l'arc. L'explication de ce brutal
effondrement réside peut-être dans un tremblement de terre, qui a légèrement ébranlé
l'ensemble, mais l'arc a mieux résisté que sa consolidation.
Description :
L'arc présente deux façades semblables, comportant un pilastre au centre du
piédroit. A ce pilastre répondait une colonne que l'on peut restituer6. L'ordre est
exhaussé sur un piédestal bien visible sur la façade Est, sur le piédroit Sud.
Les piédroits sont relativement conservés, mais les pierres sont disjointes, et
c'est un doux euphémisme ! Il en manque quelques-unes sur la façade Est, au piédroit
Sud, et sur la façade Ouest, au piédroit Nord. L'entablement et l'attique sont
suffisamment conservés pour confirmer la disposition des blocs de la frise de l'attique,
de champ, et même pour montrer trois blocs portant une partie de la dédicace. Mais le
profil de la plinthe ne peut être étudié.
La construction est en calcaire du pays, en opus quadratum; le plan d'Espérandieu
montre du reste les carrières toutes proches d'où est extraite la pierre.
Elévation :
Po la plinthe:
Elle est constituée par une seule assise très importante (fig. 14): et présente, au-
dessus d'un large bandeau plat, un talon renversé, une double scotie encadrant un
astragale, toutes ces moulures étant séparées par des filets, enfin, un talon renversé.
To~itesc es moulures sont lisses.
2O les claveaux
Ils sont extradossés en plate-bande, et, chose assez rare sur les arcs africains, sont
ornés d'une archivolte, constituée d'un bandeau et d'un talon. Curieusement, ils sont en
nombre pair (il y en a 20), et reposent sur une imposte qui fait le tour du piédroit.
3OL'lmposte :
Elle est moulurée : un cavet, une doucine droite, un bandeau, limités par des listels,
et fait le tour du piédroit, sauf au niveau des pilastres.
1°Les piédestaux sont aujourd'hui plus ou moins enfouis dans le sol, et la partie
supérieure du dé et du stylobate a disparu, sauf un bloc intérieur. On peut voir quelques
blocs de celui du Nord, façade Est, (voir la figure 16) et, quelques éléments subsistant
au Sud, sur la même façade, (voir figure !1 . )
6 Curtis indique à tort, p. 72, que les fragments de ffits de colonnes ont disparu, alors que
Poinssot écrit p. 252 que « leurs débris gisent à terre pêle-mêle avec les blocs qui formaient
l'entablement, encore intact lorsque Sir Grenville Temple le vit ». C'est en effet son dessin qui a permis
de restituer l'entablement.
Description:Palens, pp. DUTaOl'i., Relevés dans le cadre des Monuments Historiques de l 'Algérie, 1866. BALLU A., Guide illustré de Djemila, Alger, 1926.