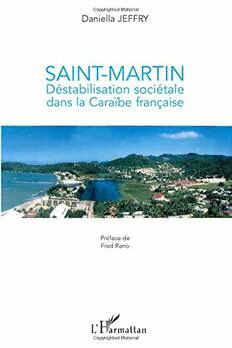Table Of ContentSAINT-MARTIN
Déstabilisation sociétale
dans la Caraïbe française
©L’Harmattan,2010
5-7,ruedel’École-polytechnique;75005Paris
http://www.librairieharmattan.com
[email protected]
[email protected]
ISBN:978-2-296-12764-7
EAN:9782296127647
Daniella JEFFRY
SAINT-MARTIN
Déstabilisation sociétale
dans la Caraïbe française
Préface de
Fred RENO
A la mémoire de mon père, Simon Jeffry, de ma mère,
AdélaLondonJeffryetdemonfrère,MartialJeffry,
A la mémoire de tous ceux qui ont su nous transmettre
le sens de la continuité historique et qui ont lutté pour
préservernotrepatrimoineculturel,
A tous ceux qui aujourd’hui comprennent que ces
Trente Années Douloureuses ne représentent que la
traverséedudésert…
REMERCIEMENTS
Je n’aurais pu réaliser cette étude, sans l’aide de toutes les sources
journalistiques qui m’ontpermis,nonseulementdesituerchronologiquement
et avec précision tous les acteurs et les événements de cette période
mouvementée et troublée de l’histoire de mon île natale, mais aussi de
transposer directement les opinions, les pensées, les expériences de ceux qui
ont utilisé le journal comme moyen de communication. Dans une île où
l’expression oraleestle moyend’expression privilégié, jetiensàremercierla
presse écrite de jouer ce rôle de reproduction des éléments importants de la
viequotidienne.
Je voudrais remercier la directrice de la Philipsburg Jubilee Library,
Monique Alberts, et en particulier son assistante, Ans Koolen-Stel, et la
responsable des Relations Publiques, Maryland Powell, qui m’ont accueillie
au sein du personnel de la bibliothèque afin que je puisse consulter les
journauxarchivés.J’yaipuiséuncomplémentprécieuxd’information.
Je remercie tous ceux avec qui j’ai discuté et partagé les ressentiments,
les souvenirs et les expériences. Ils sont nombreux. Je ne les nommerai pas
de peur d’en oublier. Ils se reconnaîtront. D’autres m’ont offert
gracieusement une copie de leur documentation personnelle, en particulier
AlexChoisy,PatriciaEtienne,OmerArrondell.
J’ai confié la lecture critique de mon manuscrit à Paul Turpin pour la
version française et à Oswald Francis pour la version anglaise. Je les
remercie de leur grand intérêt pour ce travail. Alain Paméole a fidèlement
interprété mon idée de la couverture de l’ouvrage. Je le remercie. Le
Professeur Fred Réno de l’Université des Antilles-Guyane, qui connaît
parfaitement le contexte saint-martinois, a accepté de préfacer mon ouvrage.
Jeluiensuisextrêmementreconnaissante.
Finalement et non des moindres, mon fils Joseph et ma fille Tiana ont
apporté leur contribution dans la réalisation de la partie technique de
l’ouvrage, en m’instruisant sur les éléments informatiques nécessaires à sa
réalisation,enparticulierlesgraphiquesdontjen’avaispaslapratique.
9
PRÉFACE
Cet ouvrage écrit par une saint-martinoise s’intitule Saint-Martin:
Déstabilisation sociétale dans la Caraïbe française. On ne sera donc pas
surpris qu’une large part des développements soit consacrée au territoire de
Saint-Martin, même si d’autres sociétés caribéennes sont concernées par les
processus évoqués. Daniella Jeffry nous brosse trente ans d’histoire dans un
pamphletquin’épargnepersonne. Saplume,souventacérée,évitenéanmoins
la polémique stérile. A l’évidence, ce livre est utile parce qu’il évalue le
passé récent de Saint-Martin pour mieux saisir un présent complexe,
caractérisé notamment par le choix d’un statut d’autonomie. Séparé de la
Guadeloupe dans l’ensemble français. «Separate status within France ». Ce
slogan entendu pendant la campagne électorale sur le changement statutaire
résume parfaitement le projet et les ambiguïtés saint-martinoises. Il traduit la
volonté locale de concilier l’affirmation identitaire saint-martinoise et
l’égalité républicaine française. Deux démarches jugées incompatibles par
l’auteure. «La quête d’égalité est incompatible avec la quête de
spécificités »,nousdit-elle.
Cet ouvrage est aussi un regard critique et prospectif sur Saint-Martin. Il
met en scène les principaux acteurs de la vie locale. Mieux, il met au jour un
système d’acteurs en interactions solidaires ou conflictuelles en fonction des
enjeux. Les hommes politiques sont les premiers visés. Victimes
consentantes des pressions du monde des affaires et des demandes sociales,
ilssemblentconcevoirleurfonction électiveavant tout comme une source de
rétributions symboliques et matérielles. Le monde des affaires, quant à lui,
bénéficiaired’exonérationsfiscales,adopteleslogiqueslesplusclassiquesde
l’économie libérale sur un territoire où l’Etat providence semble défaillant.
Lorsque l’acteur politique ne se confond pas avec l’acteur économique, à
l’instar des Fleming, les deux entretiennent des relations souvent complices
de dépendance personnelle qui influencent fortement le fonctionnement de
l’activité sociale. Dans bien des cas, la décision officielle n’est que la
formalisation d’arrangements informels qui défient la rationalité politico-
administrative. Dans ce jeu, l’Etat arbitre et régulateur s’accommode du
système tant que ses intérêts sont préservés. Contrairement aux idées reçues,
l’Etat français n’est pas le simple représentant des possédants et le défenseur
des élites politiques locales proches des vues gouvernementales. Sinon
comment comprendre la décision du gouvernement de révoquer en 1977 un
11
maire pourtant du même parti que le ministre des DOM TOM et le président,
ou encore la mise en place d’une administration des douanes à partir du 1er
Août 1990, en dépit d’une levée de boucliers. L’Etat peut donc, dans
certaines circonstances, se situer au dessus des groupes sociaux pour imposer
ses logiques. C’est un des enseignements de la vie politique saint-martinoise
quisous-tendletextedeDaniellaJeffry.
La population saint-martinoise, actrice marginalisée, aujourd’hui
multiculturelle est fortement inégalitaire. Les statistiques sont défavorables
aux «premiers habitants ». Les mots utilisés par l’auteure pour décrire les
formes de leur exclusion, voire de leur élimination, sont divers. Si la
relégation évoque les conditions sociales de ceux qui d’origine caribéenne et
anglophone sont minoritaires et souvent sans emploi, le «génocide
silencieux» r appelle ce processus de substitution de population décrit par
Aimé Césaire. La «FriendlyIs land » serait généreuse avec les autres, au
point de sacrifier les siens. La première vague d’européens des années 70, la
plus importante et la plus marquante des immigrations, accompagne ou
précède celles venues d’Haïti, de Guadeloupe et d’ailleurs. Ces flux
migratoires, comme dans d’autres pays soumis au même phénomène,
modifient la structure socio-ethnique du territoire. Ceci au détriment de ceux
quihéritiersdupartagedel’îleentrefrançaisetnéerlandais n’ont cesséd’être
saint-martinois et de traverser la frontière artificielle entre Philipsburg et
Marigot.
Si l’on ajoute la guadeloupéanité forcée des saint-martinois après leur
rattachement en 1946 «au continent guadeloupéen », nous avons tous les
ingrédients de l’autonomisme saint-martinois en réaction à ce que Michael
Hechterqualified’«internalcolonialism »1.
A l’instar de territoires dépendants comme l'Irlande, l'Ecosse et le Pays
de Galles, colonisés par l'Etat britannique, à Saint-Martin les différences
culturelles entre métropolitains et autochtones se superposent aux inégalités
économiques. Ces différences deviennent peu à peu les critères de
distributiondesrôlessociaux.
Dans l'échelle des positions sociales, les statuts les plus élevés sont ceux des
originaires du centre, les plus bas sont ceux des autochtones. Dans le cas
étudié par Daniella Jeffry, un double colonialisme interne s’est développé.
Au contrôle de la société locale par un Etat français distant s’ajoutait une
régulation administrative directe par le département et par la Région de
Guadeloupe. Comme Saint Barthélémy, La Désirade, les Saintes et Marie-
1 Michael Hechter, Internal colonialism: the Celtic fringe in British national
development 1536-1966, Routledge and Kegan, London. Voir aussi J. Reele,
Internal colonialism the case of Brittany, in Ethnic and racial studies, vol. 2 n° 3,
July1979.pp.275-292
12
Galante, Saint-Martin faisait partie des «dépendances de Guadeloupe ».
Expressioncurieusepourtousceuxquiconnaissentlesdifférences culturelles
avec le «continentGuadeloupe» et les revendications identitaires locales.
Aprèslarévisiondelaconstitutionfrançaisele28mars2003,lacommunede
Saint-Martin a choisi de se séparer de la Guadeloupe et de revendiquer un
statutdecollectivitéd’outre-merautonome.
En se séparant de la Guadeloupe, Saint-Martin a fait le choix de sa
dépendance. En effet, comme les autres pays de la Caraïbe sous juridiction
française, Marigot loin de remettre en cause son rattachement à la France
cherche à l’aménager. C’est la tendance de l’ensemble des territoires non
indépendants de la Caraïbe. La Martinique et la Guyane sont désormais des
collectivités à statut spécial régies par le régime d’identité législative.
Autrement dit, le changement dans la continuité. Porto-Rico s’interroge sur
l’intérêt pour l’île d’ajouter une étoile à la bannière des Etats-Unis. Saba,
Saint-Eustache et Bonaire bien qu’autonomes sont devenues l’équivalent de
communes du Royaume des Pays-Bas. Certaines îles anglaises comme les
îles Turcs et Caïques voient leur autonomie contestée par le gouvernement
britannique officiellement pour des raisons de gouvernance et de corruption.
L’île indépendante de Saint Vincent, contre la volonté de son premier
ministre,refuseparréférendumdedevenirunerépubliqueetchoisitdegarder
symboliquement un gouverneur général nommé par la couronne britannique.
La dépendance peut donc être conçue dans certains cas comme une forme de
domination entre acteurs solidaires mais inégaux disposant de moyens
matérielsetsymboliquesnécessairesauxstratégiesdel’unetdel’autre.Cette
relation peut donc être fondée sur la réciprocité. Elle peut correspondre à la
volonté du dominant de pérenniser sa position, mais aussi à celle du dominé
de l’accepter, dès lors que la situation lui confère plus d’avantages qu’elle ne
luiprocure de désagréments.Autrementdit,la dépendancepeut correspondre
à l’allocation de ressources en dépit de contraintes réelles et d’une
contestation corrélative. De ce point de vue, Saint-Martin n’est pas une
exception. C’est tout le mérite de cet ouvrage de l’inscrire dans l’évolution
des sociétés caribéennes. Le cas saint-martinois, parmi d’autres, illustre une
dépendance-ressource2 par laquelle l’Etat français offre des politiques
publiques répondant aux attentes sociales et économiques de fractions
importantes des populations locales dans le cadre d’une domination qu’un
centrepolitiquelocalnepeut,pourl’heure,exercer.
2Fred Reno, Re-sourcing dependency: decolonisation and post-colonialism in
French overseas departments, in European Journal of Overseas History, vol. XXV
2001pp.9-22,
Voir aussi: Qui veut rompre avec la dépendance? in Autrement: Guadeloupe,
Tempsincertains,Janvier2001n°123pp.236-249
13
Il faut par conséquent saluer cette étude pertinente de Daniella Jeffry et la
considérer comme un témoignage documenté sur le sens de la dépendance
dansunesociétécomplexedelaCaraïbeinsulaire.
FredReno
Professeurdesciencepolitique,UniversitédesAntillesetdelaGuyane
Directeur du CAGI (Centre d’Analyse Géopolitique et Internationale)
14
INTRODUCTION
Cette étude porte sur la période de 1977 à 2007, une période de profonds
bouleversements dans la vie et le devenir des Saint-Martinois. En effet, les
habitants de l’île, avec la complicité de leurs élus, ont assisté à la
transformation brutale et rapide de leur environnement rural en une
urbanisation bétonnée effrénée, favorisée par l’application de la loi de
défiscalisationde1986. Ilsconstituaientlamajoritédelapopulation en1977,
et dès 1987, ils devenaient une minorité laissée pour compte, au nom du
progrèsetdudéveloppement.Malgréleurrésistance,leurstatutdepopulation
d’accueil fut relégué à celui de population de seconde classe, par la mise à
l’écart de leur culture et leur langue, sous la pression obstinée d’une autre
culture venue d’ailleurs. Et progressivement, ne comprenant rien à cette
violente mutation, se débattant pour conserver leur place, ils ont vu une
nouvelle société s’installer qui ne ressemblait en rien à la leur, une société à
laquelleilsnepouvaients’identifier.
Leur île venait tout juste d’entrer dans une certaine modernité en 1963.
L’électrification, la construction de l’aéroport international, l’arrivée des
premiers touristes avaient enfin ouvert la voie à un avenir prometteur, un
avenir qui leur faisait rêver. Car enfin, ils pouvaient vivre chez eux et
pouvaient accueillir bien d’autres venus de la Caraïbe environnante. Ils en
éprouvaient une certaine fierté, d’ailleurs, car eux aussi, tout au long du
vingtième siècle, avaient émigré vers d’autres cieux plus cléments.
Néanmoins, au début de cette période, ces insulaires pressentaient soudain
qu’il sepassaitquelquechose qu’ilsnecontrôlaientpas. Une sourdeangoisse
s’emparait d’eux, et ils ne savaient pas comment l’appréhender. Tout ce dont
ils étaient sûrs, c’est qu’ils étaient la Friendly Island. C’est la seule chose à
laquelleilspouvaients’accrocher,maispourcombiendetempsencore?
Pour bien comprendre les souffrances de ces habitants avides de liberté,
il est nécessaire de rappeler quelques faits marquants de leur histoire. Malgré
leur petit nombre, ils sont profondément attachés à leurs coutumes, à leurs
traditions, à leur langue - l’essence même de leur identité et de leur dignité.
En 2007, sans ycroire vraiment, ils ne se sentent plus chez eux. Leur culture
et leur mode de vie sont étouffés par une autre culture dominante ou d’autres
cultures dominantes, toutes venues d’ailleurs. Ils apprennent qu’ils forment
moins de 20% dela population et que tous les autres constituent plus de 80%
15