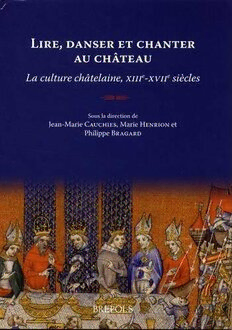Table Of ContentLire, danser et chanter au château
L ,
ire danser et chanter
au château
La culture châtelaine, e- e siècles
xiii xvii
sous La direction de
Jean-Marie cauchies, Marie henrion,
PhiLiPPe Bragard
H
F
Actes du 4e colloque international organisé au château fort d’Ecaussinnes-
Lalaing, les 22, 23 et 24 mai 2013
Avec le concours financier de la « Fondation pour la protection du patrimoine
culturel, historique et artisanal » (Lausanne)
© 2016 Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in
a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior
permission of the publisher.
ISBN: 978-2-503-56865-2
e-ISBN: 978-2-503-56866-9
DOI: 10.1484/M.STMH-EB.5.110719
D/2016/0095/121
Printed on acid-free paper
Sommaire
Avant-propos
Jean-Marie Cauchies 1
Le livre de chœur, manuscrit conservé au château
fort d’Écaussinnes-Lalaing
Anne-Emmanuelle Ceulemans 5
Châtelains et musiciens, mécènes et artistes :
observations d’un partenariat en Angleterre (1550-1650)
François-Emmanuel de Wasseige 25
L’état de biens à la mortuaire de Guilbert de la Barre,
seigneur de Mouscron († 1592).
Le mobilier du château de Mouscron comme élément
de culture châtelaine
Claude Depauw 47
C’est un beaus mestiers, beaus maistres, de faire tels choses :
Jean Froissart et la poésie châtelaine
Jean Devaux 61
Lire et écrire au château à la fin du Moyen Âge :
les espaces de l’étude dans les résidences de la noblesse laïque
Sarah Fourcade 75
Livres et librairie au château d’Amboise à la fin du xv e siècle :
entre Moyen Âge et Renaissance
Lucie Gaugain 91
Du mécénat littéraire à la mythification :
l’exemple de Jean V de Créquy au xv e siècle
Victorien Leman 109
Les livres du château de Montperroux en Autunois :
une bibliothèque d’incunables en 1491
Hervé Mouillebouche 127
Sommaire
Les représentations de château dans les fêtes royales et
princières au xiv e siècle :
décors éphémères et ornements précieux
Christiane Raynaud 149
Le château « La Fontaine » à Luxembourg.
Culture et divertissement au temps du gouverneur
Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604)
Guy Thewes 165
Performance au château
Colette Van Coolput-Storms 185
Livres et bibliothèques au château en France et
dans les anciens Pays-Bas aux xv e et xvi e siècles
Hanno Wijsman 199
Traces de la vie quotidienne dans une prison médiévale :
les graffitis du château de Selles à Cambrai, Nord (France)
Virginie Motte & Nicolas Melard 221
La bibliothèque de Belœil
Pierre Mouriau de Meulenacker 237
Conclusions
Jacqueline Guisset 247
Planches en couleur 258
JEAN-MARIE CAuCHIES
Membre de l’Académie royale de Belgique
Président de la Fondation van der Burch
AvAnt-propos
En 1982, deux enseignants de l’université libre de Bruxelles, la
romaniste Michèle Mat, spécialiste d’histoire littéraire du xviiie siècle,
et l’historien de l’économie et de la société de la fin de l’Ancien régime
Jean-Jacques Heirwegh publiaient dans la collection « Études sur le xviiie
siècle » une contribution de plus de cent pages intitulée Itinéraire intellec-
tuel et gestion économique d’un noble hennuyer : Sébastien Charles de la Barre
(1753-1838)1. Ce militaire de l’Ancien Régime, franchement hostile aux
réformes de Joseph II et à la Révolution française, se reconvertit après
celle-ci en grand propriétaire foncier et acquit en 1807 le château de la
Follie, où il fit effectuer de grands travaux. Type même du notable local,
maire puis bourgmestre d’Écaussinnes-d’Enghien de 1813 à 1830, il se
constitua une bibliothèque d’environ 2 600 volumes et en établit lui-
même le catalogue manuscrit. Quelque cent cinquante de ses livres sont
annotés en marge de sa main. Le livre en son château était pour lui
vecteur de savoir et source de divertissement, instrument de réflexion à
propos d’une société alors en pleine mutation, pour tout dire expression
d’une culture.
Voilà notre thème, illustré par ce voisin écaussinnois d’il y a deux
siècles. Le thème donc du quatrième colloque organisé sous les auspices
de la Fondation van der Burch, au nom de laquelle je souhaite à tous la
bienvenue en ces lieux. Toujours indéfectiblement liés aux châteaux, les
précédents colloques ont approfondi quelques traits forts de leur passé :
transformations en 2003, environnement en 2006, économie et pouvoir
en 2009. J’emprunterai volontiers à l’historien médiéviste russe Aaron
Gourevitch († 2006) le mot clé de 2013 : théâtralisation, « théâtralisation
du mode de vie noble », pour citer son expression intégrale2. Le château,
dont nous allons cette année plus que jamais pousser les portes, sera
théâtre, décor, écrin, plus que jamais – je me répète – espace de vie et
de culture.
1 Tome IX, Bruxelles, 1982, p. 93-207. 2006), dans Académie royale de Belgique. Bulletin
2 J.-L. Kupper, L’historien Aaron-Jakovlevitch de la Classe des Lettres, 6e série, tome XXI, 2010,
Gourevitch (Moscou, le 12 mai 1924-le 15 août p. 75-89.
Jean-Marie CauChies
En mettant sur pied des colloques dans les murs de son château
fort, la Fondation van der Burch s’attèle aux tâches par excellence qui
sont siennes : conserver une bâtisse, valoriser un musée, mais aussi com-
muniquer, stimuler la communication, en se gardant bien de celer des
collections ou de clore des murs. Cet effort de communication, beau-
coup de châtelains d’antan l’ont aussi pratiqué et nous allons en savoir
davantage sur les outils qu’ils ont mis en œuvre et la manière dont ils
ont procédé. Ce ne sont pas seulement des objets et des paroles qu’il
nous sera donné de voir ou d’entendre, ce seront encore des espaces que
plusieurs exposés nous inviteront à parcourir, espaces dévolus dans les
châteaux à la librairie, au cabinet d’étude, à la salle de musique. La vie
des châtelains et de leur entourage, mais aussi, dans une contribution,
celle d’hôtes parfois forcés d’un château-prison, sera d’abord ancrée dans
une culture matérielle, faite d’objets comportant notamment livres et
tableaux. Les livres seront très présents, prédominants même parmi les
invités au colloque. De quelles lectures disposait-on au château ? Quels
livres étaient-ils effectivement lus ou consultés ? Figuraient-ils là pour
l’usage… ou pour le décor ? Lecteur potentiel, le noble seigneur peut
être aussi mécène par ce qu’il stimule, acquiert ou donne. Comment
conserve-t-il ? Comment communique-t-il par le biais de la lecture, de
l’image, du recours à la voix ou au regard ?
Si le livre participe au château à une mise en scène, il en va de
même d’autres formes d’expression. Si la « culture châtelaine » est litté-
raire, elle peut aussi se faire musicale ou festive. Bref, c’est une brassée
de productions et d’activités au château que nous espérons vous offrir,
nous offrir entre nous. Et l’historien du droit et des pouvoirs qui vous
parle ne manquera pas de souligner que toutes ces productions de l’esprit
et des sens restent indissociables d’une volonté politique plus ou moins
explicite mais toujours prégnante : le château demeure lieu de pouvoir.
Comme d’ordinaire dans nos colloques, les champs couverts se
sont voulus très ouverts, celui du temps comme celui de l’espace, du xie
au xviie siècle, depuis Philippe le Bel jusqu’au Grand Condé, deux
figures de proue qui seront de la partie, à travers les anciens Pays-Bas,
de Mouscron à Luxembourg, la France royale, bourguignonne, bour-
bonnaise, et même avec une incursion en Angleterre. Après tout,
noblesse et culture ne franchissent-elles pas le plus souvent les frontières
sans passeports ?
Ce quatrième colloque in situ n’aurait pu avoir lieu sans d’indis-
pensables concours humains et matériels. Notre gratitude est vive à
l’égard de Théodore et Clotilde de Brouwer-d’ursel, membres du
2
Avant-propos
conseil d’administration de la Fondation van der Burch, qui, à la suite
du Comte et de la Comtesse Robert d’ursel, toujours bien présents et
actifs eux aussi, habitent le château et nous y accueillent. Il en va de
même pour la Comtesse Charles-Albert de Lichtervelde, hôtesse atten-
tionnée de bon nombre de nos orateurs en son château de la Follie. Mon
collègue et ami Philippe Bragard, professeur d’histoire de l’architecture
à l’université catholique de Louvain et lui aussi administrateur de la
Fondation, a partagé pleinement avec moi la responsabilité scientifique
du quatrième colloque et n’a pas ménagé sa peine dans l’accomplissement
de diverses tâches et démarches. Nous avons été puissamment aidés par
notre doctorante commune, la toujours souriante et efficiente Marie
Henrion, véritable plaque tournante de la logistique de ces journées.
Quant à Jacqueline Guisset, docteur en histoire de l’art, cheville ouvrière
des précédents colloques, elle ne nous a heureusement pas abandonnés
et il n’a pas été tellement malaisé de la convaincre d’assumer la charge à
la fois stimulante et redoutable de présenter les conclusions de cinq
demi-journées d’écoute et d’échanges. Je tiens enfin à souligner que ce
colloque, comme les précédents, n’aurait pu avoir lieu sans l’intervention
financière de la Fondation pour la protection du patrimoine culturel,
historique et artisanal établie à Lausanne, une organisation qui demeure
plus sensible aux modestes sirènes de colloques de castellologie qu’aux
fastes – restons dans l’actualité médiatique… – d’un « Grand Prix
Eurovision de la chanson » !
3