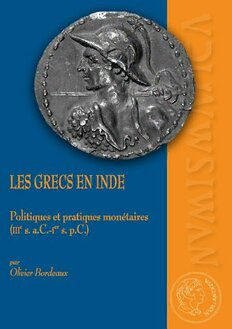Table Of ContentLES GRECS EN INDE
POLITIQUES ET PRATIQUES MONÉTAIRES (iiie s. a.C. - ier s. p.C.)
par Olivier Bordeaux
AUSONIUS ÉDITIONS
— Numismatica Antiqua 8 —
BORDEAUX
2018
Notice catalographique :
Bordeaux, O. (2018) : Les Grecs en Inde. Politiques et pratiques monétaires (iiie s. a.C.-ier s. p.C.), Ausonius Numismatica Antiqua 8,
Bordeaux.
AUSONIUS
Maison de l’Archéologie
F - 33607 Pessac Cedex
http://ausoniuseditions.u-bordeaux-montaigne.fr
Directeur des Publications : Olivier Devillers
Secrétaire des Publications : Nathalie Tran
Graphisme de couverture : Stéphanie Vincent Pérez
© AUSONIUS 2018
ISSN : 1961-1560
ISBN : 978-2-35613-219-2
Achevé d’imprimer sur les presses
de l’imprimerie Laplante
Parc d’activités Mérisud
3, impasse Jules Hetzel
33700 Mérignac
4 avril 2018
À mon épouse, Déborah
À mes parents
SOMMAIRE
Préface ............................................................................................................................................................................................................. 7
Remerciements ............................................................................................................................................................................................. 11
Introduction .................................................................................................................................................................................................. 13
Chapitre I. Commentaire historiographique ....................................................................................................................................... 25
Chapitre II. Commentaire numismatique ............................................................................................................................................ 51
Chapitre III. Commentaire historique ................................................................................................................................................... 95
Conclusion générale ................................................................................................................................................................................... 145
Catalogue ....................................................................................................................................................................................................... 149
Liste des tableaux ........................................................................................................................................................................................ 291
Liste des figures ............................................................................................................................................................................................ 292
Liste des planches ........................................................................................................................................................................................ 293
Liste des illustrations .................................................................................................................................................................................. 294
Bibliographie ................................................................................................................................................................................................. 297
Index................................................................................................................................................................................................................ 319
Table des matières ....................................................................................................................................................................................... 325
PRÉFACE
Olivier Bordeaux nous présente aujourd’hui les résultats de ses recherches de longue haleine fondées sur la thèse
d’une qualité exceptionnelle qu’il a menée à terme voici presque un an. J’ai fait la connaissance d’O. Bordeaux en 2008
à la suite d’une demande formulée par mon collègue et ami Zemaryalaï Tarzi, de l’université de Strasbourg, qui me
demandait de bien vouloir faire inscrire trois de ses étudiants en Master I sous ma direction à Université de Paris
IV-Sorbonne. Avant de venir à Paris, O. Bordeaux avait obtenu sa licence d’archéologie à l’Université Marc Bloch de
Strasbourg. Il possédait déjà une bonne formation en histoire de l’art, ayant été initié à l’histoire de l’Asie centrale
précisément par l’enseignement de M. Tarzi. Lors d’entretiens préliminaires que j’eus alors avec lui, j’ai pressenti les
qualités du numismate que ce jeune étudiant deviendrait sans doute un jour en inspirant toute ma confiance. Cela me
rappelait ma propre expérience ainsi que le tuteur scientifique que le regretté Paul Bernard avait bien voulu être pour
l’étudiant que j’étais, il y a plus de trente ans.
O. Bordeaux a dès lors rédigé en 2008, dans le cadre de l’École doctorale VI de Paris IV-Sorbonne, un Master 1
consacré à un essai de reconstitution de divers trésors monétaires de l’Afghanistan et du Pakistan apparus sur le marché
des antiquités de 1990 à 2008, travail pour lequel il obtint la mention “Très bien”. Entre 2008 et 2010, il a participé en
France à divers chantiers archéologiques gallo-romains et médiévaux qui lui ont permis de s’initier aux techniques de
fouille et de se familiariser avec la problématique des datations. Invité en 2010 par Philippe Marquis, alors directeur
de la Délégation archéologique française en Afghanistan, il a passé deux mois en Afghanistan afin d’étudier et classer
les monnaies trouvées dans les récentes fouilles de Bactres (Balkh), effectuées sous la direction du regretté Roland
Besenval, directeur de la Mission archéologique française en Bactriane afghane (MAFBA) et directeur de la DAFA de
2003 à 2009. En 2011, O. Bordeaux a présenté un Master 2 en archéologie à l’Université Paris IV-Sorbonne et obtenu la
mention “Très Bien” compte tenu des qualités exceptionnelles qu’y manifeste l’auteur. O. Bordeaux s’est alors inscrit en
doctorat et, au bout de quatre ans de recherches, il a brillamment soutenu sa thèse.
Je me suis permis de rappeler son parcours car je sais que le travail qu’il nous présente dans cet ouvrage repose sur un
acquis scientifique solide. J’avais conseillé à O. Bordeaux de rédiger cette thèse sur les successeurs d’Alexandre le Grand
en Asie centrale et dans l’Inde à partir de la reconstitution des trésors monétaires où apparaissent des émissions frappées
par eux et à l’aide des études de coins, car l’écriture de l’histoire des souverains gréco-bactriens et indo-grecs, autrement
dit des successeurs de Diodote I en Bactriane et plus tard en Inde – à partir du début du iie s. a.C. dans ce second cas –
dépend essentiellement de la connaissance des séries monétaires émises par ces souverains. C’est grâce à ces monnaies
que nous connaissons aujourd’hui l’existence de quarante-cinq rois grecs qui ont régné en Bactriane et dans l’Inde du
Nord-Ouest, alors que les sources écrites et épigraphiques n’en mentionnent que dix. Les pièces qu’ils ont frappées
avec leurs noms et leurs portraits, ainsi qu’avec les images des divinités sous la protection desquelles ils se plaçaient,
répercutent le message politique qu’ils destinaient à leurs sujets. Grâce aux efforts des numismates, épigraphistes,
archéologues et historiens, la chronologie de leurs règnes, même si elle reste relative, est assez bien connue aujourd’hui,
mais l’histoire politique et économique de ces royaumes laisse encore à désirer. Pour en améliorer notre connaissance,
il était indispensable de procéder à des études de coins, c’est-à-dire de retrouver l’ordre de succession des différentes
frappes à l’intérieur de chaque émission d’après les moindres particularités de chaque estampille et de son degré d’usure
(chaque estampille permet de frapper plusieurs milliers de monnaies), ainsi que l’ordre d’apparition dans le temps des
LES GRECS EN INDE
différentes séries d’après les recoupements internes et externes que l’on peut établir entre elles. L’aboutissement de ce
travail n’a pas été facile, des milliers de monnaies nouvelles inondant chaque jour le marché des antiquités suite à des
découvertes fortuites et surtout à des fouilles illicites qui ont ravagé, comme un gigantesque tsunami, les pays entre
l’Oxus et le Gange durant les trente dernières années, se propageant en raison de la décomposition du pouvoir politique,
des interventions étrangères et des guerres civiles qui ont déstructuré des sociétés entières. Afin de faire face à ces
difficultés majeures O. Bordeaux a mis au point une base de données informatisée à partir des publications des grandes
collections publiques et privées, des monnaies parues isolément dans les catalogues de vente, le plus souvent sans
provenance avouée, et des trésors monétaires dont il a pu avoir connaissance, faisant preuve d’une grande perspicacité
pour relever et interpréter les recoupements d’informations qui permettent parfois de remonter la piste jusqu’au lieu
de trouvaille réel.
Grâce à l’accueil chaleureux de Monsieur Michel Amandry, alors directeur du Cabinet des Médailles, O. Bordeaux
a pu passer plusieurs mois à dépouiller des montagnes de catalogues de vente. Les images ont été photographiées
ou numérisées par ses soins. Le nom du souverain, les types, le poids et les dimensions de chaque pièce ont été
soigneusement notés. Ce travail extrêmement fastidieux sera très prochainement mis en ligne pour être accessible à
tous. Cette base est une véritable source d’informations pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine, car un tel travail
n’avait jamais été réellement réalisé auparavant d’une façon aussi complète et systématique. On ne dira jamais assez à
quel point il est difficile de réaliser un tel travail, qui exige tant de compétences, de patience et de persévérance.
La formation d’Olivier Bordeaux en tant que numismate s’est faite au contact direct des réalités numismatiques au
Cabinet des Médailles de Paris et sur son terrain de prédilection, l’Afghanistan et l’Inde. Trois ans après son premier
séjour en Afghanistan, il a passé huit mois à Kaboul entre mai et décembre 2014 comme consultant pour inventorier une
partie des monnaies du Musée National d’Afghanistan. C’est le Pr. Gil Stein, directeur de l’Institut oriental de l’Université
de Chicago, qui l’avait fait recruter pour entreprendre cette tâche difficile dans une ville hautement dangereuse. Cette
mission lui a permis d’inventorier 4064 monnaies.
Grâce aux fonds généreusement accordés par l’école doctorale VI de Paris IV-Sorbonne, O. Bordeaux a pu aussi
examiner les collections indiennes des musées de New Delhi, Calcutta et Chandigarh. Invité par Frank L. Holt, professeur
à l’Université de Houston, il a eu l’occasion de travailler quelque temps sous la direction de ce savant qui est l’un des
meilleurs connaisseurs de la numismatique grecque d’Asie centrale. Frank a partagé avec lui sa passion et son savoir-
faire. Toutes ces missions lui ont permis de fréquenter des numismates, archéologues et historiens compétents dont les
conseils ont largement contribué à sa formation.
Le regretté Paul Bernard, qui a eu sa thèse entre les mains, m’a autorisé à dire qu’il partageait entièrement les
conclusions avancées par O. Bordeaux. La France est l’un des rares pays au monde où la science des monnaies est
enseignée dans les universités et autres institutions de haut niveau. En France les étudiants apprennent avec leurs
maîtres la rigueur scientifique et l’esprit critique qui doivent être appliqués à l’étude de ces documents historiques.
O. Bordeaux a suivi avec détermination cette voie de rigueur et de sagesse. Lorsqu’on examine certaines publications sur
la numismatique de l’Asie centrale, surtout en anglais, parues au cours de dix dernières années, on se rend compte que
le manque de connaissances historiques et la méconnaissance totale des langues anciennes et modernes, et notamment
l’ignorance des publications en français et en allemand, donnent lieu à des élucubrations d’amateurs, collectionneurs
et marchands de monnaies. Dangereusement fascinés par la personnalité de W. W. Tarn – au moins connaissait-il, lui,
les langues anciennes classiques – ces soi-disant historiens se laissent entraîner à romancer l’histoire des Grecs en Asie
centrale et dans l’Inde du Nord-Ouest. Ils proposent des liens de parenté entre les souverains sans aucun fondement
historique, numismatique ou épigraphique.
O. Bordeaux a justifié dans le chapitre consacré à la méthodologie les raisons pour lesquelles il a choisi les monnaies
des deux Diodotes, Euthydème I, Eucratide I, Ménandre I et Hippostrate, afin d’effectuer ces études de coins jugées
plus indispensables que jamais. Frank L. Holt, qui a consacré un ouvrage sur les émissions de Diodote, a présenté ses
observations sur les résultats de l’étude des coins des monnaies des deux Diodotes. Je tiens à signaler que le dernier
livre de Brian Kritt, intitulé New Discoveries in Bactrian Numismatics, et qui date de 2015, est un exemple de la façon
dont on arrive à avancer des hypothèses avec une totale méconnaissance de l’histoire indienne. B. Kritt nie l’existence
d’un atelier monétaire principal à Bactres à l’époque séleucide et attribue à Aï Khanoum celui qu’on plaçait jusque-là
dans la capitale traditionnelle de la Bactriane, en faisant valoir la présence d’un symbole qui ressemble à l’akṣara “jha”
8