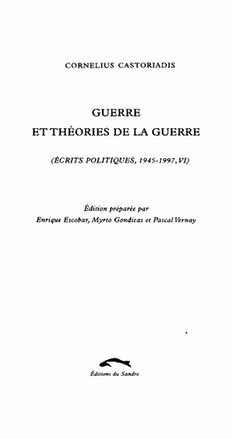Table Of ContentCORNELIUS CASTORIADIS
GUERRE
ET THÉORIES DE LA GUERRE
(ÉCRITS POLITIQUES, 1945-1997, VI)
Edition préparée par
Enrique Escobar, Myrto Gondicas et Pascal Vernay
Éditions du Sandre
Avertissement
Guerre et théories de la guerre est la suite directe de La Société
bureaucratique, du point de vue aussi bien chronologique que
logique. Cette édition comprend, bien entendu, le livre de 1981,
Devant la guerre - mais intégré dans un ensemble regroupant,
outre d'autres textes sur le même sujet, de nombreux inédits, en
particulier un important ensemble sur les théories de la guerre, qui
auraient pris place dans un second volume jamais publié. On y a
joint de très nombreux entretiens, polémiques et correspondances
se rapportant à la décennie qui va de 1981 à la fin de l'URSS.Tous
les originaux (textes dactylographiés ou manuscrits) des inédits de
l'auteur publiés dans ce volume se trouvent maintenant au Fonds
Castoriadis des Archives de l'IMEC (Caen).
Il s'agit du sixième volume d'une édition des Écrits politiques, 1945-
1997 de Cornélius Castoriadis dont voici le plan d'ensemble :
- La Question du mouvement ouvrier (vol. I et II)
- Quelle démocratie ? (vol. III et IV)
- La Société bureaucratique (vol. V)
- Guerre et théories de la guerre (vol. VI)
- Ecologie et politique, suivi de Correspondances et compléments (à
paraître en 2017, vol. VII)
- Sur la Dynamique du capitalisme et autres textes, suivi de L'Impé-
rialisme et la guerre (vol. VIII).
Le lecteur constatera deux modifications par rapport à notre plan
de publication initial. Nous avions signalé, dans l'« Avertissement »
du vol. V, que la publication d'un volume VIII était à l'étude, qui
regrouperait « des textes de l'auteur consacrés aux rapports entre
écologie et politique, des correspondances (notamment avec
Jacques Ellul) et divers compléments ». A la réflexion, nous avons
7
GUERRE ET THÉORIES DE LA GUERRE
jugé préférable de publier le volume Écologie et politique comme
volume VII, à la suite de celui-ci, et de terminer cette édition avec
Sur la Dynamique du capitalisme. Nous avons également modifié le
titre du vol. VI, qui n'est nullemment, nous l'avons dit et le lecteur
s'en apercevra aisément, une simple réédition avec quelques ajouts
du livre de 1981.
On trouvera les choix et les principes qui ont guidé notre édi-
tion dans l'«Avertissement» du vol. I (t. 1 de La Question du mou-
vement ouvrier). Rappelons que les crochets obliques ou «brisés»
- < > - signalent, dans le corps du texte, nos interventions édito-
riales quand l'ajout de quelques mots ou de membres de phrase a
semblé indispensable à l'intelligence du texte. Ils signalent égale-
ment les notes de bas de page introduites par nous pour apporter
des précisions sur la nature de chaque texte ou des éclaircisse-
ments sur tel personnage, tel événement ou telle allusion de
l'auteur quand cela nous a semblé indispensable, et pour renvoyer
à d'autres parties de l'œuvre. Quant aux passages entre crochets
carrés - [] -, ils ont été ajoutés par l'auteur au moment de la
reprise de certains textes en volume ou à différentes étapes de la
réécriture des inédits.
E.E., M.G. et P.V.
LISTE DES SIGLES
DES VOLUMES ET ARTICLES
DE CASTORIADIS LE PLUS FRÉQUEMMENT CITÉS1
OUVRAGES PUBLIÉS DU VIVANT DE L'AUTEUR
SB, 1 : La Société bureaucratique, 1 : Les Rapports de production en Russie,
Paris, UGE, « 10/18 », 1973 (rééd. en un vol., avec SB, 2, Chris-
tian Bourgois, 1990).
SB, 2 : La Société bureaucratique, 2 : La Révolution contre la bureaucratie,
Paris, UGE, « 10/18», 1973 (rééd. Christian Bourgois, 1990).
EMO, 1 : L'Expérience du mouvement ouvrier, 1 : Comment lutter, Paris,
UGE, «10/18», 1974.
EMO, 2 : L'Expérience du mouvement ouvrier, 2 : Prolétariat et organisation,
Paris, UGE, « 10/18 », 1974.
CMR, 1 : Capitalisme moderne et révolution, 1 : L'Impérialisme et la guerre,
Paris, UGE, « 10/18», 1979.
CMR, 2 : Capitalisme moderne et révolution, 2 : Le Mouvement révolution-
naire sous le capitalisme moderne, Paris, UGE, « 10/18 », 1979.
CS : Le Contenu du socialisme, Paris, UGE, « 10/18 », 1979.
SF: La Société française, Paris, UGE, « 10/18 », 1979.
IIS: L'Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975 (rééd.
«Points Essais», 1999).
CL, 1 : Les Carrefours du labyrinthe, Paris, Seuil, 1978 (rééd. «Points
Essais», 1998).
DG, 1 : Devant la guerre. 1. Les réalités, Paris, Fayard, 1981.
DDH: Domaines de l'homme (Les Carrefours..., 2), Paris, Seuil, 1986
(rééd. «Points Essais», 1999).
MM : Le Monde morcelé (Les Carrefours...,3), Paris, Seuil, 1990 (rééd.
« Points Essais », 2000).
1. Nous ne donnons ici que les sigles utilisés par Castoriadis lui-même,
ou bien par nous dans des renvois en notes de bas de page à d'autres
parties de l'œuvre.
9
GUERRE ET THÉORIES DE I.A GUERRE
MI: La Montée de l'insignifiance (Les Carrefours..., 4), Paris, Seuil,
1996 (rééd. «Points Essais», 2007).
FF: Fait et à faire (Les Carrefours..., 5), Paris, Seuil, 1997 (rééd.
«Points Essais», 2008).
PUBLICATIONS POSTHUMES
FP: Figures du pensable (Les Carrefours..., 6), Paris, Seuil, 1999
(rééd. «Points Essais», 2009).
SPP: Sur Le Politique de Platon (séminaires EHESS, 1986; éd.
P.Vemay), Paris, Seuil, 1999.
SV: Sujet et vérité dans le monde social-historique (séminaires 1986-
1987 ; éd. E. Escobar et P.Vemay), Paris, Seuil, 2002.
CQFG, 1 :Ce qui fait la Grèce. 1. D'Homère à Heraclite (séminaires 1982-
1983; éd. E. Escobar, M. Gondicas et P.Vemay), Paris, Seuil,
2004.
SD : Une société à la dérive. Entretiens et débats 1974-1997 (éd. E. Esco-
bar, M. Gondicas et P.Vemay), Paris, Seuil, 2005.
FsCh: Fenêtre sur le chaos (éd. E. Escobar, M. Gondicas et P. Vernay),
Paris, Seuil, 2007.
CEL : La Cité et les lois (Ce qui fait la Grèce, 2) (séminaires 1983-1084 ;
éd E. Escobar, M. Gondicas et P. Vernay), Paris, Seuil, 2008.
ThFD : Thucydide, la force et le droit (Ce qui fait la Grèce, 3) (séminaires
1984-1985 ; éd. E. Escobar, M. Gondicas et P. Vernay), Paris,
Seuil, 2011.
QMO : La Question du mouvement ouvrier (Écrits politiques 1945-1997,
I et II) (éd. E. Escobar, M. Gondicas et P. Vernay), Paris, Édi-
tions du Sandre, 2012.
QD: Quelle démocratie? (Écrits politiques, 1945-1997, III et IV) (éd.
E. Escobar, M. Gondicas et P. Vernay), Paris, Éditions du
Sandre, 2013.
SOCBUR. La Société bureaucratique (Écrits politiques, 1945-1997, V) (éd.
E. Escobar, M. Gondicas et P. Vemay), Paris, Éditions du
Sandre, 2015).
GTG: Guerre et théories de la guerre (Écrits politiques, 1945-1997, VI)
(éd. E. Escobar, M. Gondicas et P.Vemay), Paris, Éditions du
Sandre, 2016).
10
LISTE DES SIGLES
ARTICLES
CFP : « La concentration des forces productives » (inédit, mars 1948 ;
SB, 1, p. 101-114 ; SOCBUR, p. 625-636).
PhCP: «Phénoménologie de la conscience prolétarienne» (inédit,
mars 1948; SB, l,p. 115-130; QMO,t. l,p. 363-377).
SB: «Socialisme ou barbarie» (S.ouB., n°l, mars 1949; SB, 1,
p. 135-184; SOCBUR, p. 71-114).
RPR: «Les rapports de production en Russie» (S.ouB., n°2, mai
1949 ; SB, 1, p. 205-282 ; SOCBUR, p. 135-211).
DCI et II : « Sur la dynamique du capitalisme » (S.ouB., n™ 12 et 13, août
1953 et janvier 1954).
SIPP : « Situation de l'impérialisme et perspectives du prolétariat »
(S.ouB., n° 14, avril 1954; CMR, 1, p.375-435).
CSI: «Sur le contenu du socialisme» (S.ouB., n°17, juillet 1955;
CS, p. 67-102 ; QMO, t. 2, p. 19-47).
CS II: «Sur le contenu du socialisme» (S.ouB., n°22, juillet 1957;
CS, p. 103-221 ; QMO, t. 2, p. 49-141).
CS III: «Sur le contenu du socialisme» (S.ouB., n°23, janvier 1958;
EMO, 2, p. 9-88 ; QMO, t. 2, p. 193-247).
RPB: «La révolution prolétarienne contre la bureaucratie» (S.ouB.,
n°20, décembre 1956; SB, 2, p. 267-338; SOCBUR, p. 413-
459).
PO I et II :« Prolétariat et organisation » (S. ou B., n™ 27 et 28, avril et juillet
1959 ; EMO, 2, p. 123-248 ; QMO, t. 2, p. 273-316).
MRCM I, II et III: «Le mouvement révolutionnaire sous le capitalisme
moderne» (S.ouB., nw31, 32 et 33, décembre 1960, avril et
décembre 1961; CMR, 2, p. 47-258 ; QMO, t. 2, p. 403-528).
RR: «Recommencer la révolution» (S.ouB., n°35, janvier 1964,
CMR, 2, p. 307-365 ; QD, 1.1, p. 113-153).
RIB: «Le rôle de l'idéologie bolchevique dans la naissance de la
bureaucratie» (S.ouB., n°35, janvier 1964; EMO, 2, p.385-
416; QD, 1.1, p. 191-212).
MTR là V: «Marxisme et théorie révolutionnaire» (S.ouB., n™ 36 à 40,
avril 1964 à juin 1965 ; IIS, p. 13 à 230, rééd. p. 13-248).
IG: «Introduction» (1972) à SB, 1, p. 11-61 (rééd. Bourgois 1990,
p. 20-56 ;QD, t.l.p. 329-377).
11
GUERRE ET THÉORIES DE LA GUERRE
HMO : «La question de l'histoire du mouvement ouvrier» (1973)
(EMO, 1, p. 11 à 120; QD, 1.1, p. 383-455).
RDR : « Réflexions sur le "développement" et la "rationalité" » (1974)
(DDH, p. 131-174; rééd. p. 159-214).
VEJP: «Valeur, égalité, justice, politique: de Marx à Aristote et
d'Aristote à nous» (1975) (CL, p.249-315).
ER : « L'exigence révolutionnaire » ( 1976) (CS, p. 323-366 ; QD, 1.1,
p. 541-573).
RSR: «Le régime social de la Russie» (1977) (DDH, p. 175-200,
rééd. p. 215-248 ; SOCBUR, p. 553-581).
TSCC : «Transformation sociale et création culturelle» (1978) (CS,
p. 413-439 ; FsCH, p. 11-39.
SSA: «Socialisme et société autonome» (1979) (CS, p. 11-43; QD,
t. 2, p. 79-105).
PGCD : « La polis grecque et la création de la démocratie » ( 1979-1985)
(DDH, p. 261-306, rééd. p. 325-382).
IF: «Une interrogation sans fin» (1979) (DDH, p.241-260, rééd.
p. 301-324).
NVE: «Nature et valeur de l'égalité» (1981) (DDH, p. 307-324, rééd.
p. 383-405).
DT: «Les destinées du totalitarisme» (1981) (DDH, p.201-218,
rééd. p. 249-271 ; GTG, p. 51-70).
RefR: «Réflexions sur le racisme» (1987) (MM, p.25-38, rééd.
p. 29-46).
PPA: «Pouvoir, politique, autonomie» (1988) (MM, p. 113-139,
rééd. p. 137-171 ; QD, t. 2, p. 253-282).
APhP: «Anthropologie, philosophie, politique» (1989) (MI, p. 105-124,
rééd. p. 125-148).
QD?: «Quelle démocratie?» (1990) (FP, p. 145-180, rééd. p. 175-
217 ; QD, t. 2, p. 395-433).
DPR: «La démocratie comme procédure et comme régime» (1994)
(MI, p. 221-241, rééd. p. 267-292 ; QD, t. 2, p. 487-510).
RC: «La "rationalité" du capitalisme» (1997) (FP, p.65-92, rééd.
p.79-112; QD,1.2, p. 627-656).
APRÈS LE TOTALITARISME
I
Il est aujourd'hui communément admis qu'il y a un passé que
l'on peut appeler totalitaire- même si ce que le terme recouvre
est sujet à débat. La réalité russe - « communiste »' - fut pour cer-
tains éminemment totalitaire et grosse de menaces ; pour d'autres,
d'une toute autre nature et en fin de compte prometteuse - mais
tout cela, semblent dire amis et ennemis, c'est justement du passé.
Jusqu'à quel point, au fait ? Une remarque de Castoriadis, dans les
dernières années du régime, nous rappelle une banalité que l'on a
tendance à oublier : du point de vue historique, ruptures et persis-
tances sont parfois moins faciles à saisir qu'il n'y paraît.
1. Il y a encore des milieux intellectuels se voulant « radicaux » où l'on ne
veut surtout pas savoir que le terme « communiste » désigne aujourd'hui
une réalité qui n'a aucun rapport avec le sens qui était donné au mot en
1848 - et que l'on n'y peut rien. L'auteur, dans le texte, ne tient bien
entendu pas compte de ces fantaisies, pour des raisons qu'il avait déjà
données dans RR (1963) : « Les mots ont leur destin historique, et quelles
que soient les difficultés que cela nous crée (et que nous ne résolvons
qu'en apparence en écrivant "communiste" entre guillemets), il faut
comprendre que nous ne pouvons pas jouer relativement à ce langage
le rôle d'une Académie française de la révolution, plus conservatrice
que l'autre, qui refuserait le sens vivant des mots dans l'usage social et
maintiendrait qu'étonner signifie " faire trembler par une violente com-
motion " et non surprendre, et que le communiste c'est le partisan d'une
société où chacun donne selon ses capacités et reçoit selon ses besoins, et
non le partisan de MauriceThorez. » (QD, t. 1, p. 141-142). Cf. aussi, ici
même, les considérations de l'auteur en 1981, p. 302-303. Mais il va de
soi que « toute compréhension de la réalité russe » est interdite à qui peut
croire une seule seconde « que le Parti communiste russe est communiste
- dans n'importe quel sens de ce terme » (p. 344).
13
GUERRE ET THÉORIES DE I.A GUERRE
«Les Occidentaux - écrivait-il en 19871 - tendent à juger la
politique russe à leur propre aune temporelle, une continuité de
quatre ans en politique leur paraissant un miracle. Mais il appar-
tient parfaitement à la logique du régime russe de calmer le jeu
pour dix, vingt ou trente ans, si cela est nécessaire et possible. Il
ne s'agit pas d'une planification hyper-intelligente à long terme :
mais de la construction russe du temps social-historique [je soul.,
E.E.], soutenue au plan des relations extérieures par la position
géo-stratégique de la Russie et les avantages qu'elle lui confère. »
Entendons-nous : le régime n'a pas réussi à « calmer le jeu », il s'est
effondré. Les dirigeants russes n'ont à aucun moment «voulu»
la fin de l'Empire « extérieur », la dislocation de l'URSS ou l'im-
plosion du système. Et, certes, nous ne sommes pas aujourd'hui
face à la « même » Russie, les ruptures sont réelles. Pourtant : les
éléments de continuité entre l'ancien et le nouveau régime (com-
portements, visées, composition même des couches dominantes)
sont bien plus grands que ne semblent le soupçonner la plupart
des observateurs et la connaissance de la réalité russe des années
1980 - et en particulier du retour en force, à l'époque, de l'ima-
ginaire nationaliste-impérial2 - pourrait être extrêmement utile à
qui veut comprendre la Russie d'aujourd'hui. C'est bien ce qui
justifie surtout cette édition, au-delà de l'intérêt que ces textes
peuvent avoir du point de vue de l'histoire intellectuelle ou de
l'histoire tout court : il ne s'agit pas du passé, mais du présent et
de l'avenir. Nous y reviendrons dans la dernière partie de cette
introduction.
1. Dans «L'interlude Gorbatchev», p. 601.
2. En 1980, dans l'article publié dans la revue Libre qui deviendra le
premier chapitre de Devant la guerre, Castoriadis écrivait déjà : « La
seule «Idéologie» qui reste, ou peut rester, vivante en Russie, c'est le
chauvinisme grand-russien. Le seul imaginaire qui garde une efficace
historique, c'est l'imaginaire nationaliste - ou impérial. Cet imaginaire
n'a pas besoin du Parti - sauf comme masque et, surtout, truchement
de propagande et d'action, de pénétration internationale. Son porteur
organique, c'est l'Armée. » (ici, p. 94) Dans le corps de l'ouvrage, Cas-
toriadis se demandera si cet imaginaire peut vraiment animer quelque
chose, s'il ne tend pas à se confondre avec la pure affirmation de la
Force brute chez son «porteur», l'Armée (ici, p. 330). La question reste
ouverte.
14