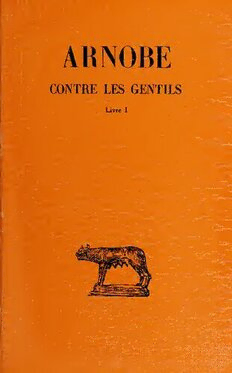Table Of ContentCONTRE LES GENTILS
«
ARNOBE
CONTRE LES GENTILS
Il a été tiré de cet ouvrage:
100 exemplaires sur papier pur fil Lafuma
numérotés de 1 à 100
COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE
publiée sous le patronage de l’ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ
ARNOBE
CONTRE LES GENTILS
LIVRE I
TEXTE ÉTABLI, TRADUIT ET COMMENTÉ
PAR
Henri LE BONNIEG
Professeur à l’Université de Paris-Sorbonne
publié avec le concours
du Centre National de la Recherche Scientifique
PARIS
SOCIÉTÉ D’ÉDITION «LES BELLES LETTRES »
95,
BOULEVARD RASPAIL
R 0 R
b es > 'j
Ht 3 35- i
v
-t. i
Conformément aux statuts de l’Association Guillaume
Budé, ce volume a été soumis à l’approbation de la
commission technique, qui a chargé M. René Braun d’en
faire la révision, en collaboration avec M. Henri Le
Bonniec.
La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement
réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations
dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou repro¬
duction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou
de ses ayants-droit ou ayants-cause, est illicite » (Alinéa 1er de l’article
40).
Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce
soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425
et suivants du Code Pénal.
(g) Société d’édition « Les Belles Lettres », Paris, 1982
ISBN : 2-251-01014-9
ISSN : 0184-7155
INTRODUCTION
I. Éléments biographiques
L’écrivain que nous appelons Arnobe1 n’avait pas les
tria nomina ; en tout cas, les textes ne le connaissent
que sous le nom d’Arnobius2. C’est pour cette raison,
et aussi en se fondant sur l’étymologie, que certains
pensent qu’il était d’origine grecque ; sans aucune
certitude3. Il savait certainement le grec, comme le
montre la lecture de son traité, mais cela prouve
seulement qu’il était cultivé — et nous allons voir que
son métier lui en faisait une obligation. Nous ignorons
le lieu, la date, les circonstances de sa naissance et de
sa mort. La critique externe en est réduite à examiner
1. Cette Introduction doit beaucoup à l’admirable chapitre,
qui a si peu vieilli, consacré à Arnobe par P. Monceaux, Histoire
littéraire de l'Afrique chrétienne, t. 3, Paris, 1905, p. 241-286
(cité ci-dessous « P. Monceaux ») ; l’excellente Introduction de
George E. McCracken, en tête de sa traduction (1949) a été,
elle aussi, constamment utilisée (cité « McCracken »). Pour les
livres ou articles cités en abrégé dans les notes, on trouvera les
références complètes dans la Bibliographie ci-dessous p. 109 sqq.
2. La forme Arnobius est attestée par Jérôme ; voir ci-après.
Mais les explicit de chaque livre dans le Parisinus donnent Arnouii
(génitif), par suite de la confusion fréquente entre le b et le u.
3. Cf. U. Moricca, Storia delta lelteralura latina cristiana,
Turin, 1923, 1, p. 607 : « il suo nome, interamente greco, ha
indotto alcuni a pensare ch’egli appartenesse a una famiglia origi¬
naria délia Grecia ». McCracken, p. 5 et p. 241, n. 23, cite, lui aussi,
pour la première partie du nom d’Arnobe les noms grecs Apveoç,
’ApvÊaç, ’ApviàSaç, "ApviTrjcoç, etc. ; pour la seconde partie
MyiXôSloç, ZvivôSioç, etc. Il renvoie à A. Reifferscheid, Analecta
critica, Index Lecl. Hib., Breslau, 1877, p. 9 sq. et à O. Barden-
hewer, Geschichte der altkirchlichen Literaiur, 2, Fribourg en Br.,
1914, 4. 518, sans prendre lui-même position.
8 INTRODUCTION
à la loupe quelques maigres témoignages de saint
Jérôme : « Sous le règne de Dioclétien » (donc entre
284 et 305), « Arnobe enseigna brillamment la rhéto¬
rique à Sicca, en Afrique, et il écrivit contre les païens
des livres qu’on trouve encore un peu partout »1.
«Arnobe jouit comme rhéteur d’une grande réputation
en Afrique. Au temps où il initiait à la déclamation la
jeunesse de Sicca, étant encore païen, des songes le
forcèrent à embrasser la foi (chrétienne) ; n’obtenant
pas de l’évêque (le droit) de partager une croyance
qu’il avait toujours combattue, il élabora des livres
pleins de talent contre son ancienne religion et enfin,
ayant ainsi fourni pour ainsi dire des gages de sa piété,
il obtint son affiliation (foedus) »2.
Personne ne doute sérieusement qu’Arnobe ait été
professeur de rhétorique ; il est d’ailleurs appelé orator
dans Yexplicit du livre 4 du Parisinus. Mais il suffit de
le lire pour se persuader que notre homme avait épousé
la rhétorique, pour le meilleur et pour le pire ; si parfois
il dit du mal de cette vieille compagne, il n’a jamais
envisagé le divorce3. On admet souvent qu’il était né à
Sicca Veneria, où il enseigna ; c’est en effet probable,
car cette ville n’était pas assez importante pour attirer
un rhéteur étranger4.
1. De uiris illusl. 79 : Arnobius sub Diocletiano principe
Siccae apud Africam florentissime rhetoricam docuit scripsilque
aduersus gentes quae uulgo exstant uolumina. Cf. 80 Firmianus,
qui et Lactantius, Arnobii discipulus, sub Diocletiano principe.
2. Chron. Helm p. 231, 14 Arnobius rhetor in Africa clarus
habetur. Qui cum Siccae ad declamandum iuuenes erudiret et adhuc
ethnicus ad credulitatem somniis compelleretur neque ab episcopo
impetraret fidem, quam semper impugnauerat, elucubrauit aduersus
pristinam religionem luculentissimos libros et tandem uelul quibus¬
dam obsidibus pietatis foedus impetrauit.
3. Voir ci-dessous, Introd., p. 86 sqq.
4. C’est l’avis de McCracken, p. 7 et n. 40, p. 242 sq., qui cite
1 opinion positive de divers critiques ; sur Sicca Veneria, en
Numidie Proconsulaire, auj. El Kef, en Tunisie, cf. Dessau,
dans R.E., s.v. col. 2187-8. — Il semble superflu de se demander
avec McCracken (p. 7) pourquoi Arnobe n’a pas tiré argument
dans sa polémique de l’existence à Sicca d’un temple de Vénus
où les femmes puniques se prostituaient, avant leur mariage,
INTRODUCTION 9
On. a mis en doute le rôle joué par des songes dans la
conversion : Arnobe (1, 46, 8) parle de uana somnia ;
ailleurs (7, 39), il raconte comment Jupiter apparut en
songe à un paysan ; enfin, dans le seul passage (1, 39)
où il fasse allusion à sa conversion, il ne souffle mot de
ces rêves qui l’auraient déterminé1. Ces arguments ne
sont pas convaincants ; Arnobe ne dit pas que tous les
songes sont vains, au contraire ; dans son récit, le
paysan qui n’a pas tenu compte de l’avertissement de
Jupiter est cruellement puni par le dieu. D’autre part,
l’apologiste n’a fait aucune confidence sur les motifs
de sa conversion ; son silence sur les songes ne suffit pas
à en infirmer l’existence. D’excellents juges ont pensé
qu’il fallait sur ce point faire crédit au témoignage de
Jérôme. « Étant donné l’homme et les idées du temps,
la réalité de ces songes n’a rien d’invraisemblable »
(P. Monceaux, p. 244). J. H. Waszink2 rappelle qu’aux
ne et me siècles on attachait beaucoup d’importance
aux rêves, et que ceux-ci ont dû jouer un rôle dans les
conversions, puisque selon Tertullien [De anima 47, 2),
maior paene uis hominum ex uisionibus (— somniis
d’après le contexte) deum discunt3. En cette « époque
d’anxiété », si bien caractérisée par E. R. Dodds4, tout
afin de gagner leur dot (Val. Max., 2, 6, 15), étant donné que
« it seems difficult to believe that even a professor of rhetoric
could hâve been ignorant of the temple, has he really lived in
Sicca o (!).
1. Arguments allégués par Oehler et Bryce-Campbell, cf.
McCracken, p. 15.
2. Dans son c. r. de l’éd. de McCracken, Vig. Christ. 4, 1950,
p. 118.
3. Selon Lactance, De opif. Dei 18, 9, Dieu a recours aux
songes pour instruire les hommes : facultatem sibi reliquit docendi
hominem futura per somnium (texte cité par J. R. Laurin, Orien¬
tations..., p. 419, n. 11). Suries songes dans la tradition chrétienne,
cf. M. Dulaey, Le rêve dans la vie et la pensée de Saint Augustin,
Paris, 1973, surtout p. 49-68 (p. 57 sur Arnobe).
4. E. R. Dodds, Pagan and Christian in an Age of Anxielg...,
p. 38 sqq. — Pour se rendre compte de la place que tenaient les
songes et leur interprétation dans la vie des anciens, consulter
La clef des songes d’Artémidore, dans la traduction de
10 INTRODUCTION
le monde prenait les songes au sérieux, aussi bien les
chrétiens que les païens : « Gertainly, of ail modes of
contact with the supernatural, dreaming... was in
antiquity, the most widely practised » (p. 38). Selon
Origène1, « beaucoup sont venus au christianisme
comme malgré eux, un certain esprit ayant soudain
tourné leur cœur de la haine de la doctrine à la résolution
de mourir pour elle, en leur présentant une vision ou un
songe. J’en ai connu bien des exemples ». Ces paroles
s’appliquent exactement à la conversion d’Arnobe, vue
par Jérôme.
Nous ignorons tout de la nature et du contenu de
ces somnia, mais ils traduisaient naturellement les
préoccupations, les inquiétudes, les aspirations du
futur converti. On s’est demandé quelles avaient été
les véritables causes de sa conversion ; celles qui ont
été proposées sont de nature diverse, mais ne s’excluent
pas ; elles n’ont rien d’arbitraire, car, à défaut d’une
confession de l’intéressé, elles se fondent sur des inter¬
rogations minutieuses de son œuvre. Donnons-en
un aperçu, sans pouvoir ici entrer dans le détail.
P. Monceaux a bien mis en lumière la désillusion pro¬
fonde qui avait plongé cette âme assoiffée de vérité
dans le plus profond désarroi : « Arnobe avait exploré
curieusement la théologie païenne, les mystères, les
religions exotiques. Il portait dans ces études des
préoccupations morales et demandait aux théologiens
comme aux philosophes une règle de vie. En même
temps, il était crédule, et voulait croire à tout prix. Il
revint très déçu de ses longues excursions mystiques ;
ce dévot s’effraya en constatant qu’il tombait dans le
scepticisme. En maint endroit de son Apologie et dans
A. J. Festugière, Paris, 1975. Indications bibliographiques, p. 9
sur le rôle des songes dans l’antiquité.
1. Nous citons ce texte, auquel Dodds renvoie, d’après la
trad. M. Borret, Contre Celse, 1, 46, t. 1, p. 197. Dodds, p. 46,
n. 2, remarque : « for action in obedience to a dream Christians
had the example of St Paul, Acts 16, 9 sq. » (celui-ci part pour la
Macédoine, à la suite d’une vision nocturne).